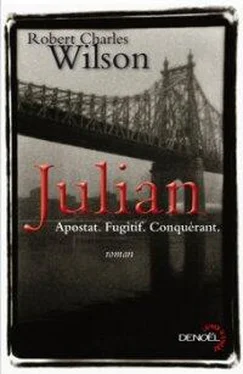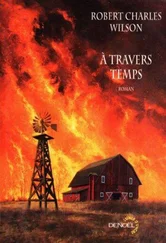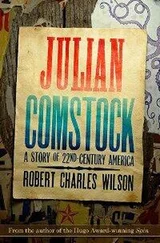Notre chemin a obliqué vers le nord, dépassé des bosquets d’ailantes et de larges prairies tondues pour arriver à un endroit appelé pelouse aux Statues, sur laquelle on avait conservé d’imposants exemples de sculptures datant de l’Efflorescence du Pétrole. Sur notre gauche, nous avons vu une statue équestre, celle d’un certain Bolivar, ainsi qu’une pointe en pierre appelée l’aiguille de Cléopâtre. Sur notre droite, un immense Bras métallique tenait une Torche vert-de-gris aussi haute qu’un pin d’Athabaska, adjacente à une Tête couronnée brisée [63] La Tête et le Bras étaient des fragments du Colosse de la Liberté, nous a dit Julian. D’après la légende, le Colosse se tenait debout, un pied de chaque côté des Narrows, si bien que bateaux et péniches passaient entre ses jambes. Un examen superficiel révèle que l’échelle ne convient pas et que le Colosse n’aurait pu couvrir la distance entre les deux rives du chenal, même en écartant les cuisses à un angle peu flatteur. Cela devait néanmoins avoir été une énorme statue visible à très grande distance… loin de moi l’idée d’en rabaisser la splendeur.
. Ces objets (et les autres du même genre) donnaient une impression à la fois d’audace et de mélancolie, et tandis que nous passions entre eux dans les dernières lueurs du jour, ils ont projeté des ombres qui semblaient les gnomons de monstrueux cadrans solaires.
Notre calèche n’était pas la seule à emprunter ce chemin. De chacune des quatre portes du Parc arrivaient à intervalles réguliers des voitures, chariots ou cavaliers qui se dirigeaient vers le palais exécutif. Les calèches arboraient des dorures, les cavaliers étaient en habit de cérémonie et les lanternes des voitures avaient commencé à luire dans la pénombre de plus en plus épaisse. Les plus raffinés et les plus riches des habitants ou habitantes de Manhattan avaient tous reçu une invitation à cette fête annuelle. Ceux à qui on n’en avait pas adressé prenaient cela comme un affront : pour un éminent Eupatridien, ne pas être invité signifiait souvent avoir la malchance de ne plus jouir des bonnes grâces de l’exécutif, et s’il était sénateur, il pouvait commencer à redouter les coups de poignard dans le dos.
Pétrie de principes parmentiéristes, Calyxa n’a bien entendu pas laissé tout ce spectacle et cet étalage l’impressionner. J’avais espéré qu’elle dissimulerait son mépris pour les Eupatridiens, au moins jusqu’à la fin de la fête. Cet espoir allait être déçu.
Nous sommes arrivés à proximité des vastes écuries du palais exécutif, où des garçons en livrée réceptionnaient les voitures des nombreux invités. Nous sommes descendus de la nôtre et nous nous dirigions vers l’entrée du palais quand nous sommes tombés sur un Aristo furieux qui corrigeait son cocher à coups de canne.
Sa voiture avait perdu une roue, accident que le propriétaire, homme corpulent d’un certain âge, semblait reprocher à son conducteur. Celui-ci, les joues creuses et une sorte de résignation canine dans le regard, était au moins deux fois plus vieux que son maître. Il a supporté la correction avec stoïcisme tandis que l’Aristo l’insultait en termes que je ne peux répéter.
« Que diable ! s’est exclamée Calyxa en découvrant la scène.
— Chut, lui a glissé Sam. C’est Nelson Wieland. Il possède la moitié des usines de relaminage du New Jersey et dispose d’un siège au Sénat.
— Je me fiche que ce soit Crésus à bicyclette, a déclaré Calyxa. Il ne devrait pas se servir de sa canne de cette manière.
— Cela ne nous regarde pas », est intervenue M me Comstock.
Rien n’a toutefois pu dissuader Calyxa de se diriger droit sur M. Wieland pour l’interrompre dans cette épuisante activité qui consistait à rosser son employé.
« Qu’a fait cet homme ? » a-t-elle demandé.
Wieland l’a regardée en clignant des yeux. Il n’a bien évidemment pas reconnu Calyxa, dont la condition lui a semblé peu claire. À en juger par sa robe, à défaut de son maintien, c’était elle-même une Aristo fortunée… Après tout, n’avait-elle pas été invitée à une réception présidentielle ? Il a fini par décider de lui répondre avec amabilité.
« Vous me voyez confus de vous infliger aussi déplaisant spectacle, a-t-il dit. La négligence de cet homme me coûte une roue… et non seulement la roue, mais aussi l’essieu, et donc la voiture.
— En quoi s’est-il montré négligent ?
— Oh, je ne sais pas trop au juste… Il affirme que l’attelage est passé sur une pierre… que la suspension n’a pas été bien entretenue… en d’autres termes, il trouve toutes les excuses possibles pour dégager sa responsabilité. Je ne m’en laisse bien entendu pas conter. Il essaye d’en faire le moins possible… comme à son habitude.
— Et donc, vous le battez jusqu’au sang ? »
Elle n’exagérait pas : les coups avaient ouvert des plaies qui tachaient la chemise blanche et amidonnée du cocher.
« C’est la seule manière pour que cet événement lui reste en mémoire. C’est un sous-contrat, et un lent.
— De toute évidence, non seulement vous êtes un tyran, mais en plus, vous êtes bête # », a dit Calyxa.
Interloqué par cette langue qu’il ne connaissait pas, M. Wieland a une nouvelle fois posé sur Calyxa un regard perplexe, comme on regarde une forme de vie exotique, par exemple une écrevisse, sortie à l’improviste de son milieu naturel. Peut-être l’a-t-il prise pour l’épouse d’un ambassadeur.
« Merci, a-t-il fini par dire, vous me flattez, je n’en doute pas, mais je ne parle pas cette langue et je crains d’être en retard à la réception. » Il a ramassé sa canne pour s’éloigner en hâte.
Calyxa est restée quelque temps en compagnie du cocher battu, avec qui elle a discuté à voix trop basse pour que j’entendisse. Ils ont parlé jusqu’à ce que Sam la rappelât.
« Était-ce nécessaire ? a-t-il demandé.
— Cet homme que vous appelez Wieland est une brute, quelle que soit l’étendue de sa fortune. »
Julian a demandé ce que le cocher blessé avait à dire pour sa défense.
« Il a travaillé presque toute sa vie pour Wieland. C’est le fils d’un forgeron d’une petite ville de Pennsylvanie. Son père l’a vendu à l’usine de Wieland quand sa forge a fait faillite. Il a passé des années à couler des moyeux et les fumées de charbon ont fini par le rendre idiot. C’est à ce moment-là que Wieland l’a pris comme cocher personnel.
— Wieland a donc le droit de le battre s’il le veut. Cet homme est un bien meuble.
— Le droit légal, peut-être, a répondu Calyxa.
— La loi est la loi », a dit Sam.
Le palais exécutif était si grand et si majestueux qu’il aurait pu servir aussi de musée ou de gare. Nous sommes entrés par un portique au plafond digne d’une cathédrale et soutenu par des colonnes de marbre, avant de passer dans une immense salle de réception où les Aristos bavardaient en petits groupes entre lesquels circulaient des serveurs munis de chariots de boissons et d’assiettes de petits aliments. Certains [64] … des aliments, pas des serveurs.
étaient empalés sur des cure-dents. J’ai d’abord trouvé cela frugal pour un dîner présidentiel, jusqu’à ce que Julian m’expliquât qu’il ne s’agissait non du plat principal, mais de simples amuse-gueule destinés à ouvrir l’appétit plutôt qu’à l’assouvir. Nous les avons grignotés en essayant d’apprécier le lambrissage alambiqué, peint d’images tirées de l’histoire des Présidents Pieux, et l’échelle même de l’architecture.
La renommée de Julian l’avait précédé. L’histoire de sa carrière militaire et de sa réapparition soudaine à Manhattan avait d’ailleurs circulé un peu partout. Une fois sa présence remarquée, plusieurs sénateurs sont venus le féliciter de sa bravoure et nombre de jeunes femmes aristos ont tenu à le flatter de leur attention, même s’il ne leur a pas témoigné davantage en retour qu’une simple courtoisie.
Читать дальше