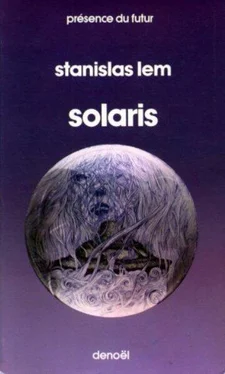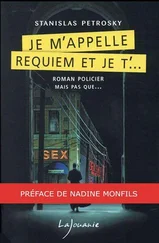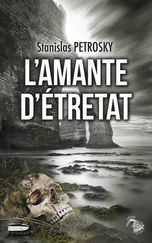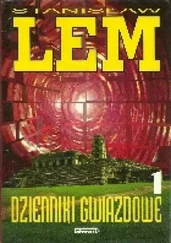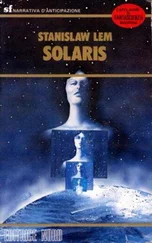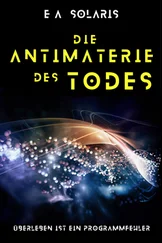Je me tenais debout au milieu de la chambre, à côté de la table. Ma respiration se calmait ; je sentais la sueur se refroidir sur mon front. À quoi avais-je pensé un instant plus tôt ? Ah, oui — aux robots ! Je m’étonnai de n’en avoir rencontré aucun, nulle part. Où étaient-ils tous passés ? Le seul avec lequel j’avais été en rapport — de loin — appartenait aux services d’accueil des véhicules. Mais les autres ?
Je regardai ma montre. Il était temps de rejoindre Snaut.
Je sortis. Des filaments lumineux, courant sous le plafond, éclairaient faiblement la rotonde. Je m’approchai de la porte de Gibarian et je restai longtemps immobile. Le silence, partout le silence. Je pressai la poignée. En réalité, je n’avais pas l’intention d’entrer. La poignée s’abaissa, la porte s’écarta, laissant apparaître une fente noire ; puis les lampes s’allumèrent. Je franchis rapidement le seuil et, sans bruit, je refermai la porte. Puis je me retournai.
Des épaules, je frôlais le panneau de la porte. La chambre était plus grande que la mienne ; un rideau parsemé de petites fleurs roses et bleues, apporté sans doute de la Terre avec les effets personnels et non prévu dans l’équipement de la Station, voilait aux trois quarts la fenêtre panoramique. Le long des parois s’étageaient des rayons, séparés par des placards, les uns et les autres vernis d’émail vert pâle à reflets d’argent. Les bibliothèques et les placards avaient été vidés de leur contenu, qui s’entassait par monceaux entre les tabourets et les fauteuils. À mes pieds, barrant le passage, deux tables roulantes étaient renversées, enfouies sous un amas de périodiques s’échappant de porte-documents bourrés, qui avaient éclaté. Des livres, les feuillets déployés en éventail, étaient maculés de liquides multicolores, qu’avaient répandus en se brisant des cornues et des flacons aux bouchons corrodés, récipients de verre si épais qu’une simple chute, même d’une hauteur considérable, n’aurait pu ainsi les fracasser. Sous la fenêtre gisait un bureau, écrasant de sa masse une lampe de travail à bras mobile. Deux pieds d’un tabouret renversé s’enfonçaient dans les tiroirs entrouverts. Une véritable marée de papiers de tous formats, recouverts de caractères manuscrits, noyaient le sol. Je reconnus l’écriture de Gibarian et je me penchai. En soulevant les feuilles volantes, je remarquai que ma main projetait une ombre double.
Je me redressai. Le rideau rose flamboyait, traversé par une ligne incandescente d’un blanc bleuté et qui allait s’élargissant. Je soulevai le rideau — un embrasement insoutenable progressait à l’horizon, chassant une armée d’ombres spectrales, surgies d’entre les vagues et qui s’étiraient en direction de la Station. C’était l’aube. Après l’intermède d’une heure nocturne, le second soleil de la planète, le soleil bleu, montait dans le ciel.
Quand je revins à mon tas de papiers, l’interrupteur automatique éteignit les lampes. Je tombai sur la description précise d’une expérience, décidée trois semaines auparavant ; Gibarian avait l’intention d’exposer le plasma à une radiation extrêmement intense de rayons X. D’après la teneur du texte, je compris qu’il était destiné à Sartorius, qui devait organiser les opérations ; je tenais en main une copie du projet.
La blancheur des feuillets me blessait les yeux. Ce jour nouveau était différent du précédent. Dans la tiède clarté du soleil orangé, des brumes rousses planaient au-dessus de l’océan noir à reflets sanglants et voilaient presque constamment d’un écran empourpré les vagues, les nuages, le ciel. À présent, le soleil bleu transperçait d’une lumière de quartz le tissu imprimé de fleurs. Mes mains hâlées paraissaient grises. La chambre avait changé ; tous les objets à reflets rouges s’étaient ternis, avaient viré au gris-brun, alors que les objets blancs, verts et jaunes avaient acquis un éclat plus vif et semblaient émettre leur propre lumière. Clignant des yeux, je risquai un autre coup d’œil par la fente du rideau. Une étendue de métal fluide vibrait et palpitait sous un ciel de flammes blanches. Je baissai les paupières et je reculai. Sur la tablette du lavabo (dont le bord était ébréché), je trouvai une paire de grosses lunettes noires ; elles me recouvrirent la moitié du visage. Le rideau irradiait maintenant une lumière de sodium. Je continuai à lire, ramassant les feuillets et les disposant sur l’unique table demeurée utilisable. Le texte comportait des lacunes ; je fouillai en vain les pages éparpillées.
Mettant la main sur les comptes rendus d’expériences déjà entreprises, j’appris que, pendant quatre jours consécutifs, Gibarian et Sartorius avaient soumis l’océan au rayonnement, en un point se situant à quatorze cents milles de la position actuelle de la Station. Or, l’emploi des rayons X était interdit par une convention de l’ONU, en raison de leur action nocive, et j’étais certain que personne n’avait transmis aucune requête à la Terre, pour demander l’autorisation de procéder à de telles expériences. Levant la tête, j’aperçus mon image dans le miroir d’une porte d’armoire entrebâillée, un visage blafard, masqué de lunettes noires. La chambre, tout en reflets blancs et bleus, avait un aspect bizarre, elle aussi. Mais bientôt j’entendis un grincement prolongé et des volets extérieurs, hermétiques, glissèrent devant la fenêtre. Il y eut un instant d’obscurité, puis les lampes s’allumèrent, qui me parurent étrangement faibles. Il faisait de plus en plus chaud ; le débit régulier des appareils de climatisation ressemblait à un jappement exaspéré. Les appareils de réfrigération de la Station travaillaient à plein rendement. Cependant, la chaleur accablante ne cessait de monter.
J’entendis des pas. Quelqu’un marchait dans la rotonde. En deux bonds silencieux, je fus près de la porte. Les pas ralentissaient ; l’inconnu était derrière la porte. La poignée s’abaissa ; sans réfléchir, machinalement, je la saisis ; la pression n’augmenta pas, elle ne faiblit pas. Personne, de part et d’autre de la porte, n’éleva la voix. Chacun tenant la poignée, nous restâmes ainsi un moment. Brusquement, la poignée se redressa, m’échappant des mains. Les pas, étouffés, s’éloignèrent. J’écoutai encore, l’oreille collée au panneau ; je n’entendis plus rien.
Empochant hâtivement les notes de Gibarian, je m’approchai de l’armoire : des combinaisons et autres vêtements avaient été repoussés, serrés de côté, comme si un homme s’était réfugié au fond de la penderie. De l’avalanche de papiers, sur le sol, émergeait le coin d’une enveloppe. Je la ramassai. Elle m’était adressée. La gorge sèche, je déchirai l’enveloppe ; je dus faire un effort pour me décider à déplier le feuillet qu’elle contenait.
De son écriture régulière, parfaitement lisible, bien que très menue, Gibarian avait tracé deux lignes :
Supplément Ann. Solar. Vol 1. : Vot. Separat. Messenger ds aff. F. ; Ravintzer : Petit Apocryphe.
C’était tout, pas un mot de plus. Ces deux lignes renfermaient-elles une information importante ? Quand les avait-il écrites ? Je me dis qu’il me fallait au plus tôt consulter les fichiers de la bibliothèque. Je connaissais le supplément du premier volume de l’annuaire des études solaristes, c’est-à-dire que, sans l’avoir lu, je connaissais son existence — n’avait-il pas une valeur de document purement historique ? Quant à Ravintzer et à son Petit Apocryphe, je n’en avais jamais entendu parler.
Que faire ?
J’étais déjà en retard de presque un quart d’heure. Encore une fois, le dos à la porte, je fouillai la chambre d’un regard attentif. Alors seulement, je remarquai le lit, dressé verticalement contre la paroi et que dissimulait une grande carte de Solaris. Quelque chose pendait derrière la carte — un magnétophone de poche. La bobine avait été enregistrée aux neuf dixièmes. Je retirai l’appareil de son étui, que je raccrochai à l’endroit même où je l’avais trouvé, et je glissai le magnétophone dans ma poche.
Читать дальше