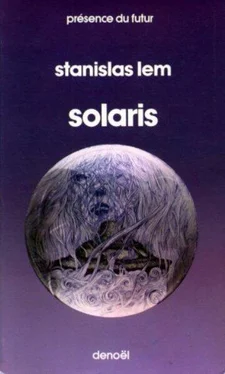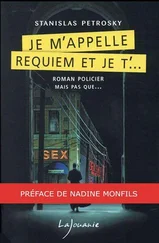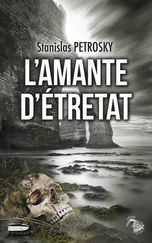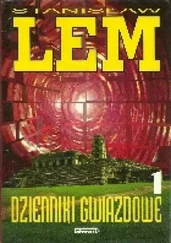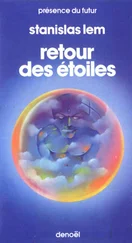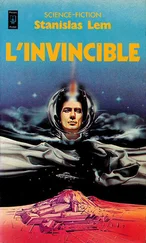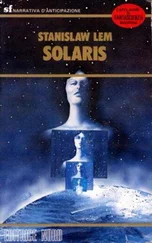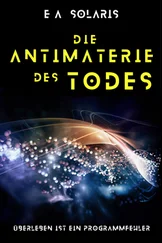L’orbite, du fait des variations de gravitation, s’aplatit ou se distend et les éléments de vie, s’ils apparaissent, sont infailliblement détruits, soit par un rayonnement de chaleur intense, soit par une chute extrême de la température. Ces modifications interviennent dans un temps estimé en millions d’années, par conséquent un temps très court — selon les lois de l’astronomie ou de la biologie (l’évolution exige des centaines de millions, si ce n’est un milliard d’années).
D’après les premiers calculs, Solaris devait en cinq cent mille ans se rapprocher de la moitié d’une unité astronomique de son soleil rouge, et un million d’années plus tard s’abîmer dans l’astre incandescent.
Mais, au bout de quelques dizaines d’années déjà, on crut découvrir que l’orbite n’accusait nullement les modifications attendues ; elle était stable, aussi stable que l’orbite des planètes de notre système solaire.
On recommença, avec une extrême précision, les observations et les calculs, qui confirmèrent simplement les premières conclusions : l’orbite de Solaris était instable.
Unité modeste parmi les centaines de planètes découvertes annuellement, auxquelles les grandes statistiques se bornaient à consacrer quelques lignes définissant les particularités de mouvement, Solaris se haussa peu à peu au rang de corps céleste digne d’une attention plus considérable.
Quatre ans après cette promotion, survolant la planète avec le Laakon et deux vaisseaux auxiliaires, l’expédition d’Ottenskjold entreprit d’étudier Solaris. Cette expédition n’avait que le caractère d’une reconnaissance préparatoire, voire improvisée, les savants n’étant pas équipés pour se poser. Ottenskjold plaça sur orbites équatoriales et polaires une grande quantité de satellites-observatoires automatiques, dont la fonction principale consistait à mesurer les potentiels de gravitation. On étudia en outre la surface de la planète, recouverte d’un océan parsemé d’îles innombrables à configuration de haut plateau. — La superficie totale de ces îles est inférieure à la superficie de l’Europe, bien que le diamètre de Solaris soit d’un cinquième plus grand que celui de la Terre. Ces étendues de territoire rocheux et désolé, irrégulièrement distribuées, sont essentiellement groupées dans l’hémisphère austral. — On analysa également la composition de l’atmosphère, dépourvue d’oxygène, et on effectua des mesures très précises de la densité de la planète, dont on détermina l’albédo ainsi que d’autres caractéristiques astronomiques. Comme il était prévisible, on ne découvrit aucune trace de vie, pas plus sur les îles que dans l’océan.
Au cours des dix années suivantes, Solaris devint le centre d’attraction de tous les observatoires attachés à l’étude de cette région de l’espace ; la planète, cependant, révélait une tendance stupéfiante à conserver une orbite de gravitation qui, sans le moindre doute, aurait dû être instable. L’affaire tourna presque au scandale ; les résultats des observations ne pouvant être qu’inexacts, on tenta d’accabler (pour le bien de la science) tels savants, ou tels ordinateurs dont ils se servaient.
Le manque de crédits retarda de trois ans le départ d’une véritable expédition solariste. Enfin, Shannahan, ayant complété son équipe, obtint de l’Institut trois unités de tonnage C, les plus grands vaisseaux cosmiques de l’époque. Un an et demi avant l’arrivée de l’expédition, qui partit de l’alpha du Verseau, une deuxième flotte d’exploration, agissant au nom de l’Institut, avait placé sur orbite solariste un satelloïde automatique : Luna 247. — Ce satelloïde, après trois reconstructions successives, effectuées à quelques dizaines d’années d’intervalle, fonctionne encore aujourd’hui. — Les données fournies par le satelloïde confirmèrent définitivement les observations de l’expédition Ottenskjold, concernant le caractère actif des mouvements de l’océan.
L’un des vaisseaux de Shannahan demeura sur orbite élevée ; les deux autres, après des essais préliminaires, se posèrent sur un territoire rocheux, de six cents milles carrés environ, dans l’hémisphère austral de Solaris. Les travaux de l’expédition durèrent dix-huit mois et furent effectués dans des conditions favorables, si l’on excepte un accident regrettable provoqué par le fonctionnement défectueux des appareils. L’équipe des savants se divisa cependant en deux camps opposés, l’océan étant l’objet de la querelle. Sur la base des analyses, on avait admis que l’océan était une formation organique (en ce temps-là, personne encore n’avait osé le déclarer vivant). Mais, alors que les biologistes le considéraient comme une formation primitive — une sorte de tout gigantesque, une cellule fluide, unique et monstrueuse (qu’ils appelaient « formation prébiologique »), qui entourait le globe d’une enveloppe colloïdale atteignant par endroits une épaisseur de quelques milles —, les astronomes et les physiciens affirmaient que ce devait être une structure organisée extraordinairement évoluée ; à leur avis, l’océan dépassait peut-être même en complexité les structures organiques terrestres, puisqu’il était capable d’influer efficacement sur le tracé de l’orbite que décrivait la planète. En effet, on n’avait découvert aucune autre cause pouvant expliquer le comportement de Solaris ; de plus, les planétophysiciens avaient établi une relation entre certains processus de l’océan plasmatique et le potentiel de gravitation mesuré localement, potentiel qui se modifiait en accord avec les « transformations de matière » de l’océan.
Ainsi donc, ce furent les physiciens, et non les biologistes, qui avancèrent cette formulation paradoxale, « machine plasmatique », entendant par là une formation peut-être privée de vie, selon nos conceptions, mais capable d’entreprendre des activités utiles — à l’échelle astronomique, il faut s’empresser de l’ajouter.
À l’occasion de cette querelle — dont les remous, en quelques semaines, atteignirent les autorités les plus éminentes — la doctrine de Gamow-Shapley, incontestée depuis quatre-vingts ans, se trouva ébranlée pour la première fois.
Certains continuaient encore à soutenir les affirmations de Gamow-Shapley, à savoir que l’océan n’avait rien de commun avec la vie, que ce n’était pas une formation « para » ou « prébiologique », mais une formation géologique, peu courante assurément, et capable uniquement de stabiliser l’orbite de Solaris, malgré la variation des forces d’attraction ; pour étayer l’argumentation, on s’en référait à la loi de Le Chatelier.
À l’opposé de cette attitude conservatrice, de nouvelles hypothèses étaient avancées — dont celle de Civito-Vitta, l’une des plus élaborées — proclamant que l’océan était le résultat d’un développement dialectique : à partir de sa forme première de préocéan, solution de corps chimiques à réaction lente, et par la force des circonstances (les changements d’orbite menaçant son existence), il était parvenu d’un seul bond au stade d’« océan homéostatique », sans passer par tous les degrés de l’évolution terrestre, évitant les phases unicellulaire et pluricellulaire, l’évolution végétale et animale, la constitution d’un système nerveux et cérébral. Autrement dit, et contrairement aux organismes terrestres, il ne s’était pas adapté à son milieu en quelques centaines de millions d’années, pour donner naissance enfin aux premiers représentants d’une espèce douée de raison, mais il avait immédiatement dominé son milieu.
Le point de vue était original ; pourtant, on ignorait toujours de quelle manière cette enveloppe colloïdale pouvait stabiliser l’orbite du corps céleste. Depuis bientôt un siècle, on connaissait des dispositifs capables de créer artificiellement des champs d’attraction et de gravitation — les graviteurs ; mais nul n’était à même de s’imaginer comment cette glu informe pouvait obtenir un effet, que les graviteurs provoquaient par des réactions nucléaires compliquées et des températures extraordinairement élevées. Les journaux de ce temps-là, attisant la curiosité du lecteur moyen et la colère du savant, regorgeaient de fables les plus invraisemblables sur le thème du « mystère Solaris » ; un chroniqueur alla jusqu’à prétendre que l’océan était … un parent éloigné de nos gymnotes électriques !
Читать дальше