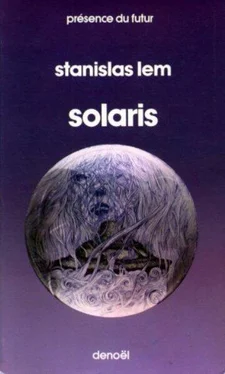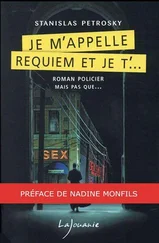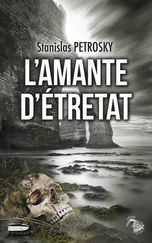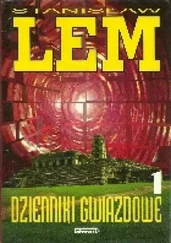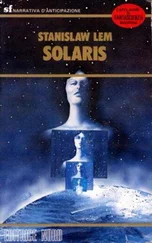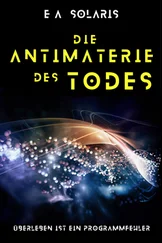Il n’y avait personne. Une fenêtre panoramique concave, à peine plus petite que celle de la cabine où j’avais découvert Snaut, surplombait l’océan, qui luisait ici — au soleil — d’un éclat graisseux, les vagues semblant sécréter une huile rougeâtre. Des reflets écarlates remplissaient toute la chambre, dont la disposition rappelait une cabine de vaisseau. D’un côté, entouré de rayons chargés de livres, un lit mécanique avait été redressé contre la paroi ; de l’autre côté, entre les nombreux placards, étaient accrochés des cadres de nickel — séries de vues aériennes, collées bout à bout au moyen de bandes adhésives — et des râteliers d’éprouvettes et de cornues, bouchées avec des tampons de coton. Devant la fenêtre, deux rangées de boîtes d’émail blanc obstruaient le passage. Je soulevai quelques couvercles ; les boîtes étaient bourrées d’instruments de toute sorte, entremêlés de tuyaux de matière plastique. Dans chaque angle, il y avait un robinet, une installation de réfrigération, un dispositif antibuée. Un microscope avait été posé à même le sol, faute de place sur la grande table à côté de la fenêtre. Me retournant, je vis, près de la porte d’entrée, une haute armoire ; elle était entrebâillée et contenait des combinaisons, des blouses de travail, des tabliers isolants, du linge, des bottes d’exploration planétaire, des bouteilles d’aluminium poli — réservoirs d’oxygène pour appareils portatifs. Deux de ces appareils, munis de leur masque, pendaient, accrochés à la poignée du lit vertical. Partout, c’était le même chaos, un désordre qu’on avait grossièrement, à la hâte, tenté de masquer. Je reniflai l’air ; je sentis une faible odeur de réactifs chimiques et des traces d’odeur plus âcre — du chlore ? Instinctivement, je cherchai les grilles des bouches d’aération, sous le plafond ; attachés aux barreaux, des rubans de papier flottaient doucement ; les souffleries fonctionnaient, assurant une circulation d’air normale. Je débarrassai deux chaises chargées de livres, d’appareils et d’outils que j’allai déposer à l’autre bout de la chambre, les entassant tant bien que mal, de façon à ménager un espace relativement libre autour du lit, entre l’armoire et les bibliothèques. Je tirai à moi un support, pour y suspendre mon scaphandre ; je saisis l’extrémité de la fermeture à glissière, puis je desserrai les doigts. Retenu par l’idée confuse que je me dépouillais d’un bouclier, je ne me décidais pas à abandonner mon scaphandre. Encore une fois, je parcourus des yeux la chambre ; je vérifiai que la porte était bien fermée, qu’elle n’avait pas de serrure et, après une brève hésitation, je traînai vers le seuil quelques-unes des boîtes les plus lourdes. M’étant ainsi provisoirement barricadé, en trois secousses je me libérai de ma carapace cliquetante. Un étroit miroir, enchâssé dans une porte de placard, reflétait une partie de la chambre ; du coin de l’œil, je surpris une forme mouvante ; je sursautai ; mais ce n’était que mon propre reflet. Le tricot, sous le scaphandre, était trempé de sueur. Je le retirai et je poussai une armoire coulissante ; elle glissa le long de la paroi, révélant les murs brillants d’une petite salle de bains. Une caissette plate et allongée reposait au creux du bassin de la douche. Je transportai sans difficulté la caissette dans la chambre. Lorsque je la reposai par terre, un ressort fit sauter le couvercle et je vis des compartiments, remplis d’objets étranges : des ébauches de métal sombre, répliques grotesques des instruments que contenaient les placards. Aucun des instruments de la caissette n’était utilisable ; ils étaient émoussés, atrophiés, fondus, comme sortant d’un brasier. Chose plus étrange encore, même les poignées de céramique, pratiquement non fusibles, avaient été déformées. Aucun four de laboratoire, chauffé à température maximale, n’aurait pu les faire fondre — peut-être une pile atomique. De la poche de mon scaphandre, je sortis un compteur de radiations, mais le petit bec noir resta muet quand je l’approchai des débris.
Je n’avais plus sur le corps qu’un slip et un maillot de filet. Je m’empressai de les retirer, les jetant loin de moi, et je courus sous la douche. Le choc de l’eau fut bienfaisant. Tournoyant sous le jet dur et brûlant, je me frictionnai avec une vigueur excessive, éclaboussant les murs, expulsant, extirpant de ma peau toute cette crasse d’appréhensions troubles qui m’imprégnait depuis mon arrivée.
Je fouillai l’armoire et je trouvai une combinaison d’entraînement, qu’on pouvait également porter sous le scaphandre. Au moment de faire passer dans une poche la totalité de mes maigres biens, je sentis un objet dur, coincé parmi les feuillets du bloc-notes ; c’était une clef, la clef de mon appartement, là-bas, sur la Terre ; indécis, je tournais la clef entre mes doigts. Finalement, je la posai sur la table. Soudain, il me vint à l’esprit que j’aurais besoin d’une arme. Un canif universel n’était sûrement pas ce qu’il me fallait, mais je n’avais rien d’autre et je n’allais pas me mettre à chercher un pistolet radio-actif ou n’importe quoi de ce genre.
Je m’assis sur un tabouret tubulaire, au milieu de l’espace vide. Je voulais être seul. Avec satisfaction, je constatai que je disposais de plus d’une demi-heure ; par nature, je respectais scrupuleusement mes engagements, importants ou négligeables. Les aiguilles de la pendule — dont vingt-quatre signes divisaient le cadran — indiquaient sept heures. Le soleil baissait. Sept heures ici, c’était vingt heures à bord du Prométhée. Solaris, sur les écrans de Moddard, n’était plus qu’une poussière indistincte, confondue avec les étoiles. Bon, que m’importait le Prométhée ? Je fermai les yeux. Je n’entendais que le gémissement des canalisations et un faible clapotis d’eau dans la salle de bains.
Gibarian était mort. Peu de temps auparavant, si j’avais bien compris. Qu’avaient-ils fait de son corps ? L’avaient-ils enseveli ? Non, sur cette planète c’était impossible. Je méditai longuement la question, préoccupé exclusivement par le sort du cadavre ; puis je me rendis compte de l’absurdité de mes pensées, je me levai et me mis à marcher de long en large. Du bout du pied, je heurtai une musette qui émergeait d’un amoncellement de livres ; je me penchai, je la ramassai. Elle contenait un flacon de verre sombre, un flacon si léger qu’il semblait avoir été soufflé dans du papier. Je l’examinai devant la fenêtre, à la lueur pourpre d’un crépuscule lugubre, envahi de brumes de suie. Que m’arrivait-il ? Pourquoi me laisser distraire par des divagations, ou par la première babiole qui me tombait sous la main ?
Je tressaillis ; les lampes s’étaient allumées, commandées par une cellule photoélectrique ; le soleil venait de se coucher. Qu’allait-il se passer ? J’étais si tendu, que la sensation d’un espace vide dans mon dos me devint insupportable. Je décidai de lutter contre moi-même. J’approchai une chaise de la bibliothèque et je choisis un volume qui m’était depuis longtemps familier, le deuxième tome de la vieille monographie d’Hughes et Eugel, Historia Solaris. J’appuyai sur mes genoux le gros livre solidement relié ; je commençai à le feuilleter.
La découverte de Solaris remontait à environ cent ans avant ma naissance.
La planète gravite autour de deux soleils — un soleil rouge et un soleil bleu. Aucun vaisseau ne s’est approché de la planète pendant les quarante ans qui ont suivi sa découverte. À cette époque, la théorie de Gamow-Shapley, affirmant que la vie était impossible sur les planètes satellites de deux corps solaires, était tenue pour une certitude. L’orbite est constamment modifiée par le jeu variable de la gravitation, au cours de la révolution autour des deux soleils.
Читать дальше