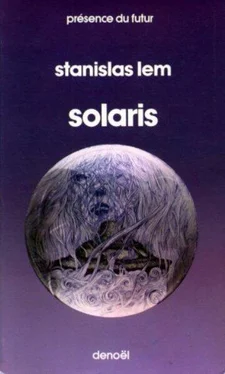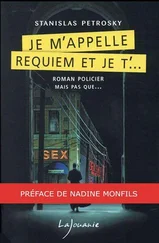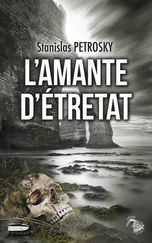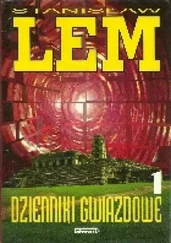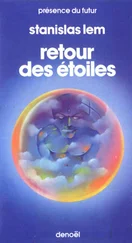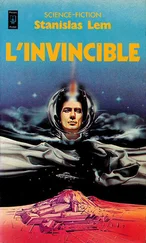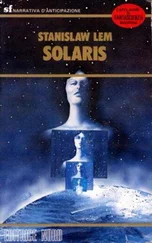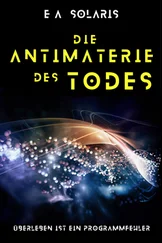Quand, dans une certaine mesure, on réussit à débrouiller le problème, il se révéla que l’explication — ainsi que cela se reproduisit souvent, par la suite, dans le domaine des études solaristes — remplaçait une énigme par une autre, peut-être plus surprenante encore.
Les observations démontrèrent, du moins, que l’océan n’agissait pas selon les lois de nos graviteurs (ce qui, d’ailleurs, eût été impossible), mais réussissait à imposer directement la périodicité de parcours ; il en résultait, entre autres, des écarts dans la mesure du temps sur un seul et même méridien de Solaris. Ainsi donc, non seulement l’océan connaissait, en un certain sens, la théorie d’Einstein-Boevia ; il savait aussi en exploiter les conséquences (alors que nous ne pourrions pas en dire autant).
À l’énoncé de cette hypothèse, l’une des tempêtes les plus violentes du siècle se déchaîna au sein du monde savant. Des théories vénérables, universellement admises, s’effondraient : des articles audacieusement hérétiques envahissaient la littérature spécialisée ; « océan génial » ou « colloïde gravitant », la question enflammait les esprits.
Tout cela se passait plusieurs années avant ma naissance. Quand j’étais étudiant — des données nouvelles ayant été recueillies dans l’entre-temps —, il était déjà généralement admis que la vie existait sur Solaris, bien que se limitant à un unique habitant …
Le deuxième tome d’Hughes et Eugel, que je continuais à feuilleter machinalement, commençait par une systématisation aussi ingénieuse qu’amusante. La table de classification comportait trois définitions : Type — Polythère ; Ordre — Syncytialie ; Catégorie — Métamorphe.
À croire que nous connaissions une infinité d’exemplaires de l’espèce, alors qu’en réalité il n’en existait qu’un seul — pesant, il est vrai, sept cents billions de tonnes.
Sous mes doigts voltigeaient des figures bariolées, des graphiques pittoresques, des relevés d’analyse et des diagrammes spectraux, exposant le type et le rythme des transformations fondamentales ainsi que les réactions chimiques. Rapidement, infailliblement, l’épais volume m’entraînait vers le terrain solide de la foi mathématique. On pouvait en conclure que nous avions acquis une connaissance entière de ce représentant de la catégorie Métamorphe, qui s’étendait à quelques centaines de mètres sous la carène métallique de la Station, voilé en ce moment par les ombres d’une nuit qui durerait quatre heures.
En réalité, tous n’étaient pas encore convaincus que l’océan fût effectivement une « créature » vivante et moins encore, cela va sans dire, qu’il fût doué de raison. Je reposai le gros livre sur le rayon et je pris le volume suivant. Il se divisait en deux parties. La première était consacrée au résumé des tentatives innombrables, qui toutes avaient pour but d’établir un contact avec l’océan. À l’époque de mes études, je m’en souvenais parfaitement, cet établissement de contact était l’objet d’anecdotes, de plaisanteries et de railleries sans fin ; comparée au foisonnement de spéculations suscitées par ce problème, la scolastique médiévale semblait un modèle d’évidences lumineuses. La deuxième partie, près de mille trois cents pages, comprenait uniquement la bibliographie relative au sujet. Les textes n’auraient pu trouver place dans la chambre où je me tenais.
Les premiers essais de contact furent tentés par l’intermédiaire d’appareils électroniques spécialement conçus, qui transformaient les stimuli, émis bilatéralement. L’océan participa activement à ces opérations, puisqu’il façonna les appareils. Tout cela demeurait pourtant obscur. Qu’était exactement cette « participation » ? L’océan modifiait certains éléments des instruments immergés ; par conséquent, le rythme prévu des décharges était bouleversé et les appareils d’enregistrement reproduisaient une multitude de signaux, témoignages fragmentaires de quelque activité fantastique, échappant en fait à toute analyse. Ces données traduisaient-elles un état momentané de stimulation, ou des impulsions constantes, en rapport avec les structures gigantesques que l’océan était en train de créer quelque part, aux antipodes de la région où se trouvaient les chercheurs ? Les appareils électroniques avaient-ils enregistré la manifestation impénétrable des vénérables secrets de cet océan ? Nous avait-il livré ses chefs-d’œuvre ? Comment savoir ! Le stimulus n’avait pas provoqué deux réactions identiques. Tantôt les appareils manquaient d’éclater sous la violence des impulsions, tantôt c’était le silence absolu. En bref, il était impossible d’obtenir la répétition d’aucune manifestation préalablement observée. Constamment, il semblait qu’on fût sur le point de déchiffrer la masse grandissante des indices enregistrés ; n’avait-on pas construit à cette intention des cerveaux électroniques d’une capacité d’information pratiquement illimitée, tels qu’aucun autre problème n’en avait exigé jusqu’alors ? À vrai dire, on obtint des résultats. L’océan, — source d’impulsions électriques, magnétiques, et de gravitation —, s’exprimait dans un langage en quelque sorte mathématique ; aussi, en faisant appel à l’une des branches les plus abstraites de l’analyse, la loi des grands nombres, fut-il possible de classifier certaines fréquences des décharges de courant ; des homologies structurelles apparurent, déjà observées par les physiciens dans le secteur de la science qui prend en considération les rapports réciproques de l’énergie et de la matière, des composants et des composés, du fini et de l’infini. Cette correspondance convainquit les savants qu’ils étaient en présence d’un monstre doué de raison, d’un océan-cerveau protoplasmique, enveloppant toute la planète et gaspillant son temps en considérations théoriques extravagantes sur la réalité universelle ; nos appareils, par surprise, avaient saisi les bribes infimes d’un formidable monologue, qui se déroulait éternellement dans les profondeurs de ce cerveau démesuré et qui, forcément, dépassait notre entendement.
Voilà pour les mathématiciens. Ces hypothèses, selon les uns, sous-estimaient les possibilités de l’esprit humain ; on s’inclinait devant l’inconnu, en proclamant une vieille doctrine, insolemment exhumée, ignoramus et ignorabimus. D’autres pensaient que les hypothèses des mathématiciens n’étaient que radotages stériles et dangereux, car elles contribuaient à créer une mythologie contemporaine, fondée sur le cerveau géant — électronique ou plasmatique, peu importe — considéré en tant qu’objectif ultime de l’existence et somme de vie.
D’autres encore … mais les savants étaient légion et chacun avait son opinion. Si l’on comparait le secteur des essais de « contact » avec les autres branches des études solaristes, où la spécialisation s’était fortement développée, en particulier au cours du dernier quart de siècle, on constatait qu’un solariste-cybernéticien avait peine à se faire entendre d’un solariste-symétriadologiste. Veubeke, directeur de l’Institut au temps de mes études, avait demandé un jour, en plaisantant : « Comment voulez-vous communiquer avec l’océan, alors que vous-même n’arrivez plus à vous comprendre ? » La plaisanterie contenait une bonne part de vérité.
La décision de ranger l’océan dans la catégorie Métamorphe n’avait rien d’arbitraire. Sa surface ondoyante pouvait donner naissance à des formations extrêmement diversifiées, ne ressemblant en rien à ce qu’on voyait sur la Terre, et la fonction — processus d’adaptation, de reconnaissance ou autre — de ces brusques éruptions de « créativité » plasmatique demeurait une énigme.
Читать дальше