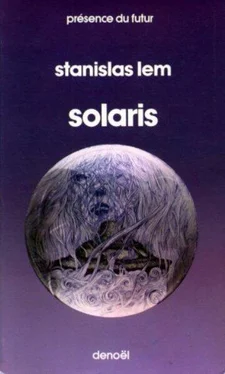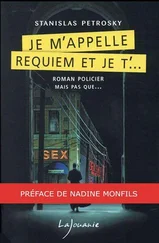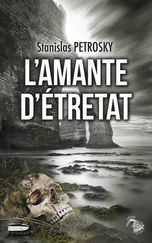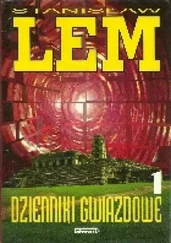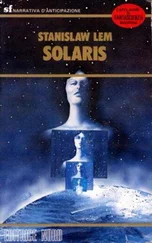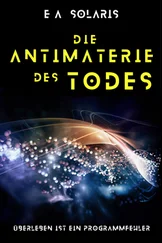Malgré les pas que j’avais entendus s’éloigner, je craignais de retourner chez Gibarian. Elle pouvait revenir. Je demeurai un long moment derrière la porte. Finalement, appuyant sur la poignée, je me forçai à entrer.
Il n’y avait personne dans la chambre. Je me mis à bouleverser les livres éparpillés devant la fenêtre, interrompant un instant mes recherches pour aller fermer l’armoire ; je souffrais de voir la place vide au milieu des combinaisons.
Le supplément n’était pas sous la fenêtre et je me mis à soulever méthodiquement les livres, l’un après l’autre, tout autour de la chambre ; quand j’eus atteint le dernier tas, entre le lit et l’armoire, je découvris le volume que je cherchais.
J’espérais trouver une marque et, en effet, un signet était glissé entre les pages de l’index ; un nom, que je ne connaissais pas, avait été souligné au crayon rouge. André Berton. Les chiffres, en regard du nom, renvoyaient le lecteur à deux chapitres différents. Je jetai un coup d’œil à la première référence et j’appris que Berton était un pilote de réserve du vaisseau de Shannahan.
La référence suivante apparaissait environ cent pages plus loin.
Au début, l’expédition agissait avec une prudence extrême ; puis, seize jours s’étant écoulés, il se révéla que l’océan plasmatique, non seulement ne témoignait aucun signe d’agressivité, mais se dérobait à tout contact direct avec les appareils et les hommes, reculant chaque fois qu’un corps quelconque se rapprochait de sa surface ; aussi, Shannahan et son suppléant, Timolis, renoncèrent-ils à une partie des précautions qui gênaient et retardaient le cours des travaux.
L’expédition se divisa alors en petits groupes de deux ou trois hommes, effectuant des vols au-dessus de l’océan dans un rayon, parfois, de quelques centaines de milles. Les rampes irradiantes, utilisées précédemment pour délimiter et protéger les travaux, furent transportées à la base. Quatre jours passèrent, sans le moindre accident, excepté quelques avaries survenues à l’équipement assurant l’alimentation en oxygène des scaphandres ; l’atmosphère exerçait une action exceptionnellement corrosive sur les valves, qu’il fallut remplacer presque quotidiennement.
Le matin du cinquième jour, c’est-à-dire le vingt et unième jour depuis l’arrivée de l’expédition, deux savants, Carucci et Fechner (le premier était radiobiologiste, le second physicien), partirent en exploration au-dessus de l’océan. Ils naviguaient à bord d’un aéromobile — non pas un véhicule volant, mais un glisseur, se déplaçant sur coussin d’atmosphère comprimée.
Six heures plus tard, les deux explorateurs n’étaient pas de retour. Timolis, qui administrait la base en l’absence de Shannahan, donna l’alerte et organisa les recherches, faisant appel à tous les hommes disponibles.
Par un fatal concours de circonstances, la liaison radio, ce jour-là, avait été coupée une heure après le départ des groupes d’exploration — une grande tache avait obscurci le soleil rouge, qui bombardait les couches supérieures de l’atmosphère d’un tir très dense de particules énergétiques. Seuls les appareils émettant sur ondes ultra-courtes continuaient à fonctionner, limitant les contacts à un rayon de vingt et quelques milles. Pour comble de malchance, le brouillard s’épaissit avant le coucher du soleil et il fallut interrompre les recherches.
Au moment où les équipes de sauvetage rentraient à la base, un hélicoptère découvrit l’aéromobile à quatre-vingts milles à peine du vaisseau de commandement. Le moteur fonctionnait et l’appareil, à première vue non endommagé, se maintenait au-dessus des vagues. Dans la cabine translucide, il n’y avait qu’un seul homme, à demi conscient — Carucci.
L’aéromobile fut convoyé jusqu’à la base. Carucci reçut des soins médicaux et reprit rapidement conscience. Il fut incapable de rien dire au sujet de la disparition de Fechner. Il se souvenait seulement que lui-même avait été pris de suffocation, au moment où ils avaient décidé de rentrer. La valve de son appareil à oxygène s’était désamorcée et des gaz toxiques, en faible quantité, pénétraient à l’intérieur du scaphandre.
Fechner, s’efforçant de réparer l’appareil de Carucci, avait été obligé de décrocher sa ceinture de sécurité et de se lever. C’était la dernière chose que se rappelait Carucci. Selon l’opinion des spécialistes, on pouvait établir la succession des événements. Pour réparer l’appareil de Carucci, Fechner avait ouvert le toit de la cabine, car la coupole basse entravait ses mouvements — procédé admissible, la cabine de ces véhicules n’étant pas hermétique et constituant un simple écran contre les infiltrations atmosphériques et le vent. Pendant que Fechner s’affairait auprès de son compagnon, son propre appareil à oxygène avait sans doute également subi une avarie ; et Fechner, ne sachant plus ce qu’il faisait, s’était hissé au faîte de la carcasse, d’où il était tombé dans l’océan.
Fechner fut donc la première victime de l’océan. On rechercha son corps — le scaphandre aurait dû surnager — sans résultat. D’ailleurs, peut-être le scaphandre surnageait-il quelque part ; l’expédition n’était pas en mesure de fouiller méticuleusement les étendues immenses d’un désert ondoyant, recouvert de lambeaux de brume.
Au crépuscule — je reprends le récit à la fin de ce vingt et unième jour —, tous les véhicules des sauveteurs avaient regagné la base, à l’exception d’un gros hélicoptère ravitailleur, à bord duquel s’était envolé Berton.
L’hélicoptère de Berton reparut une heure après la tombée de la nuit, alors qu’on commençait à sérieusement s’inquiéter. Berton souffrait manifestement de commotion nerveuse ; il se dégagea de son appareil et aussitôt se mit à courir en tous sens comme un forcené ; on le maîtrisa ; il criait et pleurait ; c’était pour le moins stupéfiant de la part d’un homme qui comptait à son actif dix-sept ans de navigation cosmique et qui avait effectué plus d’un vol dans des conditions très pénibles.
Les médecins supposaient que Berton, lui aussi, avait absorbé des gaz toxiques. Cependant, ayant retrouvé un semblant d’équilibre, Berton se refusa à quitter, ne fût-ce qu’un instant, l’intérieur de la base, et même à s’approcher de la fenêtre dominant l’océan. Au bout de deux jours, il demanda l’autorisation de dicter un rapport concernant son vol ; il insistait sur l’importance des révélations qu’il allait faire. Le conseil de l’expédition étudia le rapport et conclut à la création morbide d’un esprit intoxiqué par les gaz nocifs de l’atmosphère ; les prétendues révélations intéressaient, non pas l’histoire de l’expédition, mais le développement de la maladie de Berton ; aussi jugea-t-on superflu de les mentionner.
Voilà ce que racontait le supplément. Je me dis que le rapport de Berton devait en tout cas livrer une clef du mystère — quel événement avait bien pu ébranler à ce point un vétéran des vols spatiaux ? J’entrepris de nouveau de bouleverser les livres, mais le Petit Apocryphe restait introuvable. Je me sentais de plus en plus fatigué ; je remis la suite des recherches au lendemain et je quittai la chambre.
Passant au pied d’un escalier, j’aperçus des taches de lumière répandues du haut en bas des degrés d’aluminium. Sartorius travaillait encore ! Je décidai d’aller le voir.
En haut, il faisait plus chaud. Un faible courant d’air soufflait pourtant et les bandes de papier s’agitaient frénétiquement à la grille des bouches de ventilation. Le couloir était bas et large. Une épaisse plaque de verre dépoli, dans une embrasure de chrome, fermait le laboratoire principal. À l’intérieur, un rideau sombre voilait la porte ; la lumière tombait des fenêtres percées au-dessus du linteau. Je pressai la poignée ; la porte ne céda pas — je l’avais prévu. Aucun autre son ne parvenait du laboratoire qu’un piaulement intermittent — tel le sifflement d’un brûleur à gaz défectueux. Je frappai ; pas de réponse.
Читать дальше