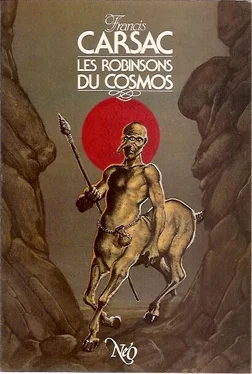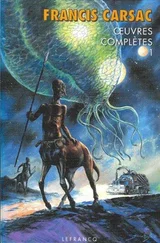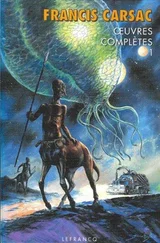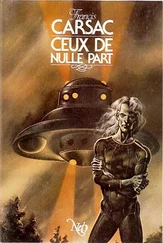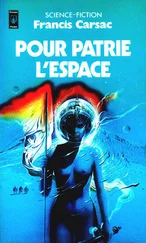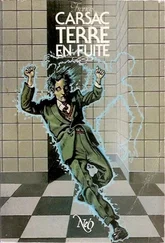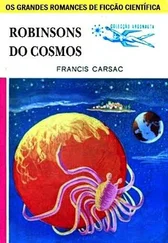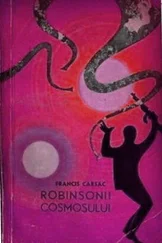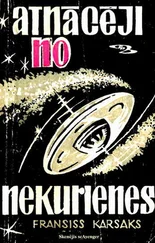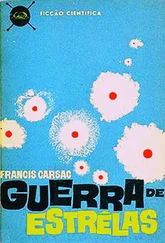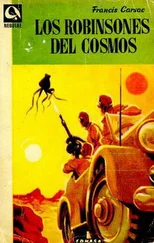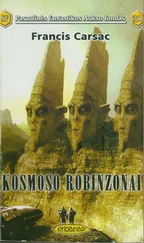— Monseigneur ? interrogea-t-il.
— Eh oui, vous êtes évêque maintenant. Que dis-je ? Pape !
— Mon Dieu, je n’y avais pas pensé ! C’est une terrible responsabilité, ajouta-t-il en pâlissant.
— Bah ! Ça marchera très bien ! »
Je le plantai là tout effaré et rejoignis Louis, installé à l’école. Il était assisté de l’instituteur et de sa femme, tous deux jeunes.
« Ton recensement avance ?
— À peu près. Ce que l’un ne veut pas dire, l’autre le dit pour lui. Voici un décompte provisoire:
2 instituteurs.
2 charrons.
3 maçons.
1 charpentier.
1 apprenti-charpentier.
1 garagiste auto-vélo.
1 curé et un abbé.
1 sacristain.
3 cafetiers.
1 boulanger.
2 mitrons.
2 merciers.
3 épiciers.
1 forgeron et deux aides.
6 carriers.
2 gendarmes.
5 contremaîtres.
350 ouvriers.
5 ingénieurs.
4 astronomes.
1 géologue — toi.
1 chirurgien.
1 médecin.
1 pharmacien.
1 biologiste.
1 historien — ton frère.
1 anthropologue.
1 vétérinaire.
1 horloger T.S.F.
1 tailleur et deux apprentis.
2 couturières.
1 garde-champêtre.
« Les autres sont cultivateurs. Quant au père Boru, il a tenu à se faire recenser comme « braconnier ! Ah ! J’oubliais: un châtelain, son fils, sa fille, sa maîtresse, et au moins douze sbires, sans compter les larbins. Ceux-là ne nous causeront que des em … bêtements !
— Et les ressources matérielles ?
— 11 autos en état de marche, plus celle de ton oncle et la 20 chevaux de Michel, qui consomme trop ; 8 tracteurs, dont un à chenilles ; 18 camions, dont 15 à l’usine ; 10 motos, une centaine de vélos. Malheureusement, seulement 12 000 litres d’essence et 13 600 litres de gas-oil. Assez peu de pneus de rechange.
— Bah, pour l’essence, on les fera marcher au gazogène.
— Et comment les construiras-tu, ces gazogènes ?
— L’usine ?
— Pas d’électricité ! Il y a bien les génératrices de secours, à vapeur. Mais nous avons si peu de charbon — et pas tellement de bois.
— Il y avait de la houille, pas très loin d’ici, dans les montagnes. Elle a dû « suivre ». Difficilement exploitable, certainement. Mais nous n’avons pas le choix.
— Trouve-la. C’est ton travail. Pour les vivres, nous sommes parés, mais il faudra faire attention jusqu’à la récolte prochaine. Il faudra probablement des tickets de rationnement. Je me demande comment nous allons faire accepter cela ! »
Les premières élections sur Tellus eurent lieu le lendemain. Elles se firent sans programme précis: les électeurs furent simplement avertis qu’ils allaient élire un comité de salut public.
Il devait se composer de neuf membres, élus à la majorité relative, chaque électeur votant pour une liste de neuf noms.
Le résultat fut une surprise. Le premier élu, avec 987 voix sur 1 302 votants, fut le premier adjoint au maire, Alfred Charnier, un riche paysan. Le second fut l’instituteur, son cousin éloigné, avec 900 voix, le troisième le curé, avec 890 voix. Puis venaient Louis Maurière, avec 802 voix, Marie Presle, une paysanne instruite, ancienne conseillère, avec 801 voix, mon oncle, 798 voix, Estranges, 780 voix et, à notre étonnement, Michel, avec 706 voix — il était très populaire parmi l’élément féminin ! — et moi-même, avec 700 voix. J’ai su plus tard que Louis avait fait campagne pour moi, disant que je saurais trouver le fer et le charbon nécessaire. À son grand dépit, le principal cafetier n’obtint que 346 voix !
Ce qui nous surpris le plus fut la faible proportion de paysans élus. Peut-être, en ces circonstances étranges, les électeurs se portèrent-ils vers ceux qu’ils croyaient, de par leurs connaissances, capables de tirer parti de tout ; peut-être aussi se méfiaient-ils les uns des autres et avaient-ils préféré élire des hommes étrangers aux querelles du village.
Nous offrîmes donc la présidence à Charnier comme cela s’imposait. Il se récusa et, finalement, elle fut assurée, à tour de rôle, par le curé et l’instituteur. Le soir même, Louis, qui partageait une chambre avec Michel et moi, nous parla comme suit:
« Il faut que nous fassions bloc. Votre oncle marchera avec nous. Je crois que nous pouvons compter sur l’instituteur. Nous serons cinq, c’est-à-dire la majorité. Il nous faudra imposer nos vues, ce qui peut ne pas être toujours facile. Nous aurons l’appui des ouvriers, et même d’un certain nombre de villageois, peut-être des ingénieurs. Ce n’est pas par ambition personnelle que je parle, mais je crois sincèrement que nous sommes les seuls à savoir assez nettement ce qu’il faut faire pour diriger ce fragment de monde.
— En fait, dit Michel, tu nous proposes une dictature ?
— Une dictature ? Non, mais un gouvernement fort.
— Je ne vois pas très bien la différence, dis-je, mais je pense que c’est nécessaire, en effet. Nous aurons de l’opposition …
— Le curé … commença Michel.
— Pas nécessairement, coupa Louis. Il est intelligent, et comme nous laisserons complètement de côté la question religieuse … Nous pouvons même le prendre avec nous. Les paysans ? Ils auront autant de terre qu’ils pourront en cultiver. Il n’y a rien, dans le collectivisme très modéré que j’envisage, limité aux industries, qui puisse les inquiéter. Non, les difficultés viendront plutôt de l’esprit routinier. Tout au moins pour le proche avenir. Plus tard, dans quelques générations, le problème pourra être tout autre. Aujourd’hui, il s’agit de vivre. Et si nous commençons à nous manger le foie ou à laisser le désordre s’établir …
— Soit, je marche.
— Moi aussi, dit Michel. Si l’on m’avait prédit que je ferais parti un jour d’un directoire ! »
La première réunion du Conseil fut consacrée à la distribution des « portefeuilles ».
« Commençons par l’Éducation nationale, dit Michel. Je propose que M. Bournat soit notre ministre. Nous ne devons, à aucun prix, laisser perdre notre héritage. Chacun de nous, les « savants », devra choisir parmi les élèves de l’école ceux qui nous paraîtront les plus aptes. Nous leur enseignerons d’abord le côté pratique de nos sciences respectives. Le côté théorique sera enseigné aux sujets d’élite, s’il s’en trouve. Il nous faudra aussi composer des livres, pour compléter la bibliothèque de l’observatoire, heureusement vaste et éclectique, et celle de l’école.
— Très bien, dit Louis. Je propose l’industrie pour M. Estranges, l’Agriculture pour M. Charnier. Toi, Jean, tu prends les Mines, poste très important. M. le curé aura la Justice de paix, M. l’instituteur les Finances, puisque l’étude de l’économie politique était son passe-temps. Il faut maintenir une monnaie, un moyen d’échanges quelconque.
— Et moi ? demanda Michel.
— Toi, tu prendras la Police.
— Moi, flic ?
— Oui. Tu auras un poste difficile: recensements, réquisitions, ordre public, etc. Tu es populaire, cela t’aidera.
— Je ne le resterai pas longtemps ! Et toi, que prends-tu ?
— Attends. Marie Presle s’occupera de la Santé publique, assistée par le docteur Massacre et le docteur Julien. Pour moi, je prends, si vous le voulez bien, l’Armée.
— L’Armée ? Pourquoi pas la Flotte ?
— Qui sait ce que cette planète nous réserve ? Et je serai bien étonné si le sinistre individu du château ne fait pas bientôt des siennes ! »
Louis ne croyait pas si bien dire. Le lendemain, une affiche, imprimée, était collée en multiples exemplaires sur nos murs. Elle portait:
Читать дальше