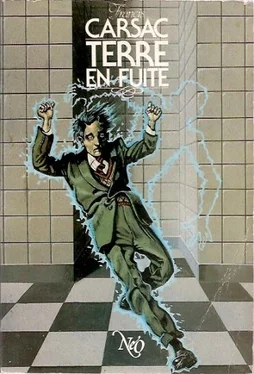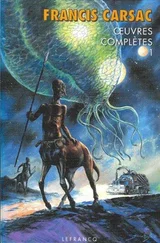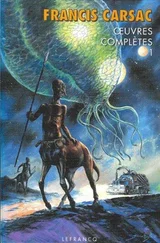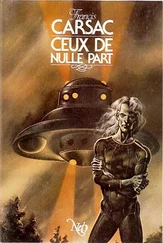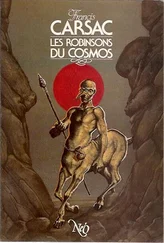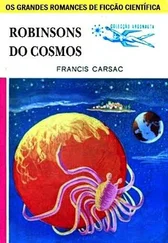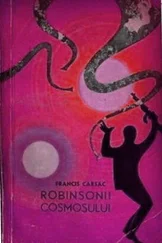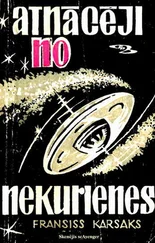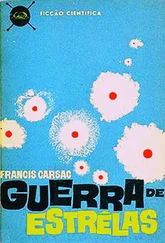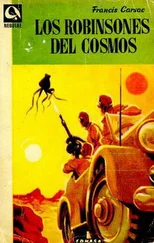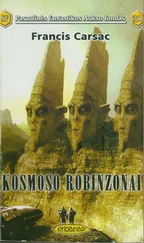Francis Carsac
Terre en fuite
À Delp hyr Orikan
aussi bien qu’à
Nicholas van Rijn.
Série « Fantastique/Science-fiction/Aventure »
dirigée par Hélène Oswald
Couverture illustrée
par Jean-Michel Nicollet
Maquette : Studios Knack/NéO
ISBN : 2-7304-0508-9
© NéO — SocoInvest 1988
5, rue Cochin, 75005 PARIS
Francis Carsac : au-delà du mythe
PREMIÈRE PARTIE
LE NAUFRAGÉ DU TEMPS
CHAPITRE PREMIER
L’ÉTRANGE ACCIDENT
Je saisbien que personne ne croira ce que je vais écrire. Et pourtant nul autre que moi n’est aujourd’hui capable d’apporter quelque lumière sur l’étrange personnalité de Haurk, je veux dire de Paul Dupont, le physicien le plus doué qui ait jamais vécu sur notre planète. Comme on sait, il est mort il y a onze ans, dans un accident de laboratoire, avec sa jeune femme Anne. Par testament, il m’a institué le tuteur de son fils Jean, et a fait de moi son exécuteur, car il était sans famille. Je suis donc en possession de tous ses papiers, de toutes ses notes inédites. Mais hélas, elles ne pourront jamais être utilisées, à moins que ne se révèle un Champollion doublé d’un Einstein. Et j’ai aussi le manuscrit que vous allez lire, écrit, lui, en français.
Je connaissais Paul Dupont depuis sa naissance, pourrait-on dire, car je suis un peu plus âgé que lui, et nous habitions la même maison de la rue Émile Zola à Périgueux, maison démolie depuis. Nos familles étaient amies, et, aussi loin que remontent mes souvenirs, je me vois jouant avec lui dans le petit jardin commun aux deux appartements. Nous allâmes en classe ensemble, et restâmes sur le même banc depuis la classe enfantine jusqu’au premier baccalauréat. Puis j’optai pour la section Sciences expérimentales, tandis que, selon la volonté de son père, il optait pour la classe de Mathématiques élémentaires. Je dis selon la volonté de son père, ingénieur électricien, car, aussi curieux que cela puisse paraître pour un homme qui a révolutionné la physique, il n’était pas extrêmement fort en math, et dut travailler dur pour passer son deuxième baccalauréat.
Ses parents moururent à peu d’intervalle pendant que nous étions ensemble à Bordeaux, où je préparais ma licence de Sciences naturelles pendant qu’il était en Taupe. Il entra ensuite à l’école supérieure d’Électricité, et partit comme ingénieur dans une centrale hydroélectrique des Alpes, dont le directeur était un ancien ami de son père. Pendant ce temps, je préparais mon doctorat. À vrai dire, il fit rapidement son chemin, puisque, à l’époque où lui arriva l’étrange accident qui devait bouleverser sa vie, il était déjà sous-directeur. Nous n’échangions que de rares lettres. Mon poste de chef de travaux à la Faculté des sciences de Toulouse me tenait éloigné des Alpes, et, pendant les vacances, mon terrain se trouvait en Afrique occidentale. C’est par un pur hasard que je fus témoin de l’accident. On projetait de construite un autre barrage dans la vallée voisine, et j’y allai avec le professeur Maraud pour étudier l’implantation au point de vue géologique. Me trouvant ainsi à quarante kilomètres de la centrale où travaillait Paul, j’en profitai pour lui rendre visite. Il me reçut avec une joie visible, et nous bavardâmes longuement, le soir, rappelant nos souvenirs communs de potaches et d’étudiants. Il me parla aussi de son travail, qui l’intéressait, de la centrale projetée, et même d’une aventure sentimentale qu’il avait eue récemment, et qui avait tourné court. Il ne m’entretint nullement, j’insiste sur ce point, de physique rhétorique. Bien qu’assez froid d’abord et méfiant, il était agréable à fréquenter quand il se sentait en confiance, mais je crois pouvoir dire que j’étais son seul ami intime. Il est pour moi hors de doute que si, à cette époque, il avait poursuivi déjà les recherches qui devaient l’immortaliser, il me l’aurait indiqué, ne serait-ce qu’à mots couverts. Le lendemain matin, j’eus l’occasion de le voir feuilleter ses notes, et bien que je ne sois nullement mathématicien, je puis affirmer que celles-ci ne dépassaient pas le niveau d’un bon ingénieur électricien.
J’étais arrivé chez lui le lundi 12 août, et comptais repartir le surlendemain. Mais il insista pour que je reste toute la semaine avec lui. L’accident se produisit dans la nuit du vendredi au samedi, à vingt-trois heures quarante-cinq exactement.
La journée avait été d’une chaleur étouffante. J’occupai mon après-midi, sous un ormeau qui ombrageait le petit jardin de sa maison, à mettre au clair mes notes géologiques. Vers cinq heures, le tonnerre se mit à gronder, loin à l’est. Les nuages envahirent rapidement le ciel, et à sept heures la nuit était totale, et l’orage se déchaînait sur la montagne. Paul arriva une demi-heure plus tard, sous une pluie diluvienne, et je crus comprendre que les dispositifs parafoudre lui donnaient quelques soucis. Nous dînâmes presque en silence, et il s’excusa auprès de moi, disant qu’il lui faudrait passer la nuit à la centrale. Vers huit heures et demie, je l’aidai à enfiler son imperméable mouillé, puis montai dans ma chambre. Je l’entendis partir en auto.
À dix heures, je me couchai et m’endormis. Je dormis mal. Malgré l’averse de sept heures, la chaleur était toujours extrême, et l’air qui pénétrait par la fenêtre ouverte me rappelait celui du Sénégal. Je fus réveillé en sursaut par un coup de tonnerre d’une violence extraordinaire. Il était alors vingt-trois heures trente. Il ne pleuvait pas encore, mais les éclairs continuels illuminaient une déroute de nuages noirâtres, effilochés par le vent. La maison de Paul dominait la vallée, et je pus voir par trois fois la foudre tomber sur les pylônes, juste devant la sortie de la centrale. Un peu inquiet, je pensai à téléphoner pour avoir de ses nouvelles, mais j’y renonçai, ne voulant pas le déranger à un moment où il devait avoir besoin de tout son temps. Je regardai par la fenêtre, admirant le magnifique spectacle. Cet orage dépassait en violence tout ce que j’avais pu voir en France, et ne se laissait comparer qu’à ceux de la zone tropicale.
Soudain, droit sur la centrale descendit une langue de feu violet. Ce n’était pas cette fois un coup de foudre, mais, à une échelle immense, comme une décharge électrique dans un gaz raréfié. La fantastique colonne de feu montait vers le ciel et se perdait dans les nuages, parcourue de palpitations comme un tube à luminescence déréglé. Le phénomène dura une dizaine de secondes, pendant que crépitait, au lieu du violent et sec coup de tonnerre habituel, un bruit de soie froissée. Comme halluciné, je regardais. Au moment même où la colonne avait touché le toit de la centrale, toutes les lumières s’étaient éteintes, et, dans la clarté livide, la vallée se remplit d’ombres mouvantes. Puis le phénomène cessa, et la nuit totale ne fut plus illuminée que par des éclairs ordinaires. Une pluie torrentielle croula, noyant tous les sons sous son bruit de cataracte. Je restai là, abasourdi, un bon quart d’heure.
La sonnerie du téléphone me tira de ma torpeur. Je bondis jusqu’au bureau de Paul, décrochai l’appareil. On m’appelait de la centrale, et je reconnus la voix du jeune ingénieur stagiaire. Paul avait eu un « accident » et je devais venir immédiatement, en prenant au passage le docteur Prunières, qu’ils n’avaient pu joindre, le réseau ordinaire ne fonctionnant plus. La maison de Paul était reliée à la centrale par un téléphone spécial.
Читать дальше