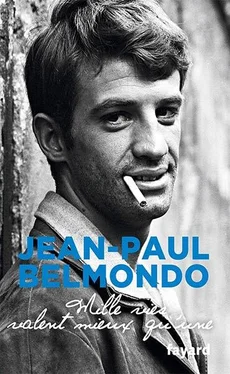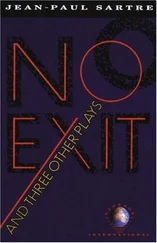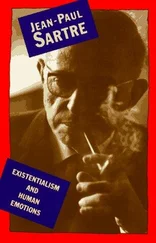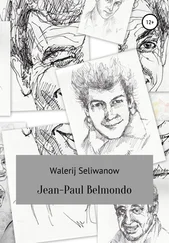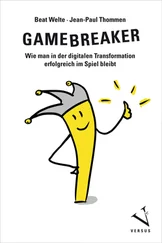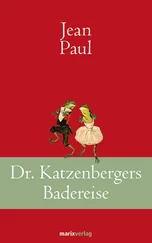Elle devait se méfier des dénonciations ; elle avait raison. Par ces temps troublés, rien n’était jamais sûr et la confiance s’accordait avec une prudence qu’on aurait, en d’autres circonstances, qualifiée de « délire paranoïaque ».
Les grands arbres touffus de la forêt de Clairefontaine ne nous sauvaient pas de tout. Nous avions tous le même ciel, qui avait viré au gris-noir-sang, au-dessus de nos têtes — et, dedans, des avions se battaient. Les Alliés et les Allemands se trouvaient dans une arène aérienne, et nous dans les gradins, en dessous.
Papa avait été fait prisonnier. Cela avait certainement inquiété Maman, mais elle n’avait montré aucun signe d’anxiété, s’obstinant à demeurer gaie et enthousiaste.
Heureusement, Paul Belmondo n’était pas homme à se résigner ou à rester passif devant le cours des événements. Il a programmé et exécuté son évasion grâce à l’aide de Valentin, un chic type qui disposait du camion d’une entreprise de maçonnerie. Ils ont réussi à rentrer, comme ça, en France, à Paris.
Et l’aventure les a si fortement liés qu’ils n’ont jamais cessé de se voir, jusqu’à la mort de mon père le 1 er janvier 1982.
La magie de la réapparition de mon père, maigre et les yeux brillants après cette longue absence, a fait forte impression sur moi. Ma mère exultait, le bonheur était complet. Même si, dès le lendemain, il a fallu se résoudre à le laisser repartir pour se cacher, puis à être privés de lui jusqu’à la Libération. Mais, grâce à ce court intermède, mon frère Alain et moi avons gagné une petite sœur, Muriel, née neuf mois plus tard !
Et la famille a hérité d’une artiste de plus : elle est devenue danseuse, intégrée aux ballets de Nancy et d’Angers, puis professeur au conservatoire de l’Opéra de Paris. Une nuit avait suffi pour un troisième enfant. Mes parents ne plaisantaient pas quand il s’agissait d’aimer.
Après son départ, Maman, enceinte, doit faire face aux difficultés quotidiennes provoquées par la guerre. Obligée de se passer de Papa.
Bien plus tard, lorsqu’il nous quittera, elle sera contrainte de vivre à nouveau sans lui. Mais, fidèle à sa force, à son tempérament optimiste, qui va de l’avant sans remâcher indéfiniment le passé, elle continuera de profiter des choses, de s’y ouvrir.
*
Comme elle n’avait pas pu voyager avec mon père, dont le travail de sculpteur n’était pas transportable, elle le fera avec moi, une fois qu’il ne sera plus là.
Entre deux tournages, dès que j’aurai assez de temps, je l’emmènerai dans un pays lointain. À chaque fois, avec le même enchantement de la voir, bouillonnante et riante, mue par une insatiable curiosité, prête à tout découvrir, tout connaître. Les contrées exotiques, très froides comme l’Alaska, ou très chaudes comme les Caraïbes, l’émerveilleront plus que les autres.
Dans son cas, les années n’ont jamais paru un poids sous lequel se rabougrir. La vieillesse n’a pas corrompu son élan vital, ni érodé sa diabolique énergie. Elle aimait trop la vitesse et l’intensité.
Et, contrairement à la plupart de ceux qui se sont aventurés sur le siège passager des voitures, souvent sportives, dont j’ai honoré la puissance des moteurs en roulant à tombeau ouvert, Maman réclamait que j’accélère encore. Elle appréciait ces pointes grisantes. L’aiguille au compteur indiquait les 200 kilomètres à l’heure, ce qui à moi semblait être une allure convenable, mais pas à elle. Alors j’appuyais sur le champignon et gagnais 10 kilomètres de plus, trop heureux d’exaucer son vœu d’excès, de me rendre complice de ses hardiesses. Elle exultait et moi, je riais.
Quand, après elle, un copain normalement timoré montait à bord de l’un de mes bolides et que, après une légère poussée de l’engin, il ne tardait pas à regretter le copieux repas ingurgité juste avant, se mettait à hoqueter, le visage blanc avec des halos jaunes, à prier tous les saints, même ceux qui n’existent pas, à me supplier de lui laisser la vie sauve, je rendais un hommage intérieur, mais grandiloquent, à l’extrême noblesse de ma mère.
J’aurais fait n’importe quoi pour lui faire plaisir et, comme j’avais un certain talent pour le n’importe quoi, elle était souvent heureuse.
Même quand, âgée, elle a perdu la vue et a été privée de nos excursions dans les pays étrangers et de nos rallyes improvisés sur les routes de France — à l’époque vierges de radars et de gendarmes mobiles —, elle a continué de voyager en souriant. Je lui rendais visite et lui lisais des romans. En mettant le ton, comme il est coutume de dire.
J’avoue avoir peut-être un peu exagéré dans ma façon de jouer avec ma voix pour reconstituer les images devant elle. Le jeune élève du Conservatoire qui, habitué à l’amplitude des théâtres, parlait trop fort les premières fois sur les plateaux de cinéma, revivait pour elle.
Je voudrais qu’elle entende ces lignes de ma bouche. Et qu’elle revienne là-bas, à Clairefontaine, avec moi.
Le ciel grouille d’avions, de traces blanches et d’éclairs. Comme une scène de ménage entre des dieux qui se disputeraient le droit de rester dans les nuées. C’est à la fois fascinant et terrifiant à regarder.
Un château d’eau monumental, visible depuis les airs, se dresse à quelques kilomètres à peine de notre maison de Clairefontaine et sert de point de repère, d’un côté à des avions allemands à l’assaut de forteresses volantes, de l’autre aux bombardiers américains en chemin pour Berlin.
Il n’est alors pas rare que les Allemands infligent une défaite à nos amis, se traduisant par un redoutable piqué tournoyant suivi d’un crash, souvent fatal, dans la forêt de Rambouillet.
J’aime jouer à l’aventurier et j’espère de tout mon cœur que le hasard conduira un jour mon vélo jusqu’à l’un de ces héros blessés, certainement coincé dans la carcasse de son avion à moitié carbonisé. Je pourrais alors, à mon tour, faire acte de bravoure et lui sauver la vie en l’extrayant de son tombeau d’acier, puis en le soignant et en l’approvisionnant chaque jour, dans un abri dissimulé que je lui aurais construit avec des branchages et des fougères. Ses forces revenant progressivement, il serait bientôt assez requinqué pour parler et me raconter tous ses exploits. Plus tard, quand il aurait recouvré complètement la santé, il pourrait même m’apprendre à piloter et à me servir d’un pistolet automatique, d’un revolver et d’un fusil mitrailleur. Nous deviendrions amis et il réclamerait qu’on m’accorde, quand la guerre serait finie, une médaille outre-Atlantique pour l’avoir sauvé d’une fin atroce. Mes parents seraient ivres de fierté et je pourrais dire, tel un Guillaumet en culottes courtes à Saint-Exupéry : « Ce que j’ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait. »
Las, je n’aurai jamais la chance de croiser un pilote américain de son vivant. La Providence n’est pas toujours très conciliante. Les pilotes tombés dans les bois disparaissent avant que j’aie le temps de les trouver, secourus par d’autres héros qui, il convient de le reconnaître, sont, eux, de vrais professionnels.
Les résistants ont l’habitude des opérations de sauvetage : ils ont vite fait d’exfiltrer l’Américain et de le mettre en sécurité quelque part dans une planque. Avant de l’emmener, ils prennent soin de nettoyer le lieu de la chute, au point que, hormis quelques branches cassées et buissons à moitié brûlés, il ne demeure aucune trace de l’incident.
Parfois, il reste quelques douilles oubliées sur le sol, à moitié recouvertes. Je les cherche entre les feuilles, la terre ou les pierres. Je les garde ensuite comme des trésors de guerre, avec lesquels j’imagine la vie de ces braves qui combattent dans l’ombre pour la libération de la France.
Читать дальше