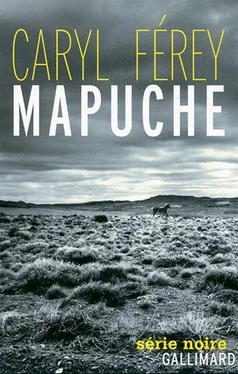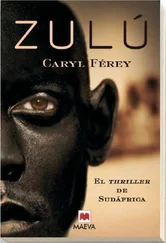On était loin des Pistols.
Rubén grimpa à l’étage — il y avait un bar à l’air libre et les dorures lui tapaient sur le système — mais ce ne fut pas mieux : deux murs d’enceintes crachaient une techno house tonitruante, chassant les touristes vers les bancs du pont supérieur. Avait-on peur à ce point que les gens s’ennuient ? En croyant remplir les temps morts, on créait des espaces vides ; loin des basses qui continuaient de vider le pont, Rubén trouva un endroit à peu près tranquille à la poupe du navire et fuma accoudé au bastingage, le regard perdu sur l’eau terreuse qui grumelait des hélices. Les grues du port de commerce surveillaient les containers tandis qu’ils prenaient le large. Un trois-mâts rutilant revenait vers la marina, il pensait toujours à Jana, à son odeur dans ses bras, à ce qui l’avait poussé à l’embrasser dans la cour. La Mapuche avait surgi du néant : pour quoi sinon y retourner ? Âge, origines sociales, ethniques, tout les séparait. L’ardeur de leur baiser à l’aube trahissait un profond et commun désespoir, qu’il ne se sentait pas de taille à affronter. C’était trop tard de toute façon, trop tard pour tout… Le vent fraîchit sous le soleil du large. La pollution faisait une bande grise au-dessus de la désormais lointaine Buenos Aires, vaisseau fumant sous le crachat des usines de banlieue ; Rubén oublia la jeune Indienne et l’onde des vagues qui couraient sous la houle.
Anita avait réuni des infos précises concernant l’adresse de Colonia et l’aller-retour effectué par Maria trois jours avant sa disparition : José Ossario, l’homme qui résidait au numéro 69 de la rue Ituzaingó, ne figurait pas dans l’annuaire, mais Anita avait retrouvé la trace de sa voiture dans les fichiers de la police routière — une Honda blanche immatriculée à Colonia del Sacramento. La suite se trouvait sur Internet.
De nationalité argentine, José Ossario avait d’abord travaillé pour différentes revues de science-fiction avant de publier un premier livre, en 1992, La Face cachée du monde , fatras de scientisme sur fond de théories du complot mêlant espionnage, astrologie et paranoïa aiguë. José Ossario y élaborait sa propre vérité, délirante, convaincue, gagnant en notoriété dans les cercles d’initiés. Il avait par la suite travaillé comme paparazzi, avant de monter plusieurs agences de presse au destin invariable : impayés, exercices comptables farfelus, dépôts de bilan, arnaques diverses… Expert en chantage et en extorsion de scoops, Ossario était passé entre les gouttes jusqu’en 2004 et la parution d’une série de photos mettant en scène l’ancien directeur de cabinet de Menem, Rodrigo Campès, et la fille du principal dirigeant syndicaliste du pays, en tenue légère sur la plage de Punta del Este, où les amants séjournaient dans la suite d’un palace — dont personne visiblement ne payait la note. L’affaire défrayant la chronique, Ossario avait cru son heure de gloire arrivée avant de retomber sur Terre. N’en étant pas à ses premiers démêlés avec la justice, enseveli sous les frais de dossiers et d’avocats, blacklisté, José Ossario avait fini par jeter l’éponge. Aucune nouvelle depuis son exil en Uruguay, trois ans plus tôt, excepté un livre, Contrevérités , un récit choc tiré à mille exemplaires chez un petit éditeur de Montevideo, qui n’avait rencontré pour public qu’un mur de silence. À présent âgé de cinquante et un ans, l’ancien paparazzi résidait au numéro 69 de la rue Ituzaingó, seul visiblement…
Rubén écrasa sa cigarette sur le pont métallique.
On arrivait à Colonia.
*
À l’instar du Brésil, l’amnistie pour les bourreaux de la dictature avait assuré la transition démocratique en Uruguay. De récentes avancées laissaient entrevoir le bout du tunnel mais le pays semblait vivre au ralenti, comme si l’occultation du passé avait figé le présent dans la cire.
Colonia del Sacramento, l’ancienne capitale coloniale du pays, ne dérogeait pas à la somnolence ambiante. Vieilles bâtisses à l’abandon, lampadaires 1900, ruines aux balcons perclus de rouille, Ford cabossées des années 50, « Rambler », « American », et d’antiques Fiat 500 qui prenaient le frais sous les orangers : si le décorum rappelait le charme désuet de la Belle Époque, les magasins de souvenirs collectionnaient les horreurs manufacturées — porcelaines, vêtements, artisanat, tout était d’un mauvais goût congestionnant. Rubén longea les rues pavées à l’ombre des palmiers et déboucha sur la Plaza Mayor .
Des moineaux pépiaient sous l’arrosoir tournant des pelouses impeccables, les perruches bariolées perchées à l’arbre centenaire traversaient le ciel pour de brefs flirts avec le vent ; seuls quelques vieux somnolaient sur un banc à l’heure où le soleil étouffait tout. José Ossario habitait un peu plus loin, au bout d’une ruelle bétonnée qui donnait sur la mer.
Ituzaingó 69. Le soleil réverbérait contre le mur d’enceinte, cachant une maison au toit plat presque invisible depuis la rue. Rubén sonna à l’interphone, repéra la caméra de surveillance au-dessus de la grille blindée, réitéra son appel, sans obtenir de réponse. Il recula pour ouvrir son angle de vue, mais le mur ne laissait poindre qu’un bout de façade blanchie à la chaux et deux volets fermés. Il jeta un œil par les interstices de la grille, aperçut un jardin aux fleurs fatiguées et d’autres volets clos, au rez-de-chaussée… La ruelle était vide, la chaleur comme une enclume sur le trottoir, quand Rubén sentit une présence près de lui.
Quelqu’un l’observait depuis la haie voisine : un homme chétif et dégarni d’environ soixante-dix ans, de petits yeux bleu pâle enfoncés dans un visage cerné, soucieux.
— Vous cherchez quelque chose ? demanda-t-il.
Rubén désigna la maison de l’ancien paparazzi.
— José Ossario, c’est bien ici qu’il habite ?
— Oui.
Le voisin portait des lunettes discrètes, un polo et un short laissant entrevoir des jambes blanches et glabres. Rubén approcha de la haie.
— Vous savez depuis quand il est absent ?
Le petit homme haussa les épaules.
— Plusieurs jours, je crois. (Il le jaugea d’un air curieux.) Vous êtes argentin, n’est-ce pas ?
L’accent de Rubén ne laissait pas de doute.
— Martin Sanchez, se présenta-t-il. Oui, je viens de Buenos Aires.
— Franco Diaz, sourit le voisin derrière le grillage. Botaniste à la retraite… Vous cherchez M. Ossario ? demanda-t-il d’un air engageant.
— Oui. Je travaille pour une agence de recouvrements, mentit Rubén. C’est une histoire un peu compliquée, et… disons urgente.
— Ah ? (Diaz hésita, le sécateur à la main, une lueur d’intérêt dans ses petits yeux rapprochés.) Mais vous devez avoir chaud sous ce soleil, dit-il comme s’il manquait à tous ses devoirs. Entrez donc boire une orangeade, ajouta-t-il avec prévenance, nous serons mieux pour discuter… Vous aimez les fleurs ?
Les coquelicots.
Le septuagénaire ouvrit la grille, ergotant sur le retour du soleil après le coup de vent des précédents jours. Franco Diaz vivait seul dans une maison de bord de mer où il semblait couler la plus paisible des retraites : botaniste émérite — contrairement à celui de son voisin, son jardin était splendide —, il avait installé une mare à nénuphars sur le toit-terrasse de l’ancienne posada , d’où l’on pouvait contempler le río . Une petite crique s’étendait en contrebas, à l’ombre d’un saule pleureur, une plage de terre jonchée de plastiques charriés par les eaux du fleuve. Rubén accepta une boisson fraîche en écoutant le retraité vanter la rareté de ses fleurs, avant d’aborder le sujet qui l’intéressait.
Читать дальше