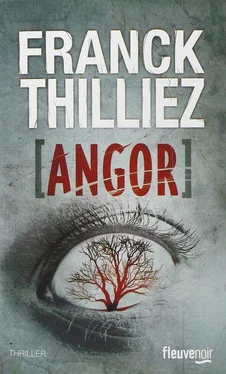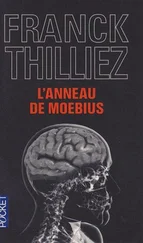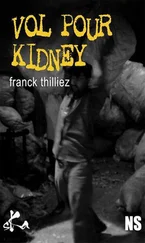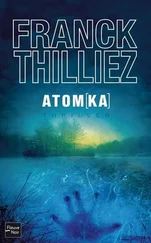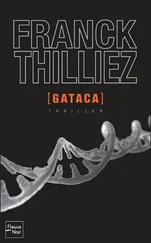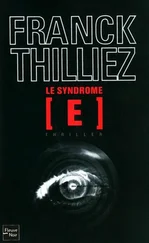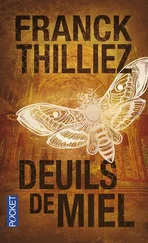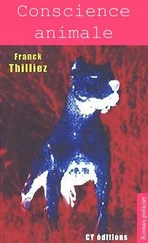— Elle m’avait reconnu, mais elle était terrorisée. Elle ne voulait pas parler ni aller à la police, elle avait trop peur. Il y avait des gens extrêmement puissants à l’origine du trafic d’organes. Elle disait qu’elle devait emmener l’homme loin de l’hôpital, de Torres, et s’arranger pour qu’on ne le retrouve jamais. Je l’ai priée de témoigner, je lui ai dit qu’on y arriverait, cette fois, mais elle était sous le choc. Elle disait qu’il n’y avait pas de solution. (Il soupira avec regrets.) Alors, je l’ai aidée à traverser les marais et l’ai laissée partir. Je me disais que j’y arriverais, même sans elle, que j’avais assez de preuves. J’ai recontacté Vidal, sans citer Florencia, je ne pouvais pas l’impliquer. On s’est vus secrètement. J’ai parlé de la clinique Calderón, du trafic de reins et de cornées, du transport des cadavres dans les marécages. J’ai montré mes photos. Vidal semblait partant, il devait réveiller son « circuit ». Mais… (Il eut un long regard vague. Sa main droite tomba sur le drap et remonta le haut de sa cuisse coupée.) On l’a retrouvé mort, « suicidé » dans sa baignoire. Le soir même, on m’a enlevé, soûlé au whisky. Je me suis réveillé à l’hôpital, après trois mois de coma. D’après la version officielle, ma voiture s’était écrasée au fond d’un ravin, à cent cinquante kilomètres de Buenos Aires. L’enquête n’avait abouti à rien. J’ai perdu mes jambes mais j’ai survécu, par je ne sais quel miracle. La Colonia était en train de fermer ses portes suite à « l’incendie ». Plus tard, des gens sont venus me voir, ils m’ont dit que, si je l’ouvrais, ils me troueraient le corps de balles. À moi, ma sœur, mes parents… Ils viennent ici, de temps en temps, me rendre une petite visite de « courtoisie », mais comme l’affaire est loin désormais, ils ne me font pas de mal. Ils lancent juste des menaces.
— Ils vont venir ici. Je peux vous emmener avec moi. On…
— Non, laissez, je me débrouillerai. Laissez-moi terminer… Calderón fermera sa clinique quelques mois plus tard et disparaîtra du territoire, de même que Belgrano. J’ai toujours ignoré où Calderón se trouvait, jusqu’à ce que Mickaël Florès débarque ici et m’annonce que Calderón s’était rendu dans les pays de l’Est, pour participer à un autre trafic d’organes.
— Florès traquait Calderón, donc ?
— Traquer n’est pas le mot exact. Florès s’intéressait au trafic d’organes, il pensait que c’était l’une des pires dérives de notre espèce. Un commerce de l’extrême, qui détruisait tout ce qui faisait de nous des êtres humains. « Imaginez si les greffes d’organes avaient été possibles à l’époque de Hitler », qu’il disait. Quand il a entendu parler de la Maison jaune, de la clinique Medicus, il s’est lancé sur le sujet. Une fois là-bas, il a trouvé intéressant de creuser le parcours de Calderón, de remonter aux origines, de comprendre qui était l’homme. Il a alors découvert que Calderón avait été ophtalmologue à Corrientes. Il a continué à chercher et a appris l’existence du vieux dossier de l’affaire Giubiléo. C’est ainsi que Mickaël Florès est venu à moi… Et, quand je l’ai vu…
Il ouvrit ses mains devant lui.
— … j’ai cru rêver.
— Pourquoi ? demanda Sharko.
— Parce que j’avais l’impression d’avoir, à quelques détails près, Enzo Belgrano en face de moi.
Nicolas avait foncé pour rejoindre la rue Agar, rive droite de la Seine, dans les beaux quartiers de Paris.
Il se gara du côté non autorisé et traversa en courant, direction un immeuble style Art nouveau en pierre de taille blanche, grandes fenêtres cintrées surmontées de mascarons. Le concierge vint à sa rencontre et s’effaça devant la carte de police et la détermination du flic, qui s’engouffra dans la cage d’escalier. Il grimpa les marches en marbre deux à deux, cogna à la porte du poing, ne fonctionnant plus qu’à l’adrénaline et à la colère. Quelques secondes plus tard, une femme d’une trentaine d’années lui ouvrit, un canon perché sur talons hauts dans une tenue qui puait le fric.
— Je souhaiterais parler à Michel Mercier.
Carte brandie, yeux écarquillés.
— Qu’y a-t-il ? demanda la femme.
— Michel Mercier, s’il vous plaît… Et vite.
Il entra sans lui laisser le choix. Un enfant d’un an à peine jouait dans un coin avec une fille d’une vingtaine d’années. La femme alla frapper à la porte d’un bureau. L’homme apparut, cheveux poivre et sel, élégamment vêtu, petite moustache taillée.
— Police criminelle de Paris. On peut parler seul à seul ?
L’homme fronça les sourcils.
— À quel sujet ?
— Votre greffe de rein.
Mercier donna l’impression d’avoir avalé une boule de pétanque. Il essaya de trouver une rapide parade.
— C’est du domaine du privé. Et vous avez des papiers à me montrer ?
Nicolas comprit qu’il était tombé sur une teigne, un type qui connaissait la loi. Il le poussa violemment à l’intérieur du bureau et claqua la porte derrière lui. L’éclat de son Sig Sauer se refléta dans les yeux de Mercier.
— Je n’ai vraiment pas de temps à perdre avec des bavardages. Une fille a été massacrée pour que vous puissiez récupérer l’un de ses reins. Alors vous allez me dire exactement comment ça s’est passé, ou je vous jure que votre rein, je vous le perce d’une balle.
Mercier fixait le bras qui s’agitait, puis les yeux fous de Nicolas. Sa pomme d’Adam palpita.
— Une fille massacrée ? Non, ce n’est pas possible, c’est…
Nicolas lui balança la photo de la tête coupée au visage.
— C’est elle.
Le quinquagénaire se sentit mal et partit s’asseoir sur une chaise. Il se prit la tête dans les mains, puis releva les yeux, essayant de retrouver une contenance.
— Je n’ai rien à me reprocher. Partez.
Nicolas bondit comme un éclair. Il fit descendre une balle dans la chambre de son Sig d’un claquement sec, sortit la chemise de l’homme de son pantalon et lui écrasa le canon sur sa cicatrice, côté droit.
— Tu crois peut-être que je plaisante ? Je veux toute l’histoire.
L’homme tremblait comme une feuille.
— Je… je vous en prie.
— La vérité. Maintenant !
On frappa à la porte. Nicolas se raidit.
— Tout va bien, chéri ?
— Oui, oui, mentit Mercier. Laisse-nous.
Le capitaine de police le fixa bien au fond des yeux.
— Je t’écoute.
— J’ai… j’ai appris que je souffrais d’une insuffisance rénale grave il y a quatre ans. J’ai toujours eu des problèmes de reins depuis tout petit. Je… je savais qu’une grave maladie finirait par me tomber dessus, tôt ou tard.
Il déglutit. Ses yeux étaient rivés sur l’arme.
— Un jour, le verdict est arrivé : j’allais devoir passer en dialyse. Savez-vous ce qu’implique une dialyse ? Vous êtes encore en vie, mais vous avez l’impression d’être déjà mort. Quatre séances hebdomadaires de six heures chacune, semaine après semaine, où l’on purge votre sang avec des machines, où vous vous sentez sale, en bout de course. Vous en sortez à peine, épuisé, qu’il faut recommencer. Vous devez suivre un régime très strict, vous ne pouvez plus avoir d’activité professionnelle, les gens vous regardent différemment.
Nicolas relâcha la pression du canon sur le rein. L’homme se redressa un peu dans son fauteuil. Il passa un doigt sur sa cicatrice.
— Il… il n’y a rien de pire que ce regard-là, empreint de pitié. La dialyse, c’est une sous-vie, une frustration qui vous lamine. Et, pendant ce temps-là, vous espérez de tout cœur que quelqu’un meure pour vous donner son rein… Et vous attendez, attendez un organe qui ne vient pas, qui ne viendra jamais à cause de la pénurie, et surtout parce que vous avez un groupe sanguin rare. Un an, deux ans… Et vous êtes là, impuissant devant vos enfants, votre compagne, à mourir à petit feu.
Читать дальше