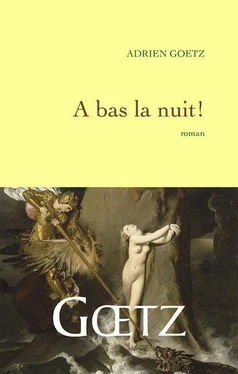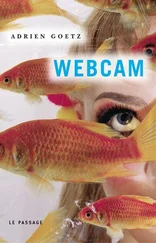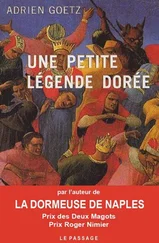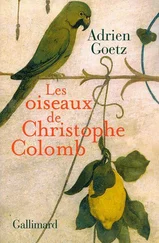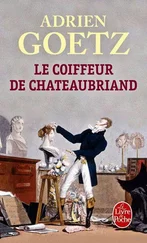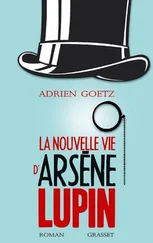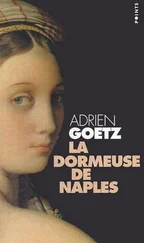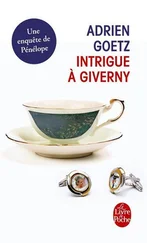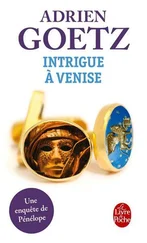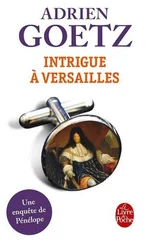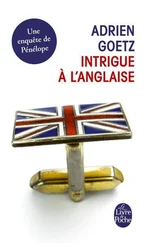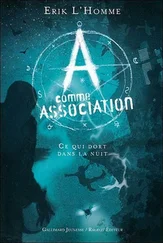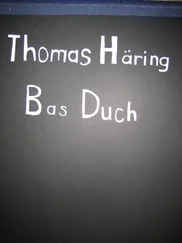Quand nous lui avons fait ce récit, notre ami avait ajouté :
« Le père de Konrad a vécu dans un monde si différent de celui où, par exemple, vivait mon père. Un Tunisien qui avait cru en la France, qui avait choisi de vivre à La Plaine-Saint-Denis. Notre cité venait d’être construite, la télévision avait fait un reportage. C’est en fuyant le brasier de Troie qu’Enée se rendit à Carthage… Chez nous. »
Il regardait à travers les doubles vitres.
« Ma figure d’Athéna casquée, on l’a découverte là-bas, dans les environs de Tunis. Copie d’un original grec, faite par des Romains, mise au jour en terre punique : trois cultures, trois civilisations sous ce front de marbre. J’espère que le dieu barbu qui nous attend vaudra tout ce voyage que nous faisons pour lui. Le pendant de mon Athéna, ma belle Carthaginoise ? »
Uzès a encore la taille à peu près de la ville que découvrit Racine quand il y séjourna à dix-sept ans, chez son oncle, le chanoine Pierre Sconin. Son nom figure sur une plaque. Les populations indigènes ont un peu oublié le chanoine Sconin. Rien n’y a trop bougé, à l’ombre du campanile italien de la cathédrale Saint-Théodorit, un peu penché d’ailleurs, comme un « pendant » français de la tour de Pise.
« À Uzès, j’ai passé, avec Jeanne, un des meilleurs moments de ma vie. Rassurez-vous, je ne vais pas vous ennuyer à larmoyer. »
Qui pouvait être la jeune fille qui avait aimé ce garçon bizarre, sans terre d’attache, si jeune après avoir tellement vécu ? Maher nous avait conduits dans un bel hôtel place de l’Evêché, avec des chambres confortables, une jolie vue, de bons draps.
« Nous venions de nous rencontrer. La lumière d’ici lui allait, elle agrandissait son regard, un regard bleu et sans limites. Le jour où Jeanne est morte, j’ai su que je n’aimerais plus personne. Vous aviez compris cela sans que je vous le dise ? »
Bien sûr, mais c’est lui qui y revenait. Qu’attendait-il ?
Toujours attentif à la nuit et amateur de petits déjeuners, Maher, le lendemain, nous raconta quelques souvenirs. Un vieux marin en retraite qui revit ses campagnes. Son regard avait une fixité étrange, un peu de folie :
« La lune entrait très claire dans ma chambre. Une de ces lumières nocturnes du Midi et de la Méditerranée qui sont tellement douces. Mon esprit vide se promenait sur deux gravures, face au lit. J’étais déjà venu dans cette chambre, mes amis. Je m’en souvenais à peine, mes yeux retrouvaient des formes familières, ombres, voiles des vaisseaux, combattants sur les pontons, nuage de poudre, gestes de désespoir, et l’océan d’un noir plus précis que la nuit.
« Jeanne aimait ces histoires de guerres, ces vues anciennes de combats, étrange chez une fille aussi fragile en apparence, aussi sereine. J’ai revu, ce matin, la bataille, comme lors de la nuit où, nue à côté de moi, elle me l’avait racontée. Je vis un homme qui lançait des ordres aux marins. J’étais perdu dans cette mêlée. La flotte anglaise, le Goliath du capitaine Folley en tête, s’était jetée entre nos vaisseaux et la côte ; nos lignes étaient prises entre deux feux, contraintes de combattre à l’ancre. J’enrageais. La bataille finissait. Le vent, qui n’avait cessé de souffler du nord-ouest, était tombé. L’odeur de poudre. Seuls résistaient encore, dans cette rade d’Aboukir où nous étions faits comme des rats, le Franklin que montait du Chayla, et l’ Orient, d’où l’amiral François-Paul de Brueys, commandant en chef de l’armée navale de Méditerranée, contemplait la défaite sans pouvoir réagir. Ce vieil homme avait la jeunesse des héros de la Révolution, jeune comme Desaix, Hoche ou Henri de la Rochejaquelein. Moins servi qu’eux par la fortune et par la renommée, il ne leur cédait pas sur le terrain de la vertu. Neuf navires étaient perdus ; on avait vu périr le Timoléon et même le Tonnant. Sur celui-ci, le capitaine Dupetit-Thouars avait eu d’un seul coup les jambes emportées. Sanguinolent, sans un cri, il avait ordonné qu’on le juchât, debout, dans une barrique de son traînant sur le pont. Il avait gouverné jusqu’au bout. Brueys se refusait à faire amener le pavillon : aucun secours n’était possible, les Anglais plus forts que jamais, même si l’on avait pu désemparer le Bellerophon. Tout s’effondrait. Vers dix heures, sur l ’Orient, l’incendie se déclara. Quand il atteindrait la sainte-barbe, le navire devait exploser. Brueys, qui savait que c’était la mort, revit son enfance dans les rues d’Uzès, l’ Atalante et l’expédition de Tunis, sa première campagne au Levant sur le Protecteur, et l’ Actionnaire à Saint-Domingue, la Vestale dans les Antilles, Chesapeake et la prise de Saint-Christophe, le Zélé quand il servait dans l’escadre de Grasse, la prise de Malte, deux mois auparavant, et la vieille figure du grand maître Hompesch contraint de livrer La Valette. »
D’où Maher sortait-il tout cela ? Récitait-il ? Nous l’écoutions en laissant refroidir nos bols de chocolat.
« Brueys avait vu le monde entier, servi aux Indes sous Louis XV, et sous Louis XVI en Amérique, arrêté comme noble en 1793, fait amiral sous Barras : pendant la traversée vers l’Egypte, il était devenu l’ami, le confident du jeune Bonaparte. Bientôt il allait être vieux. Pour lui, ces images allaient se mêler au plus horrible des cauchemars : corps décharnés, cadavres rompus, la silhouette horrible de Dupetit-Thouars dans son tonneau, mourant à son poste sur le banc de quart ; les hurlements et les râles, le rouge : à dix heures moins dix l’ Orient qui avait résisté le dernier explosa ; puis la nuit dispersa les épaves. » Maher se tut un instant, revenant sur terre : « En m’habillant ce matin, mes amis, j’ai lu l’exergue de ces deux gravures. Je m’en souviens fort bien.
— En effet !
— Ce sont, pour votre instruction, La mort de Dupetit-Thouars par Mager et La fin du Tonnant par Durand-Brager. Jeanne était comme fascinée par ces deux eaux-fortes. Il faut dire qu’elle était d’une famille où il y avait des officiers de marine, et où l’on se racontait ce genre d’histoires, sans jamais se lasser, avec tous les détails. Moi, brave garçon, je m’étais un peu intéressé ; on y prend vite goût, vous savez. J’aimais ce qu’elle aimait. »
Maher nous planta là, remonta en courant dans sa chambre, redescendit avec dans une main un tube de dentifrice, dans l’autre la glace de la salle de bains.
« Nous allons jouer. Quel dommage que Sidonie ne soit pas avec nous, elle adorerait. »
Il n’oubliait jamais Jeanne : même ce récit halluciné, plein de la fumée des incendies, de la moiteur des soirs d’Afrique, du va-et-vient des vagues et du vent des brûlots, de tous ces détails qu’il inventait sans doute, se rapportait à elle. Il posa le miroir sur la table et disposa à sa surface des bâtonnets bien réguliers de dentifrice à triple action, prenant soin de les placer de sorte qu’on puisse voir, dans la pâte blanche, la rayure bleue sur le dessus, pour certains seulement la rayure rouge.
« Vous comprenez : la bande qui lave les dents, celle qui rafraîchit et celle qui contient du fluor. »
Il figurait, grâce au fluor rouge et à la menthe bleue, les rangs anglais et français, navires à la surface de l’eau ; il avait recomposé pour Jeanne toute la stratégie de la bataille. Il déplaçait ces navires de dentifrice : les traces blanches sur le verre indiquaient leur route. Il écrasait contre la vitre ceux qu’il imaginait dans de grandes flammes sur la mer, les mâts brisés. On pouvait, et c’était encore plus joli, planter dedans des allumettes et les enflammer. Jeanne avait été si attentive. En nous parlant, Maher évitait de regarder son visage dans le miroir, les quelques rides qui se dessinent déjà à vingt-six ans, des vaguelettes autour des yeux. Une fois, ils avaient triché pour faire gagner les Français.
Читать дальше