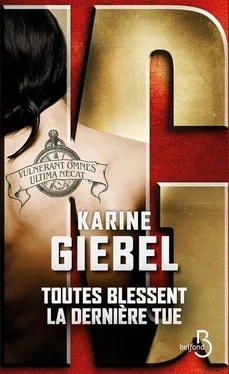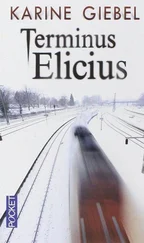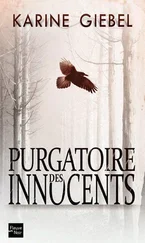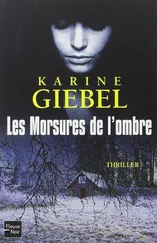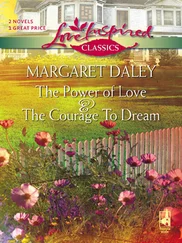Je le regardais rouler des mécaniques et me disais que j’étais la seule à le connaître. À le connaître vraiment. Qu’aucun des types présents ce soir-là ne pouvait imaginer qu’il pleure quand il dort.
Manu a dit que j’étais de plus en plus jolie. Qu’il n’avait jamais vu des yeux aussi beaux que les miens. Sur le moment, j’ai rougi et ça les a bien fait marrer. Et puis j’ai eu peur que ses remarques ne blessent Izri. Mais au contraire, il semblait fier que je plaise à son mentor.
Chaque jour, je pense à Vadim. Il m’arrive même de lui parler lorsque je suis seule. En espérant que mes mots parviendront jusqu’à lui, comme si nous étions reliés par un fil aussi solide qu’invisible. Je lui dis de vivre, de se battre.
De m’oublier pour se retrouver.
Parfois aussi, je pense à Tristan. J’aimerais savoir s’il est sorti de l’hôpital, s’il a pu être indemnisé pour la perte de son magasin. Depuis qu’Izri a démoli son visage et sa vie, je suis obligée de prendre le bus pour aller dans une librairie du centre-ville. Je m’y rends une fois par mois et choisis trois ou quatre bouquins. Izri m’a dit que je pouvais dépenser autant d’argent que je voulais pour des livres ou tout ce que je désirais.
Quand j’ai besoin de liquide, il me suffit de lui en demander. Parce que l’argent n’est pas notre problème.
Désormais, je sais conduire une voiture, même si je ne suis pas spécialement à l’aise au volant. Izri m’a dit que si je le souhaitais, il m’en achèterait une. Avec lui, la vie paraît simple. Il dit souvent que ce qu’on veut, il suffit de le prendre.
Ce qui signifie le voler.
Je suis née au Maroc, dans un village reculé, au sein d’une famille pauvre. J’ai été vendue à une femme sans scrupules et j’ai connu servitude et souffrance. Jamais je n’aurais pensé qu’un jour, je mènerais la vie que je mène aujourd’hui.
Je suis une miraculée.
Je crois que l’enfer est loin, désormais. Je crois que je suis sauvée.
Bien sûr, j’aurais aimé que l’homme de ma vie ait un métier honnête.
Bien sûr, j’aurais préféré qu’il ne soit pas violent.
Mais Izri peut aussi se montrer incroyablement tendre et généreux, attentionné et drôle. J’aime son visage, ses yeux, son corps et sa peau. Je ne peux pas m’en passer. J’aime sa façon, si particulière, de me regarder. Capable de me faire croire que je suis une reine et que le monde est à mes pieds.
Je n’aurais pas pu aimer un autre homme que lui. Aimer aussi fort, aussi loin.
Alors, chaque matin, je remercie Dieu d’avoir placé Izri sur ma route. Et je l’implore de ne jamais nous séparer.
* * *
Quand j’ai eu neuf ans, nous avons déménagé pour nous installer en région parisienne. Parce que Sefana, la cousine de ma mère, lui avait trouvé un emploi et un appartement.
Mon père semblait détester cet endroit. De toute façon, je crois qu’il détestait le monde entier, et lui avec.
J’ai quitté mes copains, mes repères, mon école. Il fallait tout recommencer. Mais grâce aux méthodes musclées de Darqawi, je n’ai eu aucun mal à m’imposer. Il avait fait de moi un tigre aux griffes et aux crocs acérés.
C’est fou comme la peur rend dangereux…
À l’école, je n’avais que peu d’efforts à fournir pour obtenir de bonnes notes. Et en dehors des cours, plus personne n’osait se mettre en travers de mon chemin. J’étais le premier de la classe et le caïd de la cour de récré. C’est rare de parvenir à cumuler les deux ; pourtant j’y suis arrivé.
Mon père, quant à lui, a trouvé de nouveaux endroits pour fumer la chicha ou disputer ses parties de dominos. Bien sûr, pour jouer au bon musulman, il ne buvait pas devant les autres, mais se débrouillait pour acheter son alcool à l’épicerie et aller se bourrer la gueule dans une cage d’escalier.
Une fois, en revenant de l’école, j’ai croisé le gardien de l’immeuble qui m’a dit que si je cherchais mon père, je le trouverais dans le local à poubelles. J’ai vu Darqawi assis contre un gros container, au milieu des détritus puants. Il avait une bouteille vide à ses pieds, les yeux mi-clos, et des vomissures plein son pull. La honte m’a fait verser quelques larmes et il m’a fallu une heure pour le ramener jusqu’à l’appartement.
En général, il rentrait chaque soir vers 18 heures, plus ou moins ivre. Selon la journée qu’il avait passée, selon les douleurs qu’il ressentait ou le montant des factures, la soirée n’était pas la même. Il pouvait m’ignorer, s’intéresser à moi, me raconter des anecdotes de sa jeunesse que j’écoutais religieusement. Il pouvait même me prendre dans ses bras, les jours fastes.
Mais il pouvait aussi me faire payer le prix fort. À coups de nerf de bœuf, de ceinture. À coups de poing, à coups de pied. L’implorer ne servait à rien et je ne m’abaissais plus à ça depuis longtemps. J’encaissais en silence, attendant le jour où je serais plus fort que lui. Si j’arrivais jusque-là. Car il me tuerait peut-être avant.
Quand je morflais, il n’était pas rare que je me venge dès le lendemain en tapant à mon tour sur un pauvre gamin de l’école. Mais je m’arrangeais toujours pour ne pas être pris. Pour terroriser celui dont je savais qu’il n’irait pas se plaindre.
Un soir de novembre, j’étais en train de faire mes devoirs dans la cuisine lorsque Darqawi est rentré. Dès que j’ai vu son visage, j’ai su que j’allais passer une mauvaise soirée. C’était écrit à l’encre noire dans ses yeux aussi clairs que les miens.
Il s’est approché de moi, faisant mine de regarder mon cahier. Il cherchait un prétexte, quelque chose pour enclencher le mécanisme. Pour justifier la trempe à venir.
— Bonsoir, papa, lui ai-je dit en levant la tête.
— Pourquoi tu n’as pas encore fini tes devoirs ?
— Parce que j’en avais beaucoup à faire.
— Et moi, je crois que c’est parce que tu as traîné dans la rue avec tes copains de merde !
— Non, papa, je suis rentré directement de l’école.
Non était un mot interdit. Il m’a soulevé de ma chaise et m’a entraîné dans sa chambre. Ma mère n’a même pas essayé de protester. Ça n’aurait pas servi à grand-chose, de toute façon.
Ça m’aurait juste réconforté.
Il a fermé la porte de la chambre et je suis resté planté devant lui, attendant une sanction que je n’avais pas méritée. Il a commencé par des gifles, puis les gifles se sont transformées en coups de poing dans le ventre. Lorsque j’ai touché le sol, il a terminé son travail à coups de pied.
Comme je ne pouvais plus me relever, il m’a traîné jusque dans le placard qui se trouvait au fond du couloir. Il m’a jeté dedans et j’y suis resté pendant deux jours.
En général, il essayait de ne pas trop abîmer mon visage, histoire que je puisse retourner à l’école sans lui causer de problèmes. Cette fois-là, il a fallu que je manque les cours pendant une semaine car il m’avait explosé la pommette gauche.
Quand je retournais en classe et qu’il me restait des hématomes, j’inventais des histoires de chute ou d’accident. Convoquée une fois par le conseiller d’éducation, ma mère a prétendu que j’étais très dissipé et bagarreur et que c’est pour cela que j’avais parfois des ecchymoses sur le visage ou le cou. Le reste du corps, personne ne pouvait le voir car mes parents s’arrangeaient pour me faire rater les visites médicales.
Après l’épisode du placard, j’ai changé. Deux jours et deux nuits dans le noir, en compagnie de la faim, de la soif et de la douleur, ça m’a fait réfléchir.
Dans la cour de récréation, je suis devenu un véritable tyran. Un tyran intelligent qui ne se faisait jamais prendre ou presque. Je rackettais, je frappais, j’humiliais.
Читать дальше