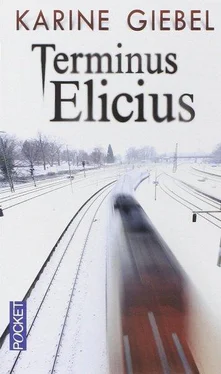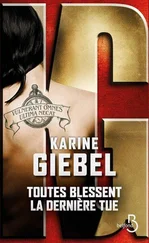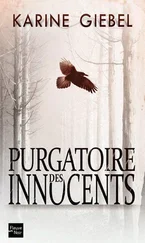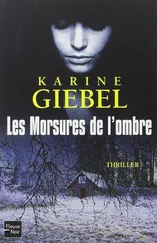KARINE GIÉBEL
Terminus Elicius
À Lili, Jean-Louis, Pascal,
L’air et la terre
À Stéphane,
Le feu et la lumière
Le glissement se fit plus léger et Jeanne ferma son livre. Le train ralentissait, la gare approchait. Mettre le roman dans le sac à main, enfiler son blouson. Est-ce que j’ai bien fermé mon sac ? Oui, il est bien fermé.
Elle se leva alors que le train entrait en gare de Marseille. Saint-Charles, monstre à mille quais, croisée des chemins. Chaque matin, les mêmes visages, un peu fatigués, prêts ou pas à affronter une nouvelle journée de labeur. Et, chaque soir, les mêmes, encore. Seulement un peu plus fatigués ; mais heureux de rentrer. D’ailleurs, il y avait toujours plus de sourires le soir que le matin.
Jeanne fut la première à descendre, à poser le pied sur le béton, dans une odeur de métal chauffé et de graisse. Brouhaha saisissant.
Attraper le métro, celui de 8 h 05. Tête baissée, elle affronta la foule, connaissant son itinéraire par cœur. Au début, elle s’était perdue dans ce dédale. Mais aujourd’hui, elle aurait presque pu le parcourir les yeux fermés. Un an à prendre la même ligne, à faire le même aller-retour. Ce matin, le Miramas-Marseille était parfaitement à l’heure, il avait même une minute d’avance ; Jeanne arriverait à son bureau à 8 h 30, pile.
Elle aimait l’exactitude et détestait les approximations. Ce qui n’était pas parfait, ce qui n’était pas à sa place. Les livres écornés, les crayons mal taillés, les vêtements mal repassés. Les hommes mal rasés.
Le métro de 8 h 05, bondé, comme d’habitude. Un Francilien l’aurait peut-être trouvé respirable, comparé aux rames parisiennes. Mais pour Jeanne, la villageoise, il était bondé. Se faire une petite place, fendre la marée humaine, mélange d’odeurs, agréables ou pas. Empilement de silences. Chacun pour soi, chacun sa vie. Et les rails, à nouveau. Une plongée sous terre, dans les entrailles de la cité phocéenne.
Jeanne serrait son sac contre elle. Est-ce qu’il est bien fermé ? Oui, il est bien fermé. On n’est jamais assez prudent. Une station, une autre… Et la sienne, enfin. La terre ferme, à nouveau. Et le marathon qui recommence…
Ascension vers le soleil, ruée vers la lumière du jour. Une rue pleine de gens et de voitures, de bruits et de désordre matinal. Au pas de course, Jeanne arpentait le trottoir, évitant le contact, frôlant mais jamais ne touchant. Elle étrennait une nouvelle paire de chaussures et avait déjà mal aux pieds. Elle détestait porter de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures. Comme elle détestait changer de coiffure. D’ailleurs, elle n’allait jamais chez le coiffeur : c’était sa mère qui lui coupait les cheveux. Longs et droits, de couleur châtain foncé, ils étaient invariablement attachés en queue de cheval. Elle continua à marcher, ravalant sa souffrance, avec l’impression que tout le monde regardait ses pieds. J’aurais dû remettre mes vieilles godasses !
Est-ce que mon sac est bien fermé ? Oui, il est bien fermé.
Enfin, elle pénétra dans le grand commissariat. Retrouver son univers familier, c’est rassurant. Même s’il s’agit d’un commissariat. Elle traversa le hall d’entrée, si grand et pourtant si sombre. Pas assez d’ouvertures sur le ciel, cruelle absence de lumière. Une atmosphère peu engageante qui avait beaucoup angoissé Jeanne, les premiers temps. Elle s’était dit que c’était peut-être fait exprès. Exprès pour impressionner ceux qui avaient le malheur d’y échouer. A moins qu’il ne s’agisse simplement d’une erreur de conception. Mais, récemment, le grand patron, attentif au moral de ses troupes, avait décidé de procéder à quelques aménagements pour remédier à ce flagrant délit d’inhospitalité : une peinture jaune pâle sur les murs, dont l’odeur chimique refusait encore de s’évaporer, des éclairages plus tamisés, quelques boiseries. Et, çà et là, témoins immobiles, une dizaine de plantes en plastique qui faisaient plus vraies que nature. C’était toujours aussi sombre, mais tout de même plus accueillant !
Au fond du hall, un guichet et sa file d’attente : les plaintes du matin, voitures disparues pendant la nuit, portefeuilles et sacs envolés dans le métro. Quelques cris, quelques impatiences, quelques pleurs. Des hommes en tenue, aux visages éprouvés, des regards fatigués. Usés par la routine. On pouvait rêver mieux comme lieu de travail.
Pourtant, Jeanne commençait à aimer cet endroit. Parce qu’il était assez vaste pour passer inaperçu ; assez déshumanisé pour éviter de s’y attacher le soir venu.
Elle emprunta l’escalier et monta au deuxième étage, là où se trouvait son bureau.
Un an déjà qu’elle avait intégré les effectifs de la Police Nationale. Mais pas comme elle l’aurait voulu. Impossible de devenir commissaire ou même lieutenant. Tout ça parce qu’elle portait des lunettes, parce qu’elle était myope. Pourtant, pour être flic, paraît que c’est le flair qui compte. Pas la vue ! Mais bon, il y a des injustices comme ça. Des injustices plein la vie. Alors, elle s’occupait des affaires générales : gestion des carrières, congés, courrier… Et les enquêtes, elle se contentait de les suivre de loin, telle une spectatrice privilégiée.
Elle entra au secrétariat et salua ses trois collègues, Monique, la chef de service, Géraldine et Clotilde. Quatre bureaux encombrés de piles de documents, quelques plantes vertes rachitiques qui appelaient à l’aide en aspirant la lumière artificielle comme un nectar salvateur. Une moquette rongée par les années, la peinture craquelée des murs, entre les affiches de propagande pour la Police nationale, la grande famille. L’effort de rénovation n’était pas encore arrivé jusqu’ici. Bientôt, avait promis le Pacha. Un courant d’air s’invitait par la seule fenêtre, apportant avec lui les bruits de la ville ; moteurs en surchauffe dans les embouteillages, concert de klaxons, le sport national à Marseille ; avec le foot, bien sûr !
Jeanne s’installa bien vite dans son fauteuil et fit glisser son blouson sur le dossier. Elle prit ensuite une clef dans la poche de son pantalon et, avec des gestes millimétrés, elle ouvrit son tiroir pour en sortir un stylo bleu, un rouge, un crayon, une gomme, une agrafeuse et une calculatrice. Le téléphone portable, extirpé du sac : déposé à gauche du calendrier, là où était sa place, même s’il ne sonnait jamais ; le sac lui-même, enfermé à double tour dans un autre tiroir et, enfin, la clef qui retourne dans la poche.
Alors seulement, elle put allumer son ordinateur. Rituel immuable du matin sous les regards amusés de ses collègues. Jeanne et ses petites manies…
C’est à cet instant que la porte du bureau s’ouvrit et le capitaine Esposito entra. Jeanne sentit son cœur se tordre, son sang bouillir dans ses veines.
— Salut les filles ! lança-t-il.
Comme chaque matin, il faisait le tour de tous les services pour dire bonjour. Simplement bonjour. Un des seuls à se donner cette peine. Avec le grand patron, bien sûr. Et, pour Jeanne, à la fois le meilleur et le pire moment de la journée.
Le meilleur, parce que le capitaine Fabrice Esposito était toujours parfaitement rasé. Parce qu’il avait de beaux yeux verts et un sourire d’une blancheur polaire. Grand, mais pas trop ; musclé, mais pas trop. Parfaitement proportionné, parfaitement habillé.
Le pire, parce que Jeanne n’arrivait jamais à lui dire autre chose que « bonjour ». Même pas « comment ça va ? ». Une bise à chacune des filles du service et il repartait aussi vite qu’il était venu ; rien ne le retenait ici. Première et sans doute seule émotion forte de la journée.
Читать дальше