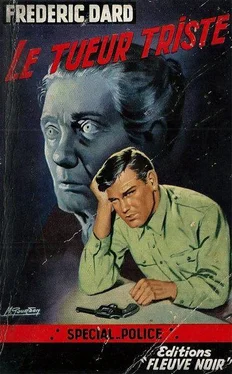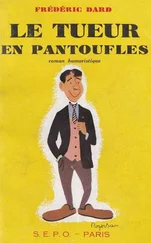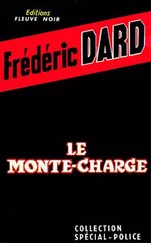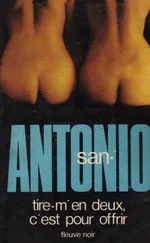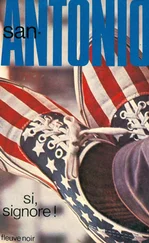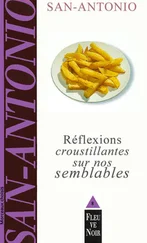Frédéric Dard
Le tueur triste
À Marina Vlady
et à
Robert Hossein
Avec l’affection de
F. D.
Les chars défirent sur la place Masséna à Nice entre une double haie de badauds en délire. Les cris, les rires, les fleurs et les confettis jetés à poignées tournoient dans la mollesse de l’après-midi.
Max, debout au bord du trottoir, regarde sur la droite pour voir si Maurice est arrivé avec la voiture. Il aperçoit la carapace noire de la traction et donne un coup de coude à Lino.
Lino sourit. Il est aux anges. Il aime cette liesse populaire qui lui rappelle son Italie natale.
— On y va ?
— Go !
Ils ramassent Charly, l’ahuri, piqué contre un lampadaire avec des confettis pleins sa tignasse crépue.
— À nous, bonhomme !
Charly les suit avec sa pauvre gueule d’ancien boxeur sans mémoire.
Ils parcourent quelques mètres en lançant eux aussi des confettis qu’ils puisent dans des grands sacs en papier…
Ils parviennent à la hauteur de la traction. L’auto est stationnée pile devant la bijouterie. Sur la porte du magasin, deux jeunes employées rieuses et frénétiques crient leur admiration aux chars lunaires qui défilent.
Lino et Max s’approchent d’elles et leur flanquent à la sauvette une poignée de confetti dans la bouche. Les filles s’étouffent, toussent, s’agitent sans cesser de rire pourtant.
Les deux hommes continuent de les bombarder. Elles battent en retraite dans le magasin.
À l’intérieur, un vieux bonhomme à cheveux blancs fulmine contre la cavalcade qui stoppe le c ommerce.
Il se met en colère en voyant le petit cortège de farceurs faire irruption dans sa boutique.
— Allons ! Allons ! grogne-t-il, je vous en prie… Les réjouissances, c’est dehors.
Charly vient de refermer la porte après avoir ôté le bec de cane à l’extérieur.
Lino sort de son sac de confetti un Beretta tout neuf. Des confettis sont collés après, à cause de la graisse de l’arme. Curieux, un Beretta constellé de points multicolores. N’empêche qu’il intimide toujours !…
Le bijoutier lève les bras. Il a compris. Ses deux idiotes d’employées cessent de glousser et l’imitent.
Max craint que ces trois personnes aux bras levés attirent l’attention de l’extérieur.
— Pas la peine, leur dit-il, on travaille en confiance.
Il entraîne tout son petit monde vers l’arrière-boutique, là où se trouve le coffre.
— Ouvre ta tirelire ! ordonne-t-il au bijoutier.
L’interpellé roule des yeux éperdus.
Un réticent ! Lino lui appuie le canon du Beretta dans le ventre, juste au creux de l’estomac, là où se fait la digestion.
— Démerde-toi, murmure-t-il.
Son visage bronzé est uni comme celui d’une statue. Dedans, ses yeux brillent, pointus, avec des veines rouges dans le blanc.
Le vieux bijoutier comprend. Il sort une clé de sa poche. Une petite clé numérotée, pas compliquée du tout en apparence, et l’enfonce dans la serrure du coffre. Puis il bricole le système. La porte s’ouvre… Des écrins sont empilés… Max regarde, d’un œil expérimenté. Il avise un compartiment à l’intérieur, fermé par une petite porte d’acier.
— Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite ! récite Lino.
Max ne sait pas où il va chercher tout ça… Il faut dire qu’il a pas mal lu en prison.
Comme le malheureux bijoutier ne bronche pas, Lino lui remet le canon du pistolet dans l’estomac. C’est une espèce de clé magique… Une clé à remonter les automates récalcitrants.
— Fais pas cette gueule, dit Lino, t’es assuré, non ?
Alors le bijoutier ouvre la seconde porte. Le compartiment contient une jolie liasse de billets de dix, et trois écrins aux formes bizarres. Max empoche les billets et ouvre les écrins. Malgré la pénombre de l’arrière-boutique, ça scintille dur là-dedans. Il émet un petit sifflement connaisseur.
Dehors on crie, on rit, on joue de la musique, on remue la poussière… On applaudit…
— Ça fait plaisir de tomber sur une maison sérieuse, apprécie Lino.
Les deux gangsters commencent à reculer. Le bijoutier a un élan vers son bien qui s’éloigne. Lino le calme d’un petit mouvement sec.
Simplement il avance son Beretta en direction du commerçant.
— Qu’est-ce qu’il y a ? grommelle-t-il. Les emballages sont consignés ?
L’une des employées bêle un rire nerveux que le marchand de joyaux ne lui pardonnera jamais.
Charly rouvre la porte. Lino reste le dernier pour tenir les victimes en respect jusqu’au dernier moment.
Max s’approche de l’auto aux vitres baissées. Il jette sa brassée d’écrins sur la banquette arrière et empoigne la poignée de l’auto. Seulement la serrure est bloquée de l’intérieur et la manette chromée ne frémit même pas sous la main.
Il regarde Maurice, au volant. Le garçon a un curieux visage tout crispé, avec des yeux de drogué sans came…
Il vient d’embrayer. Il fait un démarrage à mort, en seconde, qui manque déséquilibrer Max.
— La tante ! hurle Max…
Lino arrive après avoir remisé son feu. Il comprend tout et ses yeux deviennent pareils à ceux d’un loup blessé.
Charly demande des explications… À cet instant, le bijoutier apparaît.
Il s’étrangle à crier « Au voleur »…
Les trois hommes s’élancent à travers la foule… Ils tournent le coin de la rue… Ils continuent de courir, vite, mais sans s’affoler. Ils prennent à gauche, à droite… À gauche, à droite… Jusqu’à ce que le souffle leur manque.
Alors ils s’adossent au mur d’une belle propriété entourée de palmiers poudreux.
Ils se regardent. Max est hideux à force de colère.
— Alors, demande-t-il…
Lino se sent responsable. C’est lui qui a amené Maurice dans le coup.
T’en fais pas, halète-t-il… Je le repiquerai…
— Je te le souhaite, dit Max.
Il sort son fume-cigarette d’or de la poche intérieure de son veston. Il visse une cigarette dans le petit tube. Mais sa main tremble.
Lino a un goût de meurtre dans la bouche. Il regrette que Maurice ne soit qu’un. Il aimerait qu’il ait le don d’ubiquité pour pouvoir tuer une quantité folle de Maurice, les uns après les autres, en prenant son temps.
Je suis arrivé chez ces dames sur le soir. J’avais eu du mal à trouver, parce que la maison cachait derrière un atelier construit en léger et qu’il n’y avait pas de plaque sur l’atelier. Comme je ne tenais pas trop à me faire remarquer dans le patelin, je n’avais demandé mon chemin à personne, ce qui m’a obligé de parcourir, au ralenti, toutes les petites rues mal pavées du pays.
Chez Broussac, c’était nettement en dehors de l’agglomération. On longeait le mur branlant d’une espèce de vieux château pourri et puis, brusquement, ça faisait comme un renfoncement et c’était là.
L’atelier en ciment armé ressemblait à une énorme guérite. À sa gauche, un portail rouillé, fermé par une chaîne à cadenas, s’ornait d’une ravissante bordure d’orties pour bien montrer que depuis belle lurette on ne l’avait pas ouvert. Le tout faisait triste et vieux.
Читать дальше