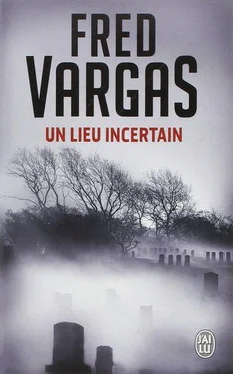Adamsberg leva la tête au déclic de la grande pendule. Pierre Vaudel, fils de Pierre Vaudel, arriverait dans quelques instants. Le commissaire monta l’escalier de bois, évita la marche irrégulière sur laquelle tout le monde butait, et entra dans la salle du distributeur pour y tirer un café serré. Cette petite pièce était un peu le domaine du lieutenant Mercadet, doué pour les chiffres, talentueux en toutes formes d’exercices logiques, mais hypersomniaque. Des coussins disposés dans un angle lui permettaient de reconstituer régulièrement ses forces. Le lieutenant venait de plier la couverture et se redressait, frottant son visage.
— Il paraît qu’on a posé le pied sur l’enfer, dit-il.
— On n’a pas réellement posé les pieds. On marche sur les passerelles à six centimètres au-dessus du sol.
— Mais on va se le taper tout de même, hein ? Le vent de la tourmente ?
— Oui. Et dès que vous serez dispos, allez voir avant que tout soit prélevé. C’est un carnage sans queue ni rime. Mais il y a une idée forcenée là-dedans. Comment aurait dit le lieutenant Veyrenc ? Un fil d’acier frémit dans les profondeurs du chaos. Enfin je ne sais pas, un motif invisible, que la poésie pourrait dénicher.
— Veyrenc aurait trouvé mieux que ça. Il manque ici, non ?
Adamsberg avala la fin de son café, surpris. Il n’avait pas songé à Veyrenc depuis son départ de la Brigade, il n’était pas disposé à réfléchir sur les événements houleux qui les avaient dressés l’un contre l’autre [1] Voir, du même auteur, Dans les bois éternels (éd. Viviane Hamy, 2006).
.
— Possible que ça vous soit égal, au fond, dit le lieutenant.
— Très possible. C’est surtout qu’on manque de temps pour ces questions, lieutenant.
— J’y vais, dit Mercadet en hochant la tête. Danglard a laissé un message pour vous. Rien à voir avec le pavillon de Garches.
Adamsberg acheva sa page 12 en descendant l’escalier. L’amusant Nolet, finalement, ne s’en sortait pas si bien que ça. L’ancien mari avait un alibi, l’enquête était en berne. Adamsberg replia le journal avec contentement. À la réception, le fils de Pierre Vaudel l’attendait, assis droit aux côtés de son épouse, pas plus de trente-cinq ans. Adamsberg marqua un temps d’arrêt. Comment annoncer à un homme que son père a été coupé en morceaux ?
Le commissaire éluda la difficulté pendant un long moment, le temps de mettre au clair les questions d’identité et de famille. Pierre était fils unique, et fils tardif. La mère était tombée enceinte après seize ans de vie conjugale, quand le père avait quarante-quatre ans. Et Pierre Vaudel père s’était montré intraitable et même enragé sur la question de cette grossesse, sans fournir à sa femme le moindre motif. Il ne voulait de descendance à aucun prix, il était impensable que cet enfant vienne au monde et il n’y avait pas à en discuter. L’épouse avait cédé, s’était absentée pour pratiquer l’interruption. Elle était restée au loin six mois et avait mené sa grossesse à terme, mettant au monde Pierre fils de Pierre. La colère de Pierre père s’était apaisée après cinq années mais il avait toujours refusé que l’épouse et le fils reviennent vivre chez lui.
Pierre l’enfant n’avait donc vu son père que de temps à autre, pétrifié par cet homme qui l’avait refusé avec une telle obstination. Une crainte seulement due à sa naissance contrariée, car Pierre père était accommodant, généreux d’après ses amis, tendre d’après sa mère. Ou du moins l’avait-il été, car la perte graduelle de sa sociabilité ne permettait plus d’accéder à ses sentiments. À cinquante-cinq ans, Pierre père n’acceptait plus que de très rares visites, s’étant défait un par un des amis de son large cercle. Plus tard, Pierre l’adolescent s’était frayé une place modeste, venant jouer au piano, le samedi, des morceaux spécialement choisis pour le séduire. Puis Pierre le jeune homme avait fini par conquérir une attention réelle. Depuis dix ans, et surtout après la mort de sa mère, les deux Pierre se voyaient assez régulièrement Pierre fils était devenu avocat et ses connaissances soutenaient Pierre père dans son exploration des affaires judiciaires. Le travail partagé évitait la communication personnelle.
— Que cherchait-il dans ces affaires ?
— D’abord un salaire. Il en vivait. Il chroniquait les procès pour plusieurs journaux et quelques revues spécialisées. Ensuite, il cherchait l’erreur. C’était un scientifique et il râlait sans cesse contre les approximations de la justice. Il disait que la pâte du droit était molle et pliée dans un sens ou un autre, que la vérité se perdait dans des arguties répugnantes. Il disait qu’on pouvait entendre si un verdict grinçait ou pas, si le déclic était correct ou non, comme un serrurier qui diagnostique à l’oreille. Et si cela grinçait, il cherchait la vérité.
— Il la trouvait ?
— En plusieurs occasions, oui. La réhabilitation posthume du meurtrier de la Sologne, c’est lui. La libération de K. Jimmy Jones aux USA, celle du banquier Trévanant, la relaxe de l’épouse Pasnier, le non-lieu du professeur Galérant. Ses articles ont pesé très lourd. Avec le temps, beaucoup d’avocats redoutaient qu’il publie son avis. On lui offrait des pots-de-vin, qu’il refusait.
Pierre fils posa son menton dans sa main, mécontent. Il n’était pas beau, avec son front très haut et le bas de son visage en pointe. Mais ses yeux étaient assez remarquables, inertes et sans éclat, des volets inviolables, peut-être inaccessibles à la pitié. Le corps penché, le dos plié, consultant sa femme du regard, il donnait l’apparence d’un homme aimable et docile. Adamsberg jugeait pourtant que l’intransigeance était là, posée sur la vitre fixe de ses yeux.
— Il y a eu des affaires moins glorieuses ? demanda-t-il.
— Il disait que la vérité est une route à double sens. Il a fait aussi condamner trois hommes. L’un d’eux s’est pendu en prison après avoir juré de son innocence.
— C’était quand ?
— Juste avant sa retraite, il y a treize ans.
— Qui était-ce ?
— Jean-Christophe Réal.
Adamsberg fit un signe, indiquant qu’il connaissait le nom.
— Réal s’est pendu le jour de ses vingt-neuf ans.
— Il y a eu des lettres de vengeance ? Des menaces ?
— De quoi parle-t-on ? intervint l’épouse, dont le visage était à l’inverse harmonieux et réglementaire. Le décès de Père n’est pas naturel, c’est cela ? Vous avez des doutes ? Si oui, dites-le. Depuis ce matin, la police ne nous a pas fourni une seule information claire. Père serait mort, mais on ne sait même pas s’il s’agit de Père. Et votre adjoint ne nous a pas encore autorisés à voir le corps. Pourquoi ?
— Parce que c’est difficile.
— Parce que Père, si c’est Père, continua-t-elle, est mort dans les bras d’une pute ? Cela m’étonnerait de lui. Ou d’une femme de la haute ? Vous étouffez quelque chose, pour la tranquillité de quelques intouchables ? Car oui, mon beau-père connaissait beaucoup d’intouchables, à commencer par l’ancien ministre de la Justice qui est vérolé jusqu’aux os.
— Hélène, je t’en prie, dit Pierre, qui la laissait faire sciemment.
— Je vous rappelle que c’est son père, enchaîna Hélène, et qu’il a le droit de tout voir et de tout savoir avant vous, et avant les intouchables. On voit le corps ou on se tait.
— Cela me paraît raisonnable, dit Pierre, avec ce ton de l’avocat qui scelle un compromis.
— Il n’y a pas de corps, dit Adamsberg en regardant la femme dans les yeux.
— Il n’y a pas de corps, répéta Pierre, mécaniquement.
Читать дальше