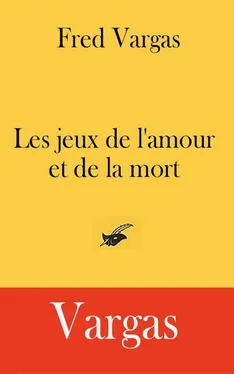FRED VARGAS
Les jeux de l’amour et de la mort
Les jeux de l’amour et de la mort ne sont pas le remake d’une pièce de Marivaux, mais la mise en scène d’un meurtre sordide sur fond de peinture contemporaine.
Le premier roman de Fred Vargas, après un début plutôt difficile et confus, finit par nous démontrer que l’on a réellement affaire à un écrivain brillant et inventif. D’une apparence plutôt classique, ce policier nous passionne par son histoire tortueuse. En suivant tantôt les réflexions et les actions de Thomas, tantôt celles de Galtier, tantôt celles de Jeremy, l’auteur nous perd sur différentes pistes, avec plusieurs scénarios plausibles, mais sans que l’on devine jamais quelle pourrait être la vérité. Qui a-t-on voulu tuer ? Qui a tué ? D’hypothèses en hypothèses, l’auteur emmène le lecteur captivé jusqu’à la révélation finale des derniers chapitres. Et si tout le monde avait fait fausse route depuis le début ?
Contrairement aux romans qu’a écrits Fred Vargas par la suite, les personnages de cette histoire-ci passent un peu au second plan par rapport à l’intrigue. À part Thomas et Galtier, les protagonistes n’ont pas réellement de consistance. Certains sont absolument transparents, et même Galtier manque un peu de poids face à Thomas. Cette fois-ci, c’est un roman qu’on lit plus pour l’enquête policière que pour ses personnages savoureux. Mais l’intrigue est suffisamment complexe pour retenir toute notre attention.
D’une lecture agréable, avec ses passages tantôt graves, tantôt humoristiques, Les jeux de l’amour et de la mort arrive à nous séduire, malgré quelques lourdeurs, par ses dialogues percutants, son mystère nébuleux et ses multiples rebondissements.
Un premier roman classique mais très prometteur, qui mérite largement d’être lu afin de découvrir le style bien particulier de Fred Vargas !
Émilie, 12 octobre 2010, sur le site
Esseclive.com .
Continue comme ça, se dit Tom, et tu sais très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer mal, voilà comment ça va se terminer. Et le mieux serait d’abord de bouger de ce foutu banc. Le mieux serait de trouver quelque chose d’intelligent à faire, quelque chose qui me donne envie de bouger. Certainement, il allait se lever. Il n’y avait pas à s’en faire là-dessus. Tout de même, il avait assez mal aux jambes à force et puis il avait encore trop chaud.
L’après-midi n’était pas bien engagée, c’était certain. La soirée de même. Bon dieu, il aurait tellement juré ce matin, en sortant de chez lui, que quelque chose de sensationnel allait lui tomber dessus, il était tellement sûr que ça allait être une journée d’exception.
Exception de merde, oui, se dit Tom. Cela lui apprendrait. Cela lui apprendrait à s’emballer comme ça. C’était bien fait. Pourquoi est-ce qu’il fallait toujours qu’il s’emballe ? Si cela se trouvait, il n’était pas un peintre génial. Il était un peintre de merde et puis c’est tout. C’est tout ce qu’il y a à tirer de toi.
Il se redressa et chassa ses idées en battant l’air avec sa main. La tranche en bois de ce foutu dossier de banc lui rentrait dans les os peut-être même bien dans les os du bassin et bouger lui ferait sans doute sur le coup un peu plus mal. Dans un moment il aurait un bleu. Eh bien, ce n’était pas si mal. Un bleu de bonne qualité, murmura Tom, ça vous change les idées, ça vous occupe, ça le distrairait une fois pour toutes. Un quart d’heure au moins que je lis cette réclame sur le mur d’en face. Tu ferais mieux de te secouer très vite sinon tu sais parfaitement comment ça va finir quand c’est parti comme ça. Mais combien est-ce qu’il avait fait de galeries dans la journée ?
Une vingtaine. Vingt-cinq, peut-être. Tom récapitula sur ses doigts. C’était cela, vingt-cinq galeries d’imbéciles qui ne comprenaient rien à rien.
Le pire avait eu lieu chez Fréville, ce déchet, qui n’avait pas regardé son dossier plus de deux secondes, c’était un comble, et qui avec cette espèce de bouche dégoûtante, avait craché son diktat sans savoir de quoi il était question au juste. De toute manière il n’exposait que des croûtes, et c’était aussi bien que cela n’ait pas marché avec lui. Il fallait reconnaître que Chevalier avait été plutôt gentille. Elle était sacrément belle et ça aurait été quelque chose de travailler avec elle. Mais ce que faisait Tom ne tombait pas dans son créneau, c’est ce qu’elle lui avait dit doucement — mais alors si doucement que Tom ne pouvait pas lui en vouloir. Et le gros, Reder, qui avait déclaré que de la peinture comme ça, on n’en faisait plus depuis cinq ans. Tom avait répondu que les cravates larges ne se portaient plus depuis quinze ans et tout s’était mal terminé.
Il tapa du pied sur le banc pour se faire du bien et du mouvement. Il n’était tout compte fait pas très content de ses chaussures. Lui et Jeremy étaient très à cheval sur ce qui touchait les questions de chaussures. La chaussure, disait Jeremy avec un peu de gravité, c’est ce qui demeure quand tout le reste change. C’est le noyau résistant, la partie rétive de l’être aux fluctuations du temps. Et encore, Tom ne se souvenait pas de tout. Jeremy avait une théorie convaincante sur les chaussures, et c’était un très gros point commun entre eux deux. Sur le coup, quand il avait acheté celles-là, il avait cru bien faire et tout compte fait non. La droite faisait un pli. La boucle était trop fluette par rapport à la couture. Et la couture elle-même, à bien la regarder, était un petit peu minable. On était loin, très loin de la perfection.
Que le diable emporte et grille dans d’atroces souffrances toutes ces galeries de peinture et tous les épiciers qui les accompagnent. Sauf Chevalier qui aurait la vie sauve.
Tom soupira. Il dégénérait. Il fallait qu’il laisse ce banc de supplice et qu’il aille boire un café quelque part.
De l’autre côté de la rue, il y eut tout à coup un groupe bruyant. Une voix de femme aux inflexions chaleureuses calculées lui fit lever la tête avec un sourire. Il aimait savoir pourquoi, de temps en temps, on pouvait se mettre à trafiquer sa voix, alors qu’on savait très bien que cela ne trompait jamais personne, et que tout le monde pensait tout de suite « tiens, elle est amoureuse » ou n’importe quoi d’autre.
Il sursauta en voyant devant la porte du café d’en face la haute stature de R.S. Gaylor. Oui, il dépassait bien tous les autres d’une tête, Gaylor. C’était vraiment lui. Gaylor en personne, Gaylor le magnifique, Gaylor le consacré, le peintre chéri du XX esiècle. Tom ne pouvait jamais penser à lui sans l’imaginer en train de régler ses notes dans les plus grands restaurants en laissant un rond à l’encre sur la nappe, avec un G en dessous, ce qui lui semblait le comble de la divinité moderne. Il y avait les pré-Gaylor, les Gayloristes (les ignorants disaient les Gayloriens), les néo-Gaylor, les pseudo-Gaylor, mais le vrai Gaylor était là à dix pas de lui.
Tom ne l’avait jamais vu de sa vie mais ce n’était pas difficile de le reconnaître. Les journalistes passaient leur temps à chasser sa figure, et depuis des années les articles à sa gloire se succédaient dans un style invariable et désolant. Des choses à propos de la splendeur vigoureuse du visage de R.S. Gaylor, qui n’avait pas peu fait pour lui gagner des dévotions désespérées et propager sa gloire, de l’éclat chaleureux du regard, de la flamboyante majesté du sourire qui avaient fait sans conteste du célèbre peintre l’une des personnalités les plus magnétiques de Paris… Tom trouvait cette littérature exaspérante mais il n’avait jamais pu s’empêcher de la lire. Et il était assez honnête pour admettre qu’il aurait volontiers fait l’échange avec sa tête à lui, qui n’était pas mal bien sûr, mais sur laquelle on ne se retournait pas dans la rue.
Читать дальше