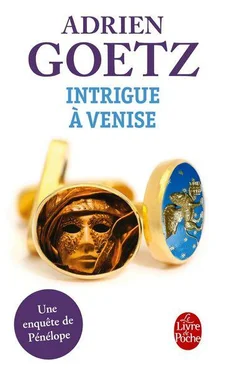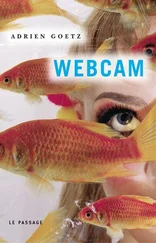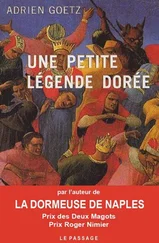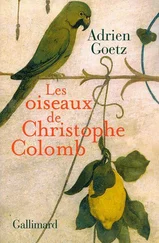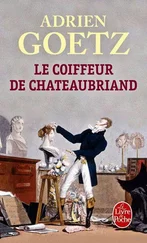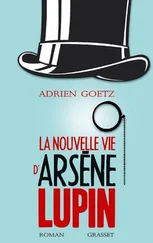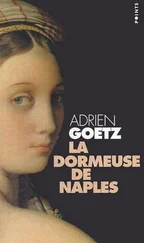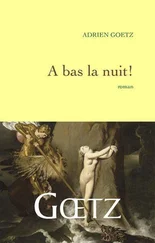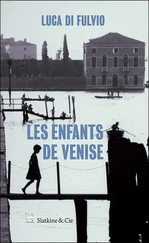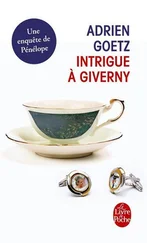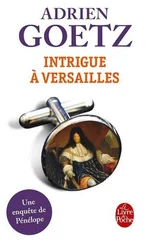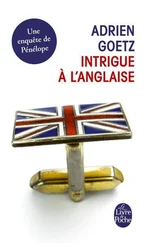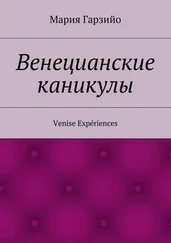Tripette ? Bon titre.
« Faut qu’il attende, le greluchon. Un bon écrivain, et il le sera, vous verrez, s’il veut réussir à Venise doit avoir beaucoup lu, ce n’est pas son cas… C’est encore un bleu, un an ou deux de plus en première ligne, dans la tranchée, et ça y sera. Et puis ses scènes de gaudriole toutes les quinze pages, ça vous plaît vous ? Vous êtes jeune, à mon âge c’est d’un lassant… Il ne faut pas confondre la littérature avec la vie… »
Hier, Wandrille a traîné ce boulet dans la « rue de Venise », en face du Centre Pompidou, calle vénitienne ou plutôt calletta , ruelle étroite et noire transportée à Paris. Photos en imperméable et paire de gants. Puis il a fallu s’échouer devant un seau à champagne au Lido, qui n’a pas grand-chose à voir avec la plage de ce nom où Visconti tourna Mort à Venise . La revue tout en paillettes et strass a beaucoup diverti M. de Craonne, le poète de la mélancolie. Cela a donné une photographie où il avait sur le genou une danseuse à collants rouges et bibi d’hôtesse de l’air, qui pourrait bien se retrouver en couverture d’ Air France Madame . Puis, le parcours a été plus classique : au musée Jacquemart-André, flashes devant le grand décor peint de l’escalier dû à Tiepolo et démonté dans un palais de Venise pour décorer cette demeure de banquier devenu musée, avec son ascenseur tout confort et son audio-guide nunuche.
Jacquelin de Craonne, épanoui par ce décor, avait raconté à Wandrille qu’il avait admiré les plus beaux des Tiepolo quand il s’était rendu, avec sa femme, précisait-il, au grand bal que Carlos de Beistegui avait donné dans son palais Labia : le bal du siècle. Beaucoup prétendent y être allés… De fausses cartes d’invitation ont même été imprimées après coup pour donner le change. Craonne, lui, pouvait prêter à Air France Madame une photo parue dans Jours de France où on le voit déguisé en Chat botté dans le grand salon, superbe preuve. Il rayonne : « On devait rester au bord du salon, Beistegui avait peur que le plancher ne craque… On se serait retrouvés dans les salons du dessous, on aurait continué à danser ! Rien ne nous arrêtait, c’était la joie de vivre de l’après-guerre. À votre avis, Wandrille, qui donnera le bal du XXI esiècle, vous qui sortez beaucoup ? Valentine de Ganay ? Léone de Croixmarc ? Vous les connaissez ? Frédéric Beigbeder ?
— Heu… Mireille Mathieu ?
— Il est sans doute trop tôt pour le savoir. Plus personne ne donne de bal pour le plaisir, on fait des fêtes maintenant pour la promotion des nouveaux téléphones portables, mais cela reviendra… »
Les deux visites prévues pour l’après-midi sont cette chapelle de l’École des beaux-arts, où se trouve le moulage de la statue équestre de Verrocchio. Puis il restera à traverser la Seine pour aller voir l’arc de triomphe du Carrousel, bibelot posé dans le jardin des Tuileries comme une pendule Empire sur une cheminée. Napoléon avait voulu installer au sommet les mythiques chevaux de Venise, les chevaux de Saint-Marc, volés à la basilique. Il avait fallu les rendre après le désastre de notre cavalerie dans le chemin creux de Waterloo. On en a sculpté d’autres, en remplacement, qui sont toujours là, braves bêtes qui leur ressemblent comme des frères.
Sur le mur de la chapelle, les damnés se tordent, les criminels et les pervers, les voleurs et les assassins crient et pleurent, les ombres noires suintent de terreur et de pitié. La chapelle de l’École des beaux-arts est un rêve : c’est le musée de la copie, un cours d’histoire de l’art dans le plus grand désordre, un tintamarre envoûtant. C’était une chapelle avant la Révolution, elle a gardé sa forme et sa froidure. Des têtes de plâtre sortent de l’obscurité, des gisants prient dans un décor de théâtre, des fresques juxtaposées, comme en désordre, la poussière, la suie, le silence composent une patine qui rend tout authentique. Personne ne connaît plus à Paris ce haut lieu de la formation artistique du XIX esiècle, il est loué pour des cocktails, des prises de vue… Wandrille a réservé une demi-heure. C’est peu, le photographe doit installer un réflecteur, orienter ses parapluies blancs, trouver le bon angle. L’ombre portée du cheval devient immense, diagonale noire au milieu de la nef.
Wandrille s’agite, Jacquelin de Craonne fait la visite comme s’il avait tout son temps : « Les élèves qui avaient obtenu le prix de Rome au XIX esiècle devaient envoyer d’Italie la copie d’un chef-d’œuvre. Cette collection a commencé comme ça, on l’a enrichie ensuite avec des moulages en plâtre, vous voyez ici les tombeaux des Médicis à Florence sculptés par Michel-Ange, regardez les visages de la Nuit et du Jour, sublimes, la grande chaire de la cathédrale de Pise, avec ses personnages qui se débattent pour sortir du Moyen Âge, c’est beau. Le mur du fond c’est une copie immense de la fresque du Jugement dernier de la chapelle Sixtine. Le peintre Sigalon y a épuisé ses forces, il est mort à la tâche. Regardez, c’est le vrai Michel-Ange, avec ses horreurs et sa palette sombre. Aujourd’hui, on a confié à une équipe sponsorisée par une chaîne de télévision japonaise la restauration de la Sixtine, tout est devenu criard, bleu, jaune, rose, Michel-Ange est acidulé comme un manga. Le vrai, il est ici, à l’École des beaux-arts, le Michel-Ange romantique et terrifiant… reculez-vous. Cette copie m’est plus chère que l’original. Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Orientez votre projecteur, monsieur, s’il vous plaît. Là, juste devant les pattes, pardon, je veux dire les jambes du cheval de Verrocchio. »
C’est ce que Wandrille n’avait pas vu tout de suite : dégoulinant par terre au pied de la statue, une tache marron, comme du sang. Puis il a vu la tête du chat, tranchée. Une tête noire, avec une petite tache blanche près de l’oreille gauche.
À côté, un carton plié en deux, du format d’une carte de visite. Wandrille se baisse, ramasse le petit papier.
Il a cru un instant que Jacquelin de Craonne s’accroupissait lui aussi pour voir ; non, il s’est effondré par terre, sur les dalles, et il reste assis comme ça, les yeux ronds, la bouche entrouverte, au risque de salir son beau costume gris perle.
Venise,
mercredi 24 mai 2000
Un carton plié en deux, du format d’une carte de visite, juste à côté du cadavre de ce pauvre chat : Pénélope a le temps de le ramasser, de le mettre dans son sac, sans trop le regarder, de peur qu’on ne la voie, avant que les premiers badauds n’arrivent.
Sur la place, face au bien nommé Ponte Cavallo, les serveurs du restaurant sortent les tables et les chaises. L’établissement s’appelle le « Snack Bar Colleoni ». C’est une place qui se réveille tard. Personne n’a vu la mise en scène macabre, le chat tué, ou alors c’est une tradition locale et on n’y fait plus attention. Pénélope n’a pas pu bouger. Elle aime les chats. Elle veut comprendre.
Derrière elle, une voix féminine, pleine d’emphase, qu’elle ne reconnaît pas tout de suite : « C’est en ces lieux qu’on prononçait, devant tous les patriciens de Venise assemblés, l’éloge funèbre des doges qui venaient de périr… »
Rosa Gambara, sur le fond des marbres polychromes de la façade de l’hôpital San Marco, découpe son profil de lévrier à lunettes d’écaille, cheveux longs peignés à l’afghane. Tout le monde a parlé de son dernier récit, Il te faudra quitter Venise . Elle est écrivain, elle se débat dans l’autofiction, mais on voit surtout sa tête à la télévision où elle ne craint pas de se démener, là aussi, dans son propre rôle. Pénélope sait que c’est une des rares bonnes émissions qui restent, sa mère le lui dit toujours, et elle est professeur de lettres au lycée Raymond-Salignac de Villefranche-de-Rouergue — elle parle de Virgile, des Bucoliques et des Géorgiques aux futurs cultivateurs, ils en ont de la chance.
Читать дальше