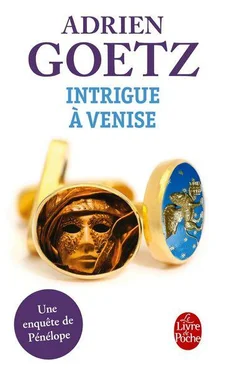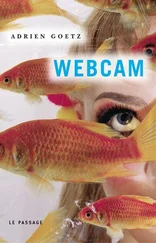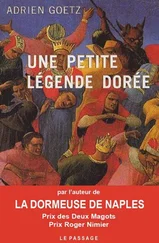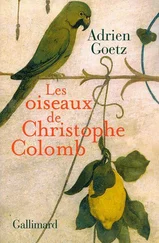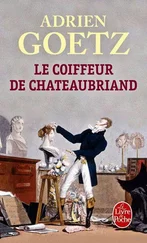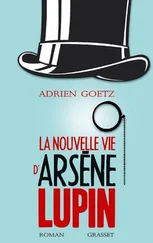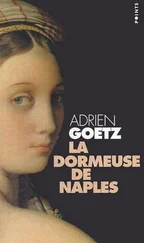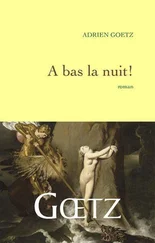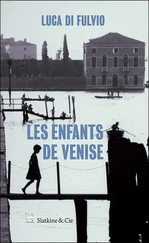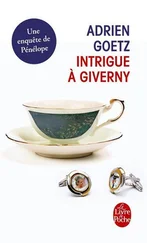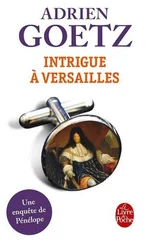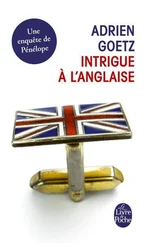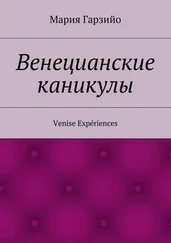Pénélope sait que pour bon nombre de conservateurs, ces membres du comité Rembrandt sont considérés comme des ayatollahs. Le grand cavalier peint par Rembrandt, le RRP, comme on dit, l’a désattribué. C’est pourtant une toile sublime, Le Cavalier polonais qui fait la gloire de la Frick Collection de New York. Sur la 5 eAvenue, il joue des étriers, avec son bonnet de fourrure et son allure de jeune barbare. L’Homme au casque d’or de Berlin est toujours un chef-d’œuvre du musée, mais on ne sait plus de qui il est. Au Louvre, le Philosophe en méditation , avec son escalier en spirale dans l’obscurité, déjà considéré comme un Rembrandt dans les collections de Louis XVI, a failli y passer : les conservateurs ont tenu bon, l’œuvre est toujours donnée au maître, contre l’avis du comité.
Pénélope est gênée. Rosa, introduite dans la Pinacothèque par son directeur, invité l’an passé dans son émission et qu’elle considère depuis comme un grand ami, la présente au professeur Rothmeyer, patron du RRP. Elle le connaît aussi, semble-t-il. Il travaille sur le panneau de La Déposition de Croix , posé à plat, sous la loupe binoculaire. Un Rembrandt nu et cru, sans cadre, sous une lumière blanche, neutre, avec ses boursouflures, ses empâtements, les rugosités de sa surface, ça ne paye pas de mine. Rosa l’interrompt, explique qu’elle est en visite avec une conservatrice de Versailles qui a des questions à lui poser. Pénélope à Versailles ne s’occupe pas des peintures, il n’y a aucun Rembrandt dans les collections, et Rothmeyer sait parfaitement qui travaille sur quoi dans ce petit milieu. Il la regarde pourtant avec bienveillance. Pénélope improvise, sous le regard à la fois tendre et glacé de Rosa : « Un marchand français possède un tableau, il prétend que c’est un grand cavalier qui aurait figuré dans la collection Klotz…
— Intéressant. Celui-là a disparu pendant la guerre. On n’a pas d’image. C’est une œuvre commandée à Rembrandt par un collectionneur de Messine qui posséda plusieurs peintures de lui, mademoiselle, vous trouverez cela sans peine dans les catalogues. Ensuite le tableau est passé à sa fille, puis à sa petite-fille, qui le vendit à Marie de Médicis. Le tableau arriva à Florence au palais Pitti, où il est resté jusqu’au Premier Empire. Il atterrit alors dans la collection de Joséphine de Beauharnais, à Malmaison. Mais il ne fut jamais accroché et on n’en fit pas faire de gravures, c’est, en réalité, une œuvre un peu mystérieuse.
— Elle a été volée ?
— Non, le tableau est offert par Joséphine à sa fille, la reine Hortense, qui épousa le pauvre Louis Bonaparte, roi de Hollande. Il resta dans les collections d’Hortense en exil au mur de son château d’Arenberg, en Suisse, jusqu’au jour où son fils, devenu Napoléon III, s’avisa de l’offrir à l’impératrice Eugénie. Il resta dans un cabinet des Tuileries qui dépendait des appartements privés, personne ne put le voir. Après la chute du Second Empire, il échappa de justesse à l’incendie des Tuileries, il se trouvait accroché dans une pièce du pavillon de Marsan qui jouxtait l’aile du Louvre et fut épargné par les flammes. Rendu à l’impératrice avec quelques objets personnels qui se trouvaient là…
— La République était bonne fille.
— Il aurait suffi de le séquestrer pour le Louvre. Il est vendu discrètement car Eugénie avait besoin d’argent. C’est à ce moment qu’on perd sa trace. Sa “réapparition” n’est qu’une mention dans le catalogue du fonds du marchand Klotz, saisi par les nazis. Je n’en sais pas plus, et je serais très content de voir la toile dont vous me parlez. Ce peut être une découverte. Ce serait à vous de le publier officiellement, dans une revue scientifique, je vous aiderai si la toile franchit le barrage de nos expertises. »
Rosa semble satisfaite. Le contact est pris. Elle est certaine que Rothmeyer n’aurait jamais parlé à une journaliste. Parce que Pénélope est conservatrice, il lui a parlé d’égal à égal. Elle a appris des détails qu’elle ignorait. Cela confirme en tout point ce que lui racontait sa mère : un tableau qui n’a été possédé que par des femmes…
« Regardez, Pénélope, avant que nous ne partions… Ce sont les peintres vénitiens du XVIII esiècle, vous qui aimez les petits bateaux, celui-ci est mon préféré. »
Rosa avait désigné, dans un angle de cette salle rectangulaire que les visiteurs devaient traverser distraitement, un petit Guardi. Sur le cartel, Pénélope put lire : « Campo San Geremia . » Un beau palais se dresse à l’angle d’un canal. Un coin de Venise où Pénélope n’est pas encore allée. Pourquoi Rosa avait-elle voulu attirer son attention sur ce tableau précis ? Dès qu’elle serait à Venise, elle irait voir sur place. L’avantage avec Guardi, Canaletto et quelques autres c’est qu’on peut, aujourd’hui encore, entrer dans leurs tableaux.
5
Un cavalier genre Vélasquez
Paris,
vendredi 2 juin 2000
Le palais Labia occupe une pleine page dans ce magazine à la couverture jaunie, en ouverture de l’article. Sur la page d’en face, un Guardi conservé à Munich le reproduit avec une exactitude parfaite. Wandrille progresse dans ses recherches. Le coup de téléphone de Rosa l’a rassuré, il avait alerté la terre entière et ne comptait guère sur la police de Venise. Puis il a pu parler longuement avec Péné. C’est elle qui l’a convaincu de rentrer à Paris.
Il est revenu chez lui, dans les chambres sous les toits qu’il occupe toujours au-dessus de l’appartement de ses parents. Pénélope et Wandrille vivent ensemble mais n’habitent pas ensemble, phrase que les imbéciles, les copines tartignoles de Pénélope, Olivia, Patricia, toutes ces midinettes, n’arrivent pas à comprendre. Pénélope campe dans son petit logement de fonction versaillais. C’est le secret de leur amour : chaque nuit chez l’autre demande de la séduction, aucune routine. Il a enfin abandonné à son sort le cher Jacquelin, qui s’est résigné à mener une existence d’heureux retraité dans sa junior suite du Casino Venier.
Wandrille a prospecté méthodiquement dans les articles de journaux que sa mère, depuis des années, découpe quand il s’agit de Venise. Il est tombé assez vite sur un vieux numéro de Connaissance des arts , conservé en entier, qui raconte la vente du palais Labia. L’article évoque le déjà mythique « bal du siècle », qui avait eu lieu quelques années plus tôt, et se présente comme une visite, salon après salon, du sanctuaire du plus flamboyant des collectionneurs.
Wandrille, en quelques heures sur Internet, avait reconstitué toute l’histoire. En 1964, Charles de Beistegui vendit le palais Labia, le plus bel édifice du Campo San Geremia, l’un des plus grands palais de la ville. Maurice Rheims se chargea de tenir le marteau du commissaire-priseur. 7 000 œuvres défilèrent. Beistegui en attendait 300 millions de lires, il récupéra plus du double, et Maurice Rheims raconta qu’il lui avait avoué, vrai ou faux, qu’il n’en avait guère dépensé que 100 pour accumuler, en ces murs, ces richesses dont le prix venait de l’ordonnance et de l’effet d’ensemble. Ce qui lui avait coûté le plus cher, c’étaient les quelques meubles qu’il avait fait copier par des artisans de génie et pour lesquels il était prêt à dépenser plus que pour des originaux. Les morceaux du Labia, tel miroir, tel fauteuil, tel lustre, dont certains bras de lumière étaient anciens et d’autres modernes, étaient des fragments d’une œuvre d’art. Des années plus tard, lors d’une seconde vente organisée au château de Groussay, la canne avec laquelle Don Carlos avait donné le signal du début du bal, bel objet, fit aussi flamber les enchères.
Читать дальше