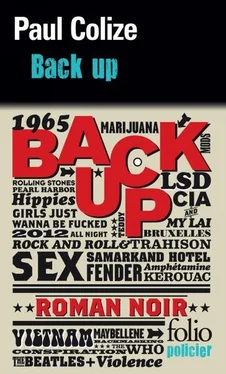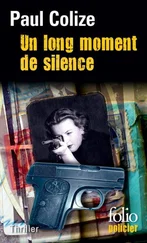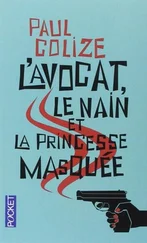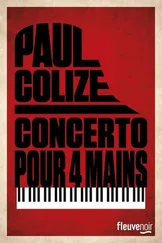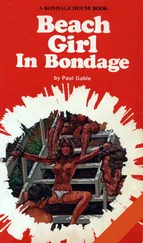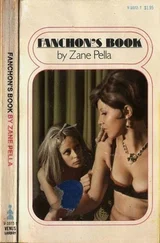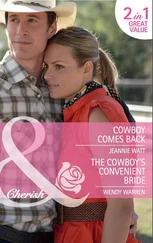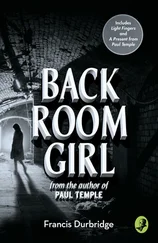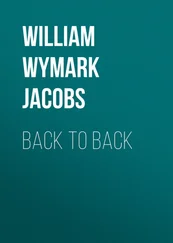Peut-être sont-ils venus me réclamer leur clé et sans doute ont-ils été vexés par mon indifférence à leur égard. Entre le jazz et le rock, les cloisons étaient étanches.
Durant le festival et les jours qui ont suivi, j’ai été secondé par un membre du personnel qui avait fait mon job avant de s’orienter vers le room service. Il s’appelait François, c’était un Suisse froid et distant. Il m’a enseigné les rudiments du métier avec un ton chargé de mépris et de condescendance.
En plus de la remise des clés, je devais faire plusieurs fois le tour de l’hôtel pendant la nuit pour vérifier que les portes coupe-feu étaient fermées. Je devais en profiter pour éteindre les lumières aux endroits où elles n’étaient pas nécessaires et mettre les veilleuses.
En outre, je devais être capable de répondre au téléphone, de prendre un message sans le déformer et sans demander à l’interlocuteur de répéter. J’étais tenu de remplir les formalités d’accueil en cas d’arrivée tardive et de monter les bagages des clients dans leur chambre.
En cas de demande, je devais réserver un taxi, commander des journaux, indiquer un itinéraire, conseiller un restaurant ou un bar, suggérer un endroit où l’on pouvait trouver des prostituées, voire en convoquer une.
Je devais tout savoir faire, mais par-dessus tout, il ne fallait jamais discuter les ordres d’un client, si extravagants soient-ils. Je devais respecter mes supérieurs, faire preuve d’une discrétion à toute épreuve et trouver des solutions à tout problème.
Mon salaire n’était pas gratifiant, mais l’hôtel mettait à ma disposition une chambre dans une annexe. J’avais droit à un repas à mon arrivée et à un copieux petit déjeuner à la fin de mon office.
Avant mon départ de l’hôtel, le cuisinier me faisait don de quelques mets pour améliorer mon ordinaire.
Cet emploi me convenait. Les derniers serveurs quittaient l’hôtel vers minuit et me laissaient seul à bord. Hormis un client occasionnel, je ne devais parler à personne, ce qui s’accordait à mon tempérament.
L’hôtel hébergeait deux convives prestigieux. Depuis plusieurs années, Vladimir Nabokov, le célèbre romancier russe, et son épouse avaient fait du Palace leur résidence principale. Ils occupaient une suite au dernier étage.
Comme tout le monde, j’avais lu Lolita et Feu Pâle . J’avais été ébloui par le style poétique et l’imagination débordante de Nabokov et j’avais de l’admiration pour lui. Il consacrait l’entièreté de ses matinées à l’écriture. Quand venait l’après-midi, il partait se promener dans les alpages ou jouait au tennis.
À intervalles réguliers, des journalistes venus de tous les coins du monde venaient l’interviewer. Il les recevait dans le Salon Vert. En fin d’après-midi, il s’installait dans une chaise longue au bord de la piscine.
Quand je commençais mon office, il était déjà couché. Je ne l’ai aperçu que quelques fois, mais c’est sans nul doute sa présence obsédante dans les murs de l’hôtel qui m’a poussé à écrire mon histoire.
69
Quelques jours après les faits
Michael Stern mit rapidement la main sur le journal dont parlait Mary Hunter.
L’article relatant la tragédie de Ramstein se trouvait dans le Daily Telegraph du lundi 5 juin, à la rubrique des nouvelles internationales. D’autres quotidiens avaient également publié la photo sur laquelle Jacques Berger avait cru reconnaître l’un des hommes présents dans le studio après l’enregistrement.
Sur l’image, trois civières recouvertes d’un drap étaient entourées par une équipe de secouristes. Des ambulances, portes ouvertes, stationnaient à l’arrière-plan. Sur la droite, deux policiers tenaient un groupe de curieux à distance. Une bonne trentaine de badauds observaient la scène. Le format réduit et la faible définition de l’image empêchaient de distinguer leurs visages.
Comment Berger était-il parvenu à identifier cet homme sur une telle photo ?
Stern ne se découragea pas pour autant. Rien ne prouvait qu’un des spectateurs faisait partie des hommes présents le 14 mars dans le studio de Berlin, mais le concours de coïncidences était troublant.
Avant de recueillir le témoignage de Mary Hunter, il était arrivé à la conclusion que l’enregistrement était l’élément déclencheur de la disparition des membres de Pearl Harbor. Les informations que la chanteuse lui avait livrées l’avaient définitivement convaincu.
Un incident s’était produit lors de cette séance, probablement l’intrusion de Berger, et ces morts en étaient la conséquence.
Berger avait parlé d’individus qui trafiquaient les bandes.
Dans quel but ? Quel rapport pouvait-il y avoir avec le massacre de la Saint-Boniface ?
Le lien établi par Berger était ténu, mais valait la peine d’être exploré.
Stern voulait connaître tous les détails qui concernaient les événements de Ramstein ainsi que les conclusions de l’enquête.
Il prit contact avec Hans Büler, le correspondant du Belfast Telegraph à Bonn. Ce dernier n’avait pas suivi l’affaire, mais en connaissait les éléments clés.
L’enquête avait conclu à un phénomène de démence collective suivi d’un déchaînement incontrôlé de violence.
Un fait similaire s’était produit à Lima en 1964, lors d’un match de football. Un but refusé avait été à l’origine de bagarres qui avaient fait trois cent vingt morts et plus de mille blessés.
Plus récemment, en septembre, à nouveau dans un stade de football, mais en Turquie cette fois, une situation analogue s’était soldée par la mort de quarante personnes, dont vingt-sept par coups de couteau.
En revanche, c’était la première fois qu’on recensait ce genre de débordement dans une boîte de nuit. Le bilan définitif faisait état de dix-huit morts.
Cette dernière information fit réagir Michael Stern. Les articles parus au moment des faits parlaient de quinze morts.
Hans Büler lui expliqua que deux personnes avaient succombé des suites de leurs blessures et qu’un des employés de la discothèque, le disc-jockey, s’était suicidé.
On l’avait retrouvé pendu chez lui, quelques jours après les faits.
70
Je me suis fait mon idée
Je travaillais six jours sur sept. Mon jour de relâche tombait le mercredi, comme celui de Andy, ce qui nous permettait de nous rencontrer et de partager certaines activités.
Nous nous retrouvions devant l’église de la rue du Temple en milieu d’après-midi. De là, nous empruntions le sentier du Télégraphe et montions à pied jusqu’à Glion, un petit village niché dans les hauteurs, sur la route de Caux.
Le patelin abritait un bistro tenu par un Belge où nous buvions des Stella et fumions des joints. Andy savait où s’en procurer. Les prix étaient plus élevés qu’à Londres, mais la qualité était au rendez-vous.
De par mon mode de vie, j’avais peu à peu réduit ma consommation d’herbe. Je continuais à prendre des amphés, mais plus dans le but de rester éveillé toute la nuit que pour les sensations que cela m’apportait.
En fin d’après-midi, quand les effets de l’alcool et de l’herbe se faisaient sentir, je lui parlais de rock. Je m’étais offert un tourne-disque portatif et m’étais acheté quelques albums. Jimi Hendrix, Cream, Grateful Dead et Jefferson Airplane étaient en haut de la pile.
Andy me parlait de photographie et de peinture, ses deux passions. De nous deux, c’était lui qui parlait le plus. À certains moments, il s’enflammait, ponctuait son discours d’intonations chantantes et de gestes théâtraux. Andy était gay. Son homosexualité n’a jamais posé de problèmes ni créé d’ambiguïté dans nos rapports.
Читать дальше