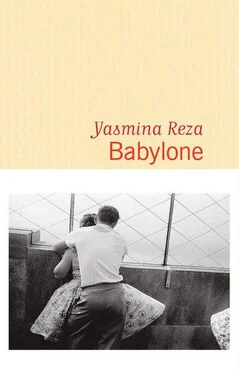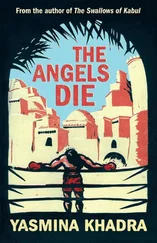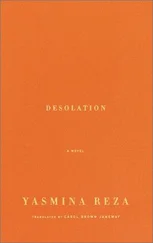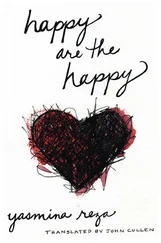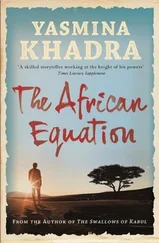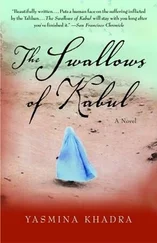Quand on demande à Etienne des nouvelles de sa vision, il répond, tout est sous contrôle . C’est une expression qu’il a prise de son père qui était préfet de police. Je l’ai toujours entendu dire, c’est sous contrôle, même quand rien ne va. D’ailleurs sa vision n’est pas du tout sous contrôle puisqu’il est atteint de la DMLA sèche, dite la mauvaise, celle pour qui, contrairement à l’humide, les piqûres ne servent à rien. Nous ne demandons pas souvent à Etienne des nouvelles de sa vision. Nous ne voulons pas que ça devienne un sujet. D’un autre côté, nous ne pouvons pas ne jamais nous en inquiéter. C’est une balance subtile entre réserve et intrusion. Seul chez lui le week-end dernier, Etienne a cru pouvoir régler au feeling, sans lunettes ni lampe de poche, le thermostat du chauffage. Il a tourné la rondelle dans le mauvais sens. Quand Merle est revenue, elle est entrée dans un four chauffé à blanc. Tout est sous contrôle a le mérite de clore le chapitre à peine ouvert. La phrase ne dit rien de la réalité, ni même de l’état d’âme de celui qui la prononce. C’est une sorte de garde-à-vous existentiel assez pratique. Et drôle aussi. Le corps fait ce qu’il veut, les cellules se comportent selon leur bon plaisir. Finalement qu’est-ce qui est sérieux ? Dernièrement on s’est rappelé un épisode du temps où leur fils aîné était encore au lycée. Merle et Etienne avaient reçu une convocation du proviseur sur laquelle était notifié que Paul Dienesmann s’était très mal comporté à Auschwitz. Etienne avait reçu son fils, assis, la mine grave, et avait dit — on en rit encore —, il paraît que tu t’es très mal comporté à Auschwitz ? Après plus amples informations, il ressortait que Paul avait fait le mariole dans le car qui les conduisait de Cracovie à Birkenau, créant parmi ses camarades un climat contraire à la mémoire et au recueillement. J’ai pris en grippe le mot recueillement. Le principe aussi. C’est devenu la grande mode depuis que le monde fonce vers un indescriptible chaos. Politiques et citoyens (encore un mot génialement creux) passent leur temps à se recueillir. J’aimais mieux avant, quand on apportait la tête de l’ennemi au bout d’un pic. Même la vertu n’est pas sérieuse. Ce matin, avant de partir à Pasteur, j’ai appelé la maison de retraite de la tante pour prendre de ses nouvelles. La conversation terminée, je pense, tu es vraiment quelqu’un d’attentif, tu t’inquiètes des autres. Deux secondes après, je me dis, c’est minable cette satisfaction de soi pour une action aussi élémentaire. Et aussitôt, c’est bien, tu es vigilante avec toi-même, bravo. Il y a toujours un grand féliciteur qui a le dernier mot. Quand Denner, enfant, sortait de la confession, il s’arrêtait sur le parvis de Saint-Joseph des Épinettes, humait l’air à pleins poumons et se disait, à présent je suis un saint. Et tout de suite après, en descendant les marches, merde, péché d’orgueil. Dans un sens ou dans l’autre, la vertu ne tient pas. Elle ne peut exister qu’à notre insu. Denner me manque. Un homme mort il y a trente ans vous manque soudain. Quelqu’un qui n’aura rien connu de ma vie, ni métier, ni mari, enfant, là où j’habite, les lieux que j’ai vus, ni ma tête dans le temps. Ni plein d’autres choses inimaginables à l’époque. Il arriverait et on se marrerait. De tout. Est-ce qu’il y a dans le ciel, quelque part, une petite étoile Denner ? Il me semble l’entrevoir de temps en temps. Joseph Denner avait quatre ans de plus que moi. Grand, musclé, anar et alcoolo. Son père était cuistot. À quatorze ans, il était plongeur à la gare de Colmar. Je le sais encore car Denner aimait le répéter. Joseph avait aimé et admiré son père, mais non sa mère, selon lui un monstre petit-bourgeois et économe. Ils habitaient dans trois chambres de bonne réunies rue Legendre, la salle de bain faisait également cuisine et ils recouvraient la baignoire d’une planche pour faire plan de travail. Je me souviens d’un minuscule salon mansardé, et derrière, séparée par une grille dorée toujours fermée, la chambre des parents, minuscule également. L’alcool s’y trouvait dans une armoire. En hauteur la grille se terminait en torsade, il y avait un espace vide. Par une reptation surnaturelle, Denner se glissait à l’horizontale pour piquer du whisky. Il avait fait deux ans de service militaire en Allemagne dans un bataillon disciplinaire. Il vivotait en jouant de la guitare dans le Pax Quartet, un groupe plus ou moins catho qui le gardait par charité. Il croyait en l’aventure, on rêvait d’alpinisme, de Machu Picchu en sifflant des Carlsberg au Pub Miquel, on n’allait jamais nulle part sauf quelques virées nocturnes en bord de mer. Il était susceptible et caractériel. On était tous plus jeunes que lui, personne n’osait le contredire. J’ai encore des livres qui lui appartenaient, Vian, Genet, Buzzati. Il les adorait. Je les ai toujours conservés à part, dans un coin, où que je sois, à côté des livres de photos, la petite collection qu’on s’était fabriquée ensemble, Frank, Kertesz, Cartier-Bresson, Winogrand, Weegee, Weiss, Arbus (on les chourait à la librairie Péreire ; Denner avait trouvé dans un surplus une veste de chasse avec une grande poche arrière). Dans certaines photos de Garry Winogrand, les filles sortent dans les rues en bigoudis, avec un foulard. Ça leur donne un côté poule, je-m’en-foutiste, vraiment sexy. Je m’étais mise à le faire à une époque. Je me suis toujours intéressée aux arrangements de cheveux. On ne peut pas penser le monde ni même les hommes en général. On ne peut se faire une idée que des choses qu’on a touchées. Tous les grands événements alimentent la pensée et l’esprit, comme le théâtre. Mais ce ne sont pas les grands événements ni les grandes idées qui font vivre, ce sont des choses plus ordinaires. Je n’ai retenu en moi, vraiment, que des choses à portée de main, que je pouvais toucher de mes mains. Tout est sous contrôle.
Jean-Lino ?… La valise s’était avancée toute seule jusqu’au vestibule. Silence. Je suis allée voir. Jean-Lino se tenait debout, dans le couloir, un peu en ombre chinoise avec la lumière de la chambre. Ça va ?
— Elisabeth.
— Vous m’effrayez.
— Si jamais il m’arrive quoi que ce soit, vous n’êtes pas remontée chez moi. Vous ne savez rien.
— D’accord.
— Et la valise est à moi.
— D’accord.
Il a enfilé son perfecto Zara et mis son chapeau des courses. Il a posé le sac et le manteau sur la valise.
— Le type aurait sûrement pris le portefeuille…
— Oui. Je m’en débarrasserai… Ah, une seconde…
Il est reparti vers la chambre et en est revenu avec une paire de gants en mouton retourné.
— Allons-y.
On est sortis de l’appartement. Jean-Lino tirait le chargement. On est restés quelques secondes sans bouger sur le palier pour être sûrs de ne rien entendre. J’ai appuyé sur le bouton de l’ascenseur. En fait il était toujours à l’étage. On a poussé la valise à l’intérieur. Jean-Lino a ouvert la porte de la cage de service. Pas un bruit. On est convenus en chuchotant que j’attendrais un peu pour descendre afin de coordonner nos arrivées dans le hall. Il a allumé la minuterie et s’est engouffré dans l’escalier. Je suis entrée dans l’ascenseur en laissant la porte entrouverte. La cabine est très étroite, il me restait peu de place. Le manteau vert est tombé par terre, je l’ai ramassé et je l’ai coincé entre les barres de la poignée. J’ai voulu faire passer la poignée entre les anses du sac à main mais ça n’a pas marché. J’ai laissé la porte se refermer et j’ai appuyé sur 0. Je regardais mes pieds, mon pantalon de pyjama à carreaux, mes chaussons en fausse fourrure. Je descendais seule quatre étages avec un cadavre. Aucune panique. Je me suis trouvée ultragonflée. Je me suis plu. Je me suis dit, tu aurais eu ta place dans l’armée des Ombres ou dans le service action de la DGSE. Te revoilà Elisabeth. Rez-de-chaussée. Jean-Lino était déjà là. Essoufflé et concentré. Lui aussi, épatant. Il a saisi la valise. Le manteau est retombé par terre, je l’ai récupéré. Je portais le sac à main et le manteau. Les roulettes faisaient un bruit navrant sur le carrelage. La voiture était garée devant. Je la voyais, juste derrière la bordure de pierre. J’ai évalué le trajet, le contournement du buisson. J’ai appuyé sur le bouton de la porte, Jean-Lino l’a ouverte. Il a engagé la valise dans l’entrebâillement. Un moteur démarrait derrière l’immeuble. On a entendu un petit bruit venant du dehors, un bruit humide de talons sur un sol mouillé, et on a vu surgir de la droite, tête baissée pour échapper au vent, la fille du second qui rentrait de soirée. Jean-Lino a reculé, il s’est écarté pour la laisser entrer. La fille nous a dit bonsoir, on a répondu bonsoir. Elle s’est jetée dans l’ascenseur qui l’attendait.
Читать дальше