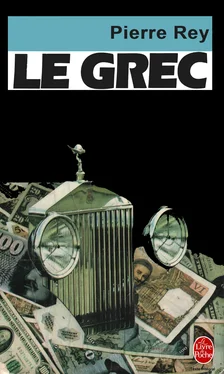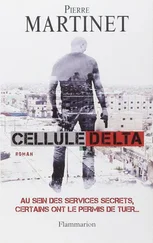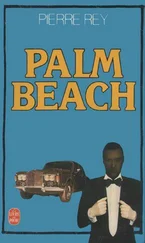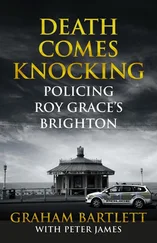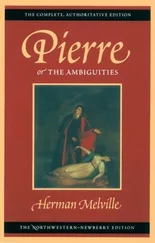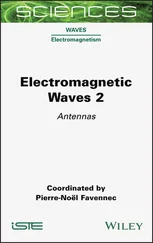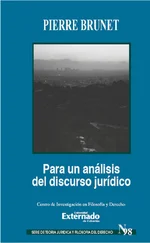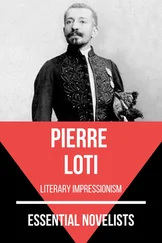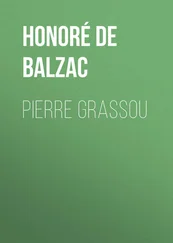« Comment veux-tu que je m’habille, ce soir ? »
Il biaisa : « Ma foi… » Elle insista : « Long ou court ? » Cette fois, on y était. « Ingeborg… », commença-t-il. Elle riva sur lui ses yeux bleus, presque violets : « Oui ?… » Il se jeta à l’eau :
« On ira dîner demain. Ce soir, ça m’est impossible. Il faut que je parte pour Londres. Dans deux heures.
— Pour Londres ?
— Hé oui ! Pour Londres !
— Une autre vieille dame ?
— Écoute… C’est en rapport avec l’affaire dont je viens de te parler. La soirée chez Kallenberg…
— Emmène-moi. »
L’emmener ? Elle était complètement folle ! Les plus belles femmes du monde seraient là, les plus riches, les plus titrées, et d’emblée, sans avoir rien mérité, elle voulait faire partie de cet aréopage où il avait eu tant de mal à se faire admettre… La plaisanterie avait assez duré, il n’avait pas de comptes à lui rendre :
« Tu vas t’habiller bien gentiment, mon chou… »
Elle se rebiffa avec une sauvagerie dont il ne la croyait pas capable :
« Mon petit Raph, on va voir qui de nous deux est un chou. Si tu m’as trouvée assez bonne pour partager ton lit, je veux l’être aussi pour partager ta soirée. Et ne discute pas, ma décision est prise : j’irai. »
Affolé par son aplomb, il lui jeta avec méchanceté :
« Maintenant, ça suffit. On a été très copains tous les deux, mais je vois que j’ai eu tort d’être gentil. Alors tu vas me faire le plaisir de filer. Et tout de suite !
— C’est ton dernier mot ?
— Je ne te dirai pas le dernier, tu trouverais que je suis mufle.
— Très bien. »
Elle se leva du lit, alla à la coiffeuse et rajusta machinalement quelques-unes de ses mèches. Raph respira : ç’avait été plus facile qu’il ne pensait. Bien sûr, il allait se fâcher avec elle, ce dont il avait horreur, car il adorait conserver ses anciennes maîtresses, les revoir de temps en temps, entre deux voyages. Mais franchement, elle ne l’avait pas aidé ! Il la regarda distraitement faire quelques pas dans la chambre, superbe et nue. Elle se dirigeait vers la porte. Raph se sentit brusquement pétrifié. Incertaine, incrédule, sa voix croassa :
« Où vas-tu ?
— Je file. C’est bien ce que tu m’as demandé ? »
Et sans un mot de plus, elle ouvrit la porte et disparut dans le couloir. Une décharge d’adrénaline submergea Raph et le fit se jeter à sa poursuite. Il entrouvrit la porte et l’aperçut, sur sa gauche, marchant tranquillement dans le couloir du Ritz, avec la même aisance que si elle avait été vêtue de pied en cap : un désastre. Il était connu dans le palace et l’administration fermait volontiers les yeux sur les notes qu’il payait souvent avec des semaines de retard. Il fallait surtout éviter le scandale. Il se lança derrière elle, criant son nom d’une voix étouffée : « Ingeborg… Ingeborg !… » Comme en un rêve, il la voyait s’éloigner, ses petites fessés roulant sur ses longues jambes, au rythme de sa marche tranquille et souveraine. Et soudain, le cauchemar : à l’autre bout du couloir, Marcel, le garçon d’étage, un plateau sur les bras, venait d’apparaître. Quant à Ingeborg, elle allait atteindre le palier de l’ascenseur, et là, plus personne ne pouvait dire ce qui se passerait. Marcel fut magnifique : il ne se retourna même pas sur elle, se contentant de saluer Raph comme si la situation avait été parfaitement normale. Devant l’air égaré de Raph, qui semblait lui demander secours, il laissa tomber d’un air très déférent :
« Avez-vous un problème, monsieur Dun ? Puis-je vous aider ? »
Raph s’aperçut alors que lui-même était en slip. D’une mimique désespérée, il désigna la jeune femme qui, maintenant, avait appuyé sur le bouton d’appel de l’ascenseur. Marcel posa son plateau sur la moquette :
« N’ayez crainte, monsieur. Je m’en occupe. »
Mais c’était déjà trop tard : là-bas, Ingeborg, sans même un regard derrière elle, entrait dans l’ascenseur. Le valet se précipita : « Madame ! Madame ! » La porte coulissa sans bruit. Marcel se précipita dans la cage de l’escalier, lançant à la volée :
« Je vais essayer de la récupérer en bas ! »
Pour lui-même beaucoup plus que pour le garçon qui ne pouvait l’entendre, Raph murmura :
« Il faudrait une couverture !… Une couverture… »
Affolé soudain à l’idée des explications à donner, il se rua dans sa chambre, enfila un pantalon, un chandail à col roulé de soie blanche, une veste légère, saisit l’une de ses valises et fonça dans l’escalier de service pour se réfugier au plus vite dans son havre de la rue Cambon. Il ne fallait à aucun prix que le délire de cette folle lui fasse rater sa nuit chez Kallenberg.
Le petit Spiro cassait des amandes. Il était assis par terre, sur une plaque de lichen que contournaient des armées de fourmis rouges en marche. Sur ses genoux, un petit pot de miel, à sa droite, à même le sol, les amandes, à sa gauche, les noyaux. Quand les amandes seraient en nombre suffisant, il les mélangerait au miel à l’aide d’un bâton. De temps en temps, il devait repousser trois de ses quatre chèvres, venues assister à l’opération, leur envoyant des tapes sur le museau lorsqu’elles s’approchaient trop de son butin. Du coin de l’œil, Spiro guettait un gros lézard vert, écartelé de chaleur sur le blanc de la roche, à trois mètres de lui. Le jeu consistait à ne pas bouger, et pour l’un, et pour l’autre. Au moindre mouvement du garçon, le lézard filerait comme une flèche. Pour arriver assez près de lui et le prendre, il allait falloir se déplacer sur les fesses, sans se déployer, en une reptation insensible. Ce qu’il y a d’agréable avec les lézards, c’est qu’on peut leur empaler dans le corps, sur toute sa longueur, de longs bâtonnets rigides qui leur donnent, lorsqu’ils s’enfuient, une raideur de mille-pattes du plus haut comique. Spiro envisagea aussi, par paresse, de l’atteindre avec une pierre, ce qui aurait l’inconvénient, s’il ne ratait pas sa cible, de le priver du plaisir de l’empalement. Il hésitait sur ce choix épineux lorsqu’une colonne de fourmis, changeant sa trajectoire, se dirigea en rangs serrés vers ses amandes. À cet instant précis, Spiro enregistra simultanément trois choses : la marche des fourmis sur son déjeuner, la fuite du lézard et le bruit d’une voiture. Il était resté plus de trois mois sans en voir une et voilà que, en moins de vingt-quatre heures, c’était la troisième qui brisait le silence de sa montagne, sans parler des hélicoptères — son oncle, qui avait été dans la marine, lui avait donné le nom de ces étranges avions — qui par deux fois, la veille également, avaient atterri sur l’éperon rocheux dominant la falaise, très haut au-dessus de la mer. Dans son émotion, Spiro jeta précipitamment ses amandes dans son pot de miel, le posa au pied de l’olivier et se rua vers un éperon de pierres sèches sur lequel il s’aplatit.
Cent mètres plus bas, il voyait la voiture gravir la pente, en épouser les lacets avec une constance d’insecte affairé. Malheureusement, il ne pouvait pas voir qui était à son bord, alors que le jour précédent, il avait assisté, sans en perdre une miette, à l’arrivée d’inconnus, venus du ciel à deux reprises pour s’engouffrer dans des voitures, partir vers son village, revenir à leur point de départ et s’évanouir dans le ciel. Son oncle, à qui il avait demandé des explications, s’était borné à lui indiquer qu’il s’agissait d’un hélicoptère, se refusant à lui donner les clés de cet atterrissage et insistant même pour que Spiro oubliât ce qu’il avait vu. Maintenant, la voiture disparaissait en haut de la côte, au-delà de laquelle se juchait, nichée au milieu des autres, sa maison à lui. Pensivement, le petit berger abandonna son poste d’observation pour retourner sous son olivier : malédiction ! Les chèvres avaient mangé toutes les amandes, léché le miel et laissé le pot aux fourmis qui grouillaient sur ses parois intérieures. Avec un cri de rage, Spiro fracassa le pot contre la roche, prit un long bâton et se lança à la poursuite de ses chèvres, égaillées sur une pente molle couverte de gentianes, et qui semblaient le narguer.
Читать дальше