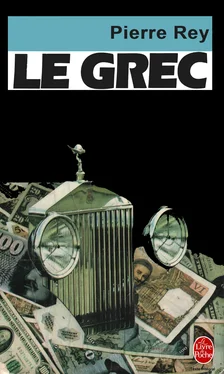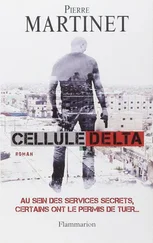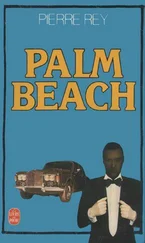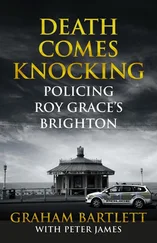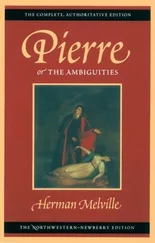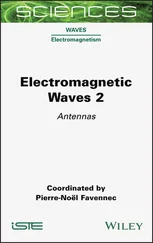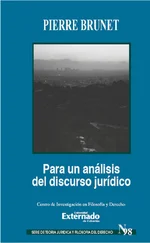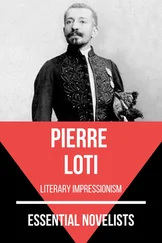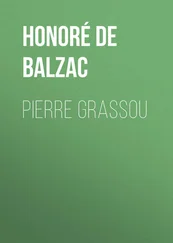« Ils sont venus, dit la vieille.
— Je sais, maman, c’est pour ça que je suis là.
— Qu’est-ce qu’on me veut ?
— On veut me nuire, à travers toi.
— Je ne peux pas te nuire. Je ne peux pas t’aider. Je ne te connais pas.
— Moi, je peux t’aider.
— Alors, casse du bois. »
S.S. s’empara de quelques branches. Maladroitement, il essaya de les casser. Athina les lui arracha des mains, avec une force insoupçonnable chez une femme de cet âge.
« Laisse ça ! J’ai eu un fils, peut-être, un jour, mais il est mort il y a plus de trente ans. Et si tu étais ce fils, je ne voudrais rien de toi, rien, pas même te voir !
— Maman…
— Maman !… Tu as attendu trente ans pour savoir si j’étais en vie ! Qu’est-ce que tu as fait encore comme bêtises ?
— Qu’est-ce que tu leur as dit ?
— Pourquoi ça t’intéresse ? As-tu réussi à te faire une situation ? (Malgré lui, S.S. ne put s’empêcher d’esquisser l’ombre d’un sourire)… Je le savais, que tu tournerais mal, je te l’avais assez répété !
— Tu me l’avais peut-être trop dit…
— Et ton frère, tu l’as aidé ? Et ton père ? Tu n’es même pas venu aux obsèques ! Et moi, regarde comme je vis !
— J’ai voulu l’aider ! C’est toi qui as refusé… maman. »
Malgré lui le mot lui écorchait la bouche. Un mot qui l’étouffait au point que sa propre épouse, dès qu’elle était devenue mère, ne lui inspirait plus le moindre désir. Même plus question de lui faire l’amour. Impossible. Le cri de la vieille lui vrilla les tympans :
« J’attends rien de toi ! Personne attend rien de toi ! Garde-la ton aide, j’en ai pas besoin. Je me suis débrouillée sans toi, je continuerai !
— Tu leur as parlé ?
— J’ai pas de comptes à te rendre ! Tu as voulu vivre sans tes parents, eh bien, continue !
— Tu peux pas comprendre…
— Ton père le disait, que tu avais des idées de fou ! Il avait raison ! Tu as rendu fou tout le monde autour de toi. »
Socrate serrait les doigts de toutes ses forces sur un morceau de bois qui résistait à sa pression et refusait de rompre. Comme à sept ans, il ne put que balbutier :
« Maman… je t’en prie… »
Et malgré lui, il hurla le reste de sa phrase :
« Tu ne t’es jamais occupée de moi ! Tu préférais mon frère ! »
Maintenant, la vieille pleurait, des sanglots secs, métalliques, insolites dans une gorge aussi usée.
« Va-t’en ! dit-elle… Va-t’en ! Ne reviens plus jamais !
— Écoute…
— Va-t’en ! »
D’un geste, elle montrait la porte. Elle chercha ce qu’elle pourrait dire de définitif…
« Tu es… un démoralisé ! »
D’instinct, elle avait retrouvé son expression favorite : « démoralisé ». Cela ne voulait rien dire en soi, mais dans sa bouche, avec le recul du souvenir, les cinq syllabes se métamorphosaient pour Socrate en mot-cauchemar, celui de la discorde et de toutes ses révoltes.
Quand il avait quitté la maison, il avait seize ans. Pendant quatre années, il s’était enivré de cette liberté toute neuve et avait joui de supplanter son père, en jouant son rôle, en vivant ses rêves, en réussissant là où il avait échoué. Ce qui n’avait pas eu l’air d’épater sa mère, ni de l’émouvoir. Déçu et vaguement mal à l’aise devant l’indifférence du seul public qu’il souhaitait étonner, ne sachant plus très bien pour qui il devait prouver quoi, désireux de ne pas perdre son prestige tout en gardant ses distances, il s’était offert le luxe de leur envoyer de l’argent pendant quelques années. En y repensant, il se rendait compte que c’était beaucoup plus pour leur prouver qu’il en avait et leur faire sentir le poids de sa jeune puissance que par devoir filial.
Et puis ç’avait été le tourbillon, sa première affaire, son premier bateau, son premier milliard, sa première épouse. Que pouvait-elle comprendre à ce triomphe, cette étrangère en noir qui le traitait en petit garçon ? Il ne l’avait pas choisie pour mère, lui. Et qu’y pouvait-il, si au lieu de le baptiser Machiavel, elle l’avait prénommé Socrate ? À son niveau, comment pouvait-elle concevoir, même pas concevoir mais imaginer, son exceptionnelle ascension ? Dès le début de sa réussite, frêle encore, mais qui ne demandait qu’à s’épanouir, il avait considéré sa famille comme un poids, un morceau de fonte qui le tirait par le bas les jours de doute, quand il se demandait si, tel Icare, il n’était pas monté trop haut. Et voilà qu’aujourd’hui, à la suite d’un mauvais tour, son sort était lié à l’humeur de cette vieille paysanne dont il avait tant voulu rayer, férocement, le souvenir de sa vie. Pourquoi, comme tant d’autres, n’était-il pas né orphelin ?
Qu’avait-elle dit à ces types ? Et si elle leur avait parlé, combien de temps faudrait-il à Kallenberg pour exploiter ses propos ?
« Va-t’en !
— Une dernière fois…
— File, ou alors… »
Incroyable : Athina avait saisi un bâton et l’en menaçait !
« Ne reviens jamais plus ! Et si je meurs avant toi, je t’interdis de suivre mon convoi funèbre ! Je te maudis ! »
S.S. était devenu blême, ne sachant pas très bien si le goût métallique qu’il avait dans la bouche provenait des mille injures qui se pressaient et tournoyaient sans qu’il pût les articuler. Cela l’aurait tant soulagé, de les lui jeter à la face, mais rien ne sortit. Il tourna les talons et franchit le seuil de la porte. Furieusement, il essayait de broyer le morceau de bois entre ses mains. Il allait lui falloir attendre des heures encore, la soirée de Londres, chez Kallenberg, pour savoir à quoi s’en tenir.
On pouvait tout dire de Raphaël Dun, sauf qu’il n’était pas beau. Immense, svelte, les cheveux légèrement argentés, il avait une façon animale de bouger qui faisait se retourner les femmes sur lui. À trente-deux ans, il avait encore les séductions de l’adolescence, son désarroi feint et ses incertitudes, ses volte-face et sa fantaisie. Parfois, il se demandait combien de temps encore durerait la grâce. Debout et complètement nu, il s’étira devant le miroir immense qui couvrait un panneau entier de sa chambre du Ritz. Il avait toujours été fasciné par les palaces, celui surtout de la place Vendôme, à tel point que pour ne pas en être trop éloigné lorsque ses pertes au jeu ne lui laissaient pas les moyens d’y résider, il avait loué le petit studio d’un quatrième étage de la rue Cambon, juste en face du dais du Bar-Bleu. Les jours fastes, il n’avait qu’à téléphoner à la réception qui lui envoyait un chasseur pour prendre ses valises. Et lui-même, en changeant de trottoir, changeait d’univers.
Sa carte d’identité portait la mention « journaliste ». En fait, il n’était ni reporter ni photographe, bien qu’il eût tâté des deux avec des fortunes diverses. C’est peut-être pour cela qu’on le définissait comme il se définissait lui-même : grand reporter. Statut polyvalent, inodore, vaguement flatteur et passe-partout, dont l’absence de spécialisation l’avait rendu indispensable dans un milieu social hautement polyvalent lui aussi. Un milieu où le flou est de rigueur et dans lequel ne pas avouer ce qu’on sait faire, ou plutôt avouer en riant qu’on ne sait rien faire, signifie qu’on peut faire n’importe quoi.
Raph avait bâti sa vie sur cette ambiguïté. Ses parents étaient quincailliers — il n’y a pas de sot métier, certes, mais il cachait ses origines comme une tare, par délicatesse envers ses amis, qu’une telle ascendance aurait pu choquer. Quand il se demandait lui-même comment il s’y était pris pour sortir de ce guêpier, franchement et en toute humilité, il ne trouvait pas de réponse. La chance, peut-être, et un flair infaillible pour s’accrocher à qui il fallait, quand il le fallait, tout en ne rencontrant plus ceux qui auraient pu le gêner dans ses positions acquises de fraîche date. Sa spontanéité relevait de la mathématique : chaque sourire, chaque clin d’œil ou poignée de main était dosé et soupesé avec la précision d’une balance électronique. Raph divisait le monde en deux catégories : ceux qui pouvaient le servir, et les autres. Systématiquement, il ne fréquentait que les premiers. Comme il n’était affligé d’aucun talent, en dehors de son habileté pour le poker, il s’était taillé une réputation d’arbitre très flatteuse. On disait, à propos d’un film : « Et Dun, qu’est-ce qu’il en pense ? »
Читать дальше