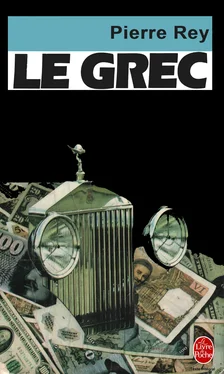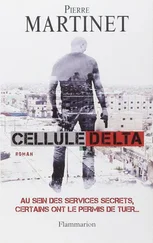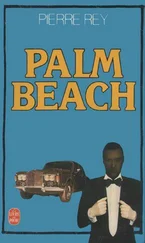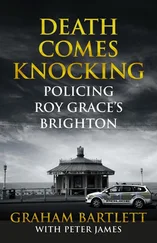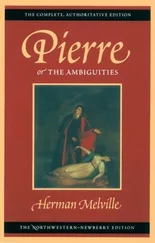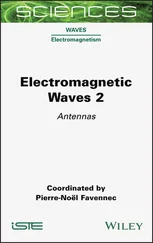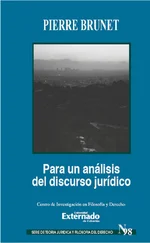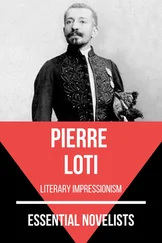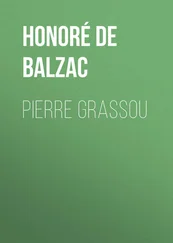Pierre Rey - Le Grec
Здесь есть возможность читать онлайн «Pierre Rey - Le Grec» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 1973, ISBN: 1973, Издательство: Éditions Robert Laffont, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Le Grec
- Автор:
- Издательство:Éditions Robert Laffont
- Жанр:
- Год:1973
- Город:Paris
- ISBN:2-253-02033-8
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Le Grec: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Le Grec»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
est le plus étourdissant des romans jamais consacrés aux coulisses de la « Jet society ». S’y affrontent en un ballet fiévreux et mortel, les dieux hors série de cette caste secrète et impitoyable : les super-riches. Tissant sa toile autour des continents, affamé, féroce, attendrissant, le plus fascinent d’entre eux : Socrate Satrapulos. Ses ennemis l’ont baptisé S.S. mais pour tout l’univers, il a un autre nom : le Grec.
Le Grec — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Le Grec», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Un jour, en Égypte, le gros Farouk lui avait dit :
« Je suis prêt à vous racheter toute votre flotte. Mais dites-moi, que ferez-vous de l’argent ? »
L’argent, oui, mais pour quoi faire ? Finalement, tout tournait autour de la même question. Elle restait posée pour lui, qui pouvait tout acheter, ou pour la putain de Soho, qui n’avait qu’elle à vendre. Barbe-Bleue avait répondu d’un trait, sans réfléchir :
« J’achèterai une nouvelle flotte pour vous faire concurrence. »
Maintenant, si on lui avait demandé pourquoi il voulait toujours faire concurrence à tout le monde, il aurait été bien embarrassé. Et après ? L’essentiel n’était pas de chercher à savoir « pourquoi » on courait, mais de courir, de sentir « comment » on courait. Dans sa famille, à Hambourg, on était pirate de père en fils depuis des siècles. Aussi loin qu’on remontait, on trouvait un Kallenberg debout sur un navire, à la poursuite d’une proie. Pour rompre la tradition, son père, qui sur le tard s’était piqué d’honorabilité, avait souhaité qu’il devînt diplomate ; n’épargnant aucun effort pour qu’il y arrivât. Alors qu’il ne pensait qu’à la mer, Herman s’était vu exilé en Suisse, dérision dont il était le seul à goûter l’amertume. Il se lia surtout avec des fils d’émirs, des fils de banquiers, ne perdant jamais de vue son but unique, régner un jour sur les océans.
Lorsque, ses humanités terminées, son père l’envoya en Angleterre pour y poursuivre ses études à Oxford, il ne rechigna pas trop. Au moins, là, il était dans une île, et bien qu’il ne vît pas la mer, il en imaginait la masse autour de lui, au-delà de ces déprimants pâturages, aux horizons limités par des collines molles, peuplées de vaches. Ses lectures favorites étaient les journaux de bourse dont les cours, aux fluctuations qu’il apprenait à prévoir, lui faisaient battre le cœur. Il se fit enseigner l’arabe, pressentant que cette arme lui serait utile plus encore que l’allemand, le grec, le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais, qu’il parlait couramment, pour édifier son futur empire. Il y tenait. Il s’était résigné depuis longtemps à subir les désagréments de la petite déficience physique qui le gênait beaucoup lorsque, dans les vestiaires d’un terrain de sport, il était obligé de se dévêtir devant ses camarades. Il s’arrangeait pour toujours tenir une serviette enroulée autour de ses reins, attendant pour s’en dessaisir que l’eau fumante de la douche vienne l’asperger. Même avec ces précautions, il n’avait pu éviter une ou deux remarques ironiques qui l’avaient fait rougir, lui, le colossal Herman, jusqu’aux oreilles. D’un air méprisant, il avait répondu à ces trouble-fête qu’ils n’y connaissaient rien, que le volume au repos n’avait aucune signification puisqu’il s’agissait d’une espèce d’éponge qui se gonflait prodigieusement sous l’afflux du sang et que lui, Kallenberg, les mettait au défi de l’égaler lorsqu’il était en érection. Évidemment, il lui avait été impossible de tenir le même raisonnement aux premières filles qu’il avait honorées, et dont le mutisme à ce sujet l’avait plongé dans un malaise plus profond que des remarques précises. Une seule avait osé y faire allusion, une petite rousse qu’il avait draguée lors d’un bal à l’université. Elle lui avait dit en riant :
« Mais dis donc ! Tu es monté comme un ouistiti ! »
Il ne lui en avait pas voulu, préférant cette franchise tendre et sans malice aux silences pleins de sous-entendus. Et il s’était employé pour que ce détail fût oublié au cours de leurs ébats.
D’ailleurs, il faisait tout pour l’oublier lui-même, coléreux, agressif, fascinant son entourage par son aplomb, son culot imperturbable, premier en tout, prenant le pas sur autrui grâce à sa force physique, sa ruse, ses feintes et son charme, jouant les attendris pour mieux poignarder, les enfants perdus, ce qui attirait les femmes, trichant d’une façon éhontée à tous les jeux, sans peur et sans remords.
À la fin de ses études, son père lui demanda de quelle manière il allait aborder la « carrière » : le vieux Kallenberg, ivre d’orgueil, le voyait déjà troisième secrétaire d’ambassade dans une lointaine république sud-américaine. Froidement, Herman lui annonça qu’il ne serait pas diplomate, qu’il allait se lancer dans les affaires mais que, pour le consoler, il était sur le point d’épouser la femme d’un ambassadeur. Il l’avait rencontrée à un thé, elle avait trente ans, lui, vingt-deux. Elle avait été éblouie par son physique, il avait été subjugué par ses relations.
Immédiatement, il plaça les capitaux qu’elle avait de disponibles dans l’achat à Athènes de vieux rafiots destinés à la casse. Avec l’argent qui lui restait, il paya une équipe d’ouvriers, chargés de leur faire perdre leur allure d’épaves et de leur redonner une apparence de navires. Sur les carcasses pourries, on passa des couches de peinture si épaisses que les coques, aux joints disloqués, s’en retrouvèrent pratiquement soudées. Il ne lui restait plus qu’à créer une société de transports maritimes, à faire assurer sa flotte et à aller chercher le client. Évidemment, les hommes d’équipage couraient des risques, mais Herman n’avait pas cédé à la mode en usage chez certains professionnels véreux : dans un premier temps, faire maquiller d’abominables rafiots par des équipes de truands, spécialistes du camouflage et du naufrage en tout genre. Ensuite, mystifier les experts des compagnies qui assuraient ces carcasses retapées et pimpantes à un taux cent fois supérieur à leur valeur réelle. Après quoi, il n’y avait plus qu’à faire couler cette flotte fantôme. Des marins, complices de la combine, remorquaient les épaves au large, faisaient un trou dans la coque, lançaient un S.O.S., se faisaient sauver par les autorités maritimes et recommençaient un mois plus tard l’opération naufrage. Un bon truc consistait à se placer sur la route des navires de ligne et à se faire éperonner, ce qui conférait un cachet d’authenticité à la manœuvre.
Avec les gains de ces premiers frets, dont les tarifs étaient bien plus bas que ceux de la concurrence, Kallenberg acheta des navires solides, réservant une partie de ses capitaux à l’acquisition de chalutiers à la retraite dont les capitaines avaient reçu l’ordre de pousser les chaudières jusqu’à l’agonie. À vingt-quatre ans, alors que ses condisciples hésitaient toujours sur le choix d’une profession, Herman était riche. Sa réussite s’annonçait bien…
Au sommet de la hiérarchie dans laquelle il se hissait, se trouvait l’intouchable Mikolofides. Sur sa route, essayait également de lui mettre des bâtons dans les roues un garçon de son âge dont on faisait déjà grand cas, Socrate Satrapoulos. Kallenberg était bien placé pour savoir que le Grec usait, pour s’enrichir, de méthodes similaires, naufrageur de vocation et tout aussi dénué de scrupules. La compétition excitait Herman, qui la prévoyait à couteaux tirés, sans entraves d’aucune sorte, tapissée allègrement de peaux de banane par leurs soins réciproques. Ce qui l’agaçait, c’était l’avance imperceptible que Satrapoulos prenait constamment sur lui, comme s’il avait pu avoir les mêmes idées que les siennes, mais quelques heures plus tôt. Pourtant, S.S. n’avait ni sa séduction ni sa culture. Il était de manières frustes, petit, pas beau, plutôt roux et myope de surcroît. Simplement, il avait une espèce de génie pour détecter la bonne affaire, de préférence en marge de la légalité.
Barbe-Bleue s’en aperçut au moment de la guerre d’Espagne, manne de tous les armateurs, Mikolofides en tête, qui avaient transformé leur flottille de pêche en transport d’armes, leur faisant remonter de nuit les côtes d’Espagne pour livrer, indifféremment, aux franquistes ou aux républicains. Chaque fois que Kallenberg avait vent d’un marché à conclure, il se trouvait que Satrapoulos l’avait déjà enlevé la veille. Heureusement, les commandes ne manquaient pas et les livraisons lui rapportaient d’effarants bénéfices, immédiatement investis dans d’autres achats. Kallenberg jouait également en bourse, avec des méthodes qui faisaient frémir les observateurs, car elles auraient provoqué la ruine de n’importe qui. Ses rivaux attribuaient à la chance des succès obtenus par des systèmes de placement parfaitement illogiques en apparence. En réalité, ils obéissaient à une rigueur absolue. Barbe-Bleue s’était rendu compte qu’en matière de finances, les mêmes causes n’engendraient pas forcément les mêmes effets. Non à cause des incidences économiques, prévisibles parce que s’étant déjà répétées dans le passé, mais à cause des hommes qui, précisément, les avaient prévues. Si, dans une course de chevaux, trois personnes, et trois seulement, pouvaient connaître le nom du gagnant, elles se partageraient la totalité des mises de tous les autres parieurs. Si, par contre, un million de parieurs sont au courant de ces prévisions, chacun d’eux, bien qu’ayant misé le bon cheval, n’aura droit qu’à une somme dérisoire.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Le Grec»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Le Grec» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Le Grec» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.