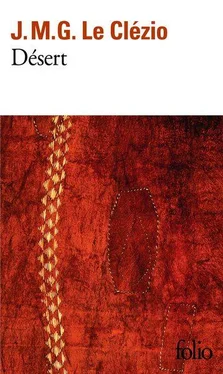Plus loin, il y a le tournant de rue où l’on voit en contrebas, comme du haut d’un balcon, le grand carrefour des avenues, pareil à l’estuaire d’un fleuve, et toutes les lumières qui clignotent, qui aveuglent. Alors Lalla descend la colline, le long des escaliers, elle entre par le passage de Lorette, elle traverse la grande cour aux murs noircis par la fumée et la misère, avec le bruit des radios et des voix humaines. Elle s’arrête un instant, la tête tournée vers les fenêtres, comme si quelqu’un allait apparaître. Mais on n’entend que le bruit inhumain d’une voix de radio qui crie quelque chose, qui répète lentement la même phrase :
« Au son de cette musique les dieux entrent en scène ! »
Mais Lalla ne comprend pas ce que cela veut dire. La voix inhumaine couvre le bruit des enfants qui toussent, le bruit des hommes ivres et de la femme qui pleurniche. Ensuite, il y a un autre passage obscur, comme un corridor, et on débouche sur le boulevard.
Ici, pendant un instant, Lalla ne sent plus la peur, ni la tristesse. La foule se hâte sur les trottoirs, yeux étincelants, mains agiles, pieds qui frappent le sol de ciment, hanches qui bougent, vêtements qui se froissent, s’électrisent. Sur la chaussée roule les autos, les camions, les motos aux phares allumés, et les reflets des vitrines s’allument et s’éteignent tout le temps. Lalla se laisse porter par le mouvement des gens, elle ne pense plus à elle, elle est vide, comme si elle n’existait plus réellement. C’est pour cela qu’elle retourne toujours aux grandes avenues, pour se perdre dans leur flot, pour aller à la dérive.
Il y a beaucoup de lumières ! Lalla les regarde en marchant droit devant elle. Les lumières bleues, rouges, orangées, violettes, les lumières fixes, celles qui avancent, celles qui dansent sur place comme des flammes d’allumettes. Lalla pense un peu au ciel constellé, à la grande nuit du désert, quand elle était étendue sur le sable dur à côté du Hartani, et qu’ils respiraient doucement, comme s’ils n’avaient qu’un seul corps. Mais c’est difficile de se souvenir. Il faut marcher, ici, marcher, avec les autres, comme si on savait où on allait, mais il n’y a pas de fin au voyage, pas de cachette au creux de la dune. Il faut marcher pour ne pas tomber, pour ne pas être piétiné par les autres.
Lalla descend jusqu’au bout de l’avenue, puis elle remonte une autre avenue, une autre encore. Il y a toujours les lumières, et le bruit des hommes et de leurs moteurs rugit sans cesse. Alors, tout d’un coup, la peur revient, l’angoisse, comme si tous les bruits de pneus et de pas traçaient de grands cercles concentriques sur les bords d’un gigantesque entonnoir.
Maintenant, Lalla les voit, de nouveau : ils sont là partout, assis contre les vieux murs noircis, tassés sur le sol au milieu des excréments et des immondices : les mendiants, les vieillards aveugles aux mains tendues, les jeunes femmes aux lèvres gercées, un enfant accroché à leur sein flasque, les petites filles vêtues de haillons, le visage couvert de croûtes, qui s’accrochent aux vêtements des passants, les vieilles couleur de suie, aux cheveux emmêlés, tous ceux que la faim et le froid ont chassés des taudis, et qui sont poussés comme des rebuts par les vagues. Ils sont là, au centre de la ville indifférente, dans le bruit saoulant des moteurs et des voix, mouillés de pluie, hérissés par le vent, plus laids et plus pauvres encore à la lueur mauvaise des ampoules électriques. Ils regardent ceux qui passent avec des yeux troubles, leurs yeux humides et tristes qui fuient et reviennent sans cesse vers vous comme les yeux des chiens. Lalla marche lentement devant les mendiants, elle les regarde, le cœur serré, et c’est encore ce vide terrible qui creuse son tourbillon ici, devant ces corps abandonnés. Elle marche si lentement qu’une clocharde l’attrape par son manteau et veut la tirer vers elle. Lalla se débat, défait avec violence les doigts qui se nouent sur l’étoffe de son manteau ; elle regarde avec pitié et horreur le visage encore jeune de la femme, ses joues bouffies par l’alcool, tachées de rouge à cause du froid, et surtout ces deux yeux bleus d’aveugle, presque transparents, où la pupille n’est pas plus grande qu’une tête d’épingle.
« Viens ! Viens ici ! » répète la clocharde, tandis que Lalla essaie de détacher les doigts aux ongles cassés. Puis la peur est la plus forte, et Lalla arrache son manteau des mains de la clocharde, et elle se sauve en courant, tandis que les autres mendiants se mettent à rire et que la femme, à demi dressée sur le trottoir au milieu de ses tas de hardes, se met à hurler des injures.
Le cœur battant, Lalla court le long de l’avenue ; elle heurte les gens qui se promènent, qui entrent et sortent des cafés, des cinémas ; des hommes en complet veston, qui viennent de dîner, et qui ont encore le visage tout luisant de l’effort qu’ils ont fait pour trop manger et trop boire ; des garçons parfumés, des couples, des militaires en vadrouille, des étrangers à la peau noire et aux cheveux crépus, qui lui disent des mots qu’elle ne comprend pas, ou qui essaient de l’attraper au passage en riant très fort.
Dans les cafés, il y a une musique qui n’arrête pas de battre, une musique lancinante et sauvage qui résonne sourdement dans la terre, qui vibre à travers le corps, dans le ventre, dans les tympans. C’est toujours la même musique qui sort des cafés et des bars, qui cogne avec la lumière des tubes de néon, avec les couleurs rouges, vertes, orange, sur les murs, sur les tables, sur les visages peints des femmes.
Depuis combien de temps Lalla avance-t-elle au milieu de ces tourbillons, de cette musique ? Elle ne le sait plus. Des heures ; peut-être, des nuits entières, des nuits sans aucun jour pour les interrompre. Elle pense à l’étendue des plateaux de pierres, dans la nuit, aux monticules de cailloux tranchants comme des lames, aux sentiers des lièvres et des vipères sous la lune, et elle regarde autour d’elle, ici, comme si elle allait le voir apparaître. Le Hartani vêtu de son manteau de bure, aux yeux brillants dans son visage très noir, aux gestes longs et lents comme la démarche des antilopes. Mais il n’y a que cette avenue, et encore cette avenue, et ces carrefours pleins de visages, d’yeux, de bouches, ces voix criardes, ces paroles, ces murmures. Ces bruits de moteurs et de klaxons, ces lumières brutales. On ne voit pas le ciel, comme s’il y avait une taie blanche qui recouvrait la terre. Comment pourraient-ils venir jusqu’ici, le Hartani, et lui, le guerrier bleu du désert, Es Ser, le Secret, comme elle l’appelait autrefois ? Ils ne pourraient pas la voir à travers cette taie blanche, qui sépare cette ville du ciel. Ils ne pourraient pas la reconnaître, au milieu de tant de visages, de tant de corps, avec toutes ces autos, ces camions, ces motocyclettes. Ils ne pourraient même pas entendre sa voix, ici, avec tous ces bruits de voix qui parlent dans toutes les langues, avec cette musique qui résonne, qui fait trembler le sol. C’est pour cela que Lalla ne les cherche plus, ne leur parle plus, comme s’ils avaient disparu pour toujours, comme s’ils étaient morts pour elle.
Les mendiants sont là, au cœur même de la ville, dans la nuit. La pluie a cessé de tomber, et la nuit est très blanche, lointaine, allée jusqu’à minuit. Les hommes sont rares. Ils entrent et sortent des cafés et des bars, mais ils s’enfuient en auto à toute vitesse. Lalla tourne à droite, dans la rue étroite qui monte un peu, et elle marche en se dissimulant derrière les autos arrêtées. Sur l’autre trottoir, il y a quelques hommes. Ils sont immobiles, ils ne parlent pas. Ils regardent vers le haut de la rue, l’entrée d’un immeuble sordide, une toute petite porte peinte en vert, à demi ouverte sur un couloir éclairé.
Читать дальше