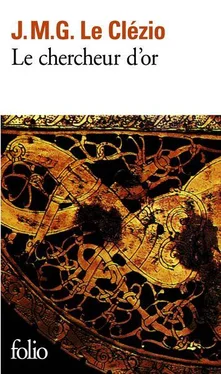Aujourd’hui, dès l’aube je suis au pied de la falaise de l’ouest. La lumière éclaire à peine les roches noires, et dans l’échancrure de l’Anse, la mer est d’un bleu translucide, plus clair que le ciel. Comme chaque matin, j’entends les cris des oiseaux de mer qui traversent la baie, escadrilles de cormorans, mouettes et fous lançant leurs appels rauques, en route vers la baie Lascars. Jamais je n’ai été aussi content de les entendre. Il me semble que leurs cris sont des saluts qu’ils m’adressent en passant au-dessus de l’Anse, et je leur réponds en criant moi aussi. Quelques oiseaux volent au-dessus de moi, des sternes aux ailes immenses, des pétrels rapides. Ils tournent près de la falaise, puis rejoignent les autres sur la mer. J’envie leur légèreté, la rapidité avec laquelle ils glissent dans l’air, sans s’attacher à la terre. Alors je me vois, accroché au fond de cette vallée stérile, mettant des jours, des mois à reconnaître ce que le regard des oiseaux a balayé en un instant. J’aime les voir, je partage un peu de la beauté de leur vol, un peu de leur liberté.
Ont-ils besoin d’or, de richesses ? Le vent leur suffit, le ciel du matin, la mer qui regorge de poissons, et ces rochers qui émergent, leur seul abri contre les tempêtes.
Je me suis dirigé guidé par l’intuition vers la falaise noire, où j’ai distingué des anfractuosités depuis l’autre versant de la vallée. Le vent me bouscule, m’enivre, tandis que je grimpe en m’aidant des broussailles. Tout à coup, le soleil apparaît au-dessus des collines de l’est, magnifique, éblouissant, allumant les étincelles sur la mer.
J’examine la falaise morceau par morceau. Je sens la brûlure du soleil qui monte lentement. Vers midi, j’entends un appel. C’est le jeune Fritz qui m’attend en bas, près du campement. Je redescends pour me reposer. Mon enthousiasme du matin est bien retombé. Je me sens las, découragé. À l’ombre du tamarinier, je mange le riz blanc en compagnie de Fritz. Quand il a fini de manger, il attend en silence, les yeux fixés au loin, dans cette attitude impassible qui caractérise les Noirs d’ici.
Je pense à Ouma, si farouche, si mobile. Reviendra-t-elle ? Chaque soir, avant le coucher du soleil, je longe la rivière Roseaux jusqu’aux dunes, je cherche ses traces. Pourquoi ? Que pourrais-je lui dire ? Mais il me semble qu’elle est la seule qui comprenne ce que je suis venu chercher ici.
Cette nuit, quand les étoiles apparaissent une à une dans le ciel, au nord, le petit Chariot, puis Orion, Sirius, je comprends soudain mon erreur : lorsque j’ai situé la ligne est-ouest, en partant de la marque de l’organeau, je me suis servi comme repère du nord magnétique indiqué par ma boussole. Le Corsaire qui traçait ses plans et marquait ses points de repère sur les rochers n’utilisait pas la boussole. C’était certainement l’étoile du nord qui lui servait d’indication, et c’est par rapport à cette direction qu’il a établi la perpendiculaire est-ouest. La différence entre le nord magnétique et le nord stellaire étant de 7°36, cela signifie une différence de près de cent pieds à la base de la falaise c’est-à-dire sur l’autre pan de roche qui forme le premier contrefort du Comble du Commandeur.
Je suis tellement ému par cette découverte que je ne peux me résoudre à attendre jusqu’au lendemain. Muni de ma lampe tempête, pieds nus, je marche jusqu’à la falaise. Le vent souffle avec violence, portant les nuages d’embruns. À l’abri des racines du vieux tamarinier, je n’avais pas entendu la tempête. Mais ici elle me fait tituber, elle siffie dans mes oreilles et fait vaciller la flamme de la lampe.
Je suis maintenant au pied de la falaise noire, et je cherche un passage. La paroi est tellement abrupte que je dois prendre la lampe entre mes dents pour escalader. Ainsi, j’arrive jusqu’à une corniche, à mi-hauteur, et je commence à chercher la marque, le long de la falaise qui s’effrite. Éclairée par la lampe, la paroi de basalte prend un aspect étrange, infernal. Chaque creux, chaque fissure me fait tressaillir. Je parcours ainsi toute la corniche, jusqu’au ravin qui sépare ce pan de falaise du piton qui domine la mer. Je suis étourdi par les rafales de vent froid, par le grondement de la mer toute proche, par l’eau qui ruisselle sur mon visage. Alors que je m’apprête à redescendre, épuisé, j’aperçois une large roche au-dessus de moi, et je sais que le signe doit être là, j’en suis sûr. C’est le seul rocher visible de n’importe quel point de la vallée. Pour l’atteindre, je dois faire un détour, suivre un chemin qui s’éboule. Quand j’arrive enfin devant le rocher, avec la lampe tempête entre mes dents, je vois l’organeau. Il est gravé avec une telle netteté que j’aurais pu le voir sans la lampe. Ses bords sont coupants sous mes doigts comme s’ils avaient été sculptés hier. La pierre noire est froide, glissante. Le triangle est dessiné la pointe vers le haut, à l’inverse de l’organeau de l’ouest. II semble sur le rocher un œil mystérieux qui regarde de l’autre côté du temps, contemplant éternellement l’autre versant de la vallée, sans faiblir, chaque jour, chaque nuit. Un frisson parcourt mon corps. Je suis entré dans un secret plus fort, plus durable que moi. Jusqu’où me conduira-t-il ?
Après cela, j’ai vécu dans une sorte de rêve éveillé, où se mêlaient la voix de Laure, et celle de Mam sur la varangue du Boucan, au message du Corsaire inconnu, et à l’image fugitive d’Ouma glissant entre les buissons, vers le haut de la vallée. La solitude s’est resserrée sur moi. Hormis le jeune Fritz Castel, je ne vois personne. Même lui ne vient plus aussi régulièrement. Hier (ou avant-hier, je ne sais plus) il a posé la marmite de riz sur une pierre, devant le campement, puis il est reparti en escaladant la colline de l’ouest, sans répondre à mes appels. Comme si je lui faisais peur.
A l’aube, je suis allé comme chaque matin vers l’estuaire de la rivière. J’ai pris ma trousse de toilette, avec rasoir, savon et brosse, ainsi que le linge à laver. Posant le miroir sur un caillou, j’ai commencé par raser ma barbe, puis j’ai coupé mes cheveux qui tombaient sur mes épaules. Dans le miroir, j’ai regardé mon visage maigre, noirci par le soleil, mes yeux brillants de fièvre. Mon nez, qui est mince et busqué comme chez tous les mâles du nom de L’Etang, accentue encore l’expression perdue, presque famélique, et je crois bien qu’à force de marcher sur ses traces, j’ai commencé à ressembler au Corsaire inconnu qui a habité ces lieux.
J’aime bien être ici, à l’estuaire de la rivière Roseaux, là où commencent les dunes de la plage, où l’on entend la mer toute proche, sa respiration lente, tandis que le vent entre par rafales au milieu des euphorbes et des roseaux, et fait grincer les palmes. Ici, à l’aube, la lumière est si douce, si calme, et l’eau lisse comme un miroir. Quand j’ai fini de me raser, de me laver et de laver mon linge, alors que je m’apprête à retourner vers le campement, je vois Ouma. Elle est debout devant la rivière, son harpon à la main, et elle me regarde sans gêne, avec quelque chose de moqueur dans le regard. J’ai souvent espéré la rencontrer ici, sur la plage, à la marée basse, quand elle revient de la pêche, et pourtant je suis étonné et je reste immobile, avec mon linge mouillé qui s’égoutte à mes pieds.
Dans la lumière du jour qui commence, près de l’eau, elle est encore plus belle, sa robe de toile et sa chemise trempées d’eau de mer, son visage couleur de cuivre, couleur de lave, brillant de sel. Elle est ainsi, debout, une jambe tendue et son corps incliné sur sa hanche gauche, tenant dans sa main droite le harpon de roseau à la pointe de bois d’ébène, la main gauche appuyée sur son épaule droite, drapée dans ses vêtements mouillés, telle une statue antique. Je reste à la regarder, sans oser parler, et je pense malgré moi à Nada, si belle et mystérieuse, comme elle apparaissait autrefois sur les images des anciens journaux, dans la pénombre du grenier de notre maison. Je fais un pas en avant, et j’ai le sentiment de rompre un enchantement. Ouma se détourne, elle s’en va à grandes enjambées le long du lit de la rivière.
Читать дальше