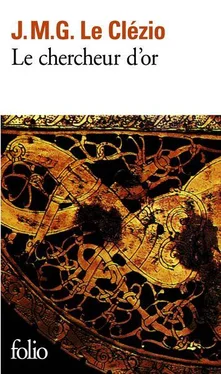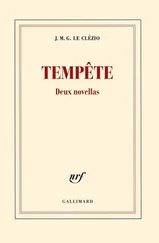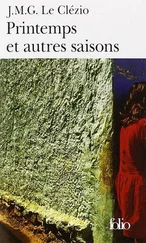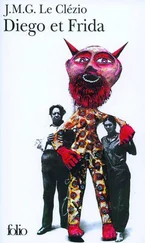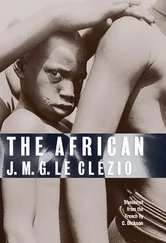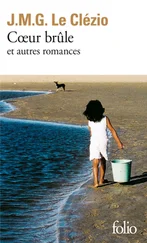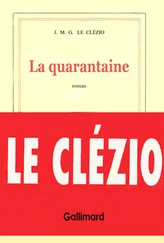J’essaye de situer les lignes parallèles et les cinq points qui ont servi de repères sur le plan du Corsaire. Les points étaient certainement les sommets des montagnes qu’on aperçoit à l’entrée de l’Anse. Le soir, avant la nuit, je suis allé jusqu’à l’embouchure de la rivière, et j’ai vu les sommets des montagnes encore éclairés par le soleil, et j’ai senti à nouveau cette émotion, comme si quelque chose allait apparaître.
Sur le papier je trace sans cesse les mêmes lignes : la courbe de la rivière que je connais, puis la vallée rectiligne qui s’enfonce entre les montagnes. Les collines, de chaque côté, sont des forteresses de basalte au-dessus de la vallée.
Aujourd’hui, quand le soleil décline, je décide de remonter le flanc de la colline de l’est, à la recherche des marques des « organeaux » laissées par le Corsaire. S’il est réellement venu ici, comme cela semble de plus en plus clair, il est impossible que le marin n’ait pas laissé ces marques sur les rochers de la falaise, ou sur quelque pierre à demeure. La pente du glacis est plus praticable de ce côté, mais le sommet recule au fur et à mesure que je grimpe. Ce qui, vu de loin, me semblait une paroi unie, est une série de marches qui me désorientent. Bientôt je suis si loin de l’autre versant que j’ai du mal à distinguer la tache blanche de la voile qui me sert d’abri. Le fond de la vallée est un désert gris et vert parsemé de blocs noirs, où le lit de la rivière disparaît. À l’entrée de la vallée, je vois la haute falaise de la pointe Vénus. Comme je suis seul ici, bien que les hommes soient proches ! C’est peut-être cela qui m’inquiète le plus : je pourrais mourir ici, personne ne s’en apercevrait. Peut-être un pêcheur d’hourites verrait un jour les restes de mon bivouac et viendrait. Ou bien tout serait emporté par les eaux et par le vent, confondu avec les pierres et les arbres brûlés.
Je regarde attentivement la colline ouest, en face de moi. Est-ce une illusion ? Je vois un M majuscule sculpté dans la roche, un peu au-dessus de la pointe Vénus. À la lumière frisante du crépuscule, il paraît avec netteté, comme fracturé dans la montagne par une main géante. Plus loin, au sommet d’un piton, il y a une tour en pierres à demi ruinée, que je n’avais pas vue en installant mon campement juste en dessous.
La découverte de ces deux repères me trouble. Sans attendre, je dévale la pente de la colline, et je traverse la vallée en courant, pour arriver avant la nuit. Je traverse le cours d’eau de la rivière Roseaux en faisant jaillir l’eau fraîche, puis je remonte la colline de l’ouest, par l’éboulis que j’ai emprunté la première fois.
Arrivé en haut de la pente, je cherche en vain le dessin du « M » : il s’est défait devant moi. Les pans de rocher qui formaient les jambes du « M » se sont écartés, et au centre, il y a une sorte de plateau où croissent des arbustes bousculés par le vent. Tandis que j’avance, penché pour lutter contre les bourrasques, j’entends des pierres s’écrouler. Entre les euphorbes et les vacoas, je crois apercevoir des formes brunes qui s’échappent. Ce sont des cabris sauvages, peut-être échappés d’un troupeau de manafs.
Enfin, j’arrive devant la tour. Au sommet de la falaise, elle surplombe la vallée déjà dans l’ombre. Comment ne l’ai-je pas vue depuis mon arrivée ? C’est une tour écroulée sur un côté, faite de larges blocs de basalte assemblés sans mortier. D’un côté, il y a les restes d’une porte, ou d’une meurtrière. J’entre à l’intérieur de la ruine, je m’accroupis pour m’abriter du vent. Par l’ouverture, je vois la mer. Dans le crépuscule, elle est sans fin, d’un bleu imprégné de violence, voilée à l’horizon par la brume grise qui la confond avec le ciel.
Du haut de la falaise, on embrasse la mer depuis la rade de Port Mathurin jusqu’à la pointe est de l’île. Je comprends alors que cette tour bâtie à la hâte n’est ici que pour surveiller la mer et prévenir l’arrivée d’ennemis. Qui a fait construire cette vigie ? Ce ne peut être l’Amirauté britannique, qui ne craignait plus rien de la mer, étant maîtresse de la route des Indes. D’ailleurs, ni la marine anglaise, ni celle du roi de France n’auraient fait une construction aussi précaire, aussi isolée. Pingre ne parle pas de cette construction dans le récit de son voyage, lors de la première observation du transit de Vénus en 1761. En revanche, je me souviens maintenant du premier camp anglais à la pointe Vénus, en 1810, sur le site du futur observatoire, là où je suis, précisément. Le Mauritius Almanach, lu à la bibliothèque Carnegie, parlait d’une petite « batterie » construite à l’intérieur de la gorge, surveillant la mer. Tandis que la nuit tombe, mon esprit fonctionne avec une sorte de hâte nerveuse, comme dans ces rêveries qui conduisent au sommeil. Pour moi-même, je récite à voix haute les phrases que j’ai lues si souvent dans la lettre de Nageon de Lestang, écrite d’une main longue et penchée sur un papier déchiré :
« Pour une première marque, prenez une pierre de pgt
En prendre la 2° V, là faire Sud Nord,
un cullot de même.
Et de la source Est faire un angle comme un organeau
La marque sur la plage de la source.
Pour e/o passez à la gauche
Pour là chacun de la marque BnShe
Là frottez contre la passe, sur quoi trouverez que pensez.
Cherchez : : S
Faire x — 1 do m de la diagonale dans la direction
du Comble du Commandeur. »
Je suis en ce moment assis sur les ruines de la vigie du Comble du Commandeur, tandis que l’ombre emplit déjà la vallée. Je ne sens plus la fatigue, ni les coups du vent froid, ni la solitude. Je viens de découvrir la première marque du Corsaire inconnu.
Les jours qui ont suivi la découverte du Comble du Commandeur, j’ai parcouru le fond de la vallée, en proie à une fièvre qui allait par instants jusqu’au délire. Je me souviens (bien que cela se trouble et s’échappe comme un rêve) de ces journées brûlantes sous le soleil d’avril, à l’époque des grands cyclones, je m’en souviens comme d’une chute dans un vide vertical, et de la brûlure de l’air quand ma poitrine soulève un poids de souffrance. De l’aube au crépuscule, je suis la marche du soleil dans le ciel, des collines solitaires de l’est jusqu’aux montagnes qui dominent le centre de l’île. Je vais à la manière du soleil, en arc de cercle, le pic sur l’épaule, mesurant au théodolite les accidents du terrain qui sont mes seuls points de repère. Je vois l’ombre des arbres girer lentement, s’allonger sur la terre. La chaleur du soleil me brûle à travers mes habits, et continue de me brûler au long des nuits, m’empêchant de dormir, se mêlant au froid qui sort de la terre. Certains soirs, je suis si fatigué de marcher que je me couche là où me prend la nuit, entre deux blocs de lave, et que je dors jusqu’au matin, quand la faim et la soif me réveillent.
Une nuit, je me réveille au centre de la vallée, je sens sur moi le souffle de la mer. Sur mon visage, dans mes yeux, il y a encore la tache éblouissante du soleil. C’est une nuit de lune noire, comme disait mon père autrefois. Les étoiles emplissent le ciel, et je les contemple, pris par cette folie. Je parle tout haut, je dis : je vois le dessin, il est là, je le vois. Le plan du Corsaire inconnu n’est autre que le dessin de la Croix du Sud et de ses « suiveuses », les « belles de nuit ». Sur l’étendue immense de la vallée, je vois briller les pierres de lave. Elles sont allumées comme des étoiles dans l’ombre poussiéreuse. Je marche vers elles, les yeux agrandis, je sens sur mon visage la braise de leurs lumières. La soif, la faim, la solitude tourbillonnent en moi, de plus en plus vite. J’entends une voix qui parle, avec les intonations de mon père. Cela me rassure d’abord puis me fait frissonner, car je m’aperçois que c’est moi qui parle. Pour ne pas tomber, je m’assois sur la terre, près du grand tamarinier qui m’abrite le jour. Le frisson continue ses vagues sur mon corps, je sens entrer en moi le froid de la terre et de l’espace.
Читать дальше