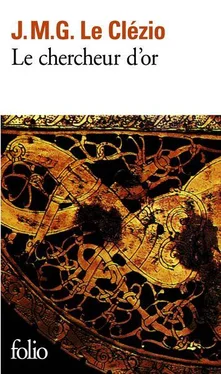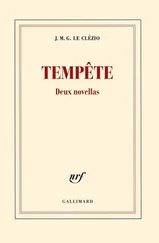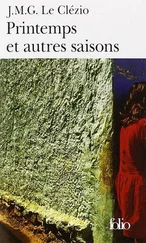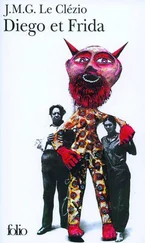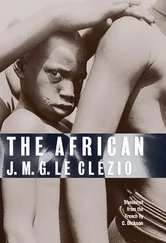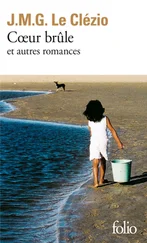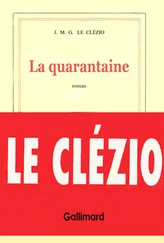C’est une pièce où nous n’entrons jamais, sauf en cachette, non pas que ce soit expressément défendu, mais il y a dans ce bureau une sorte de secret qui nous intimidait, nous effrayait même un peu. En ce temps-là, le bureau de mon père, c’est une longue chambre étroite, tout à fait au bout de la maison, prise entre le salon et la chambre à coucher de nos parents, une pièce silencieuse, ouverte au nord, avec un parquet et des murs en bois verni, et meublée seulement d’une grande table à écrire sans tiroirs et d’un fauteuil, et de quelques malles en métal contenant les papiers. La table se trouvait tout contre la fenêtre, de sorte que lorsque les volets étaient ouverts, Laure et moi pouvions voir, cachés derrière les arbustes du jardin, la silhouette de notre père en train de lire ou d’écrire, enveloppé dans les nuages de la fumée de cigarette. De son bureau, il pouvait voir les Trois Mamelles et les montagnes des gorges de la Rivière Noire, surveiller la marche des nuages.
Je me souviens alors d’être entré dans son bureau, retenant mon souffle presque, regardant les livres et les journaux empilés par terre, les cartes épinglées aux murs. La carte que je préfère, c’est celle des constellations, qu’il m’a déjà montrée pour m’enseigner l’astronomie. Quand nous entrons dans le bureau, nous lisons avec émotion les noms des étoiles et des figures du ciel : Sagittaire, guidé par l’étoile Nunki. Lupus, Aquila, Orion. Bootes, qui porte à l’est Alphecca, à l’ouest Arcturus. Scorpio au dessin menaçant, portant à la queue, comme un dard lumineux, l’étoile Shaula, et dans sa tête la rouge Antarès. La Grande Ourse, chaque étoile dans sa courbe :
Alkaïd, Mizar, Alioth, Megrez, Phecda, Dubhe, Merak. Auriga, dont l’étoile majeure résonne bizarrement dans ma mémoire, Menikalinan.
Je me souviens du Grand Chien, qui porte dans sa gueule, comme un croc, la belle Sirius, et en bas un triangle où palpite Adhara. Je vois encore le dessin parfait, celui que j’aime le plus, et que j’ai cherché nuit après nuit dans le ciel d’été, au sud, dans la direction du Morne : le navire Argo , que je dessine parfois dans la poussière des chemins, comme ceci :

Mon père est debout, il parle, et je ne comprends pas bien ce qu’il dit. Ce n’est pas vraiment à moi qu’il parle, pour cet enfant aux cheveux trop longs, au visage hâlé par le soleil, aux habits déchirés par les courses dans les broussailles et les champs de canne. Il parle à lui-même, ses yeux brillent, sa voix est un peu étouffée par l’émotion. Il parle de cet immense trésor qu’il va découvrir, car il sait enfin l’endroit où il se cache, il a découvert l’île où le Corsaire inconnu a placé son dépôt. Il ne dit pas le nom du corsaire, mais seulement, comme je le lirai plus tard dans ses documents, le Corsaire inconnu, et ce nom aujourd’hui encore me semble plus vrai et plus chargé de mystère que n’importe quel autre nom. Il me parle pour la première fois de l’île Rodrigues, une dépendance de Maurice, à plusieurs jours de bateau. Sur le mur de son bureau, il a épingle un relevé de l’île, recopié par lui à l’encre de Chine et colorié à l’aquarelle, couvert de signes et de points de repère. Au bas de la carte, je me souviens d’avoir lu ces mots : Rodriguez Island , et au-dessous : Admiralty Chart, Wharton, 1876 . J’écoute mon père sans l’entendre, comme au fond d’un rêve. La légende du trésor, les recherches que l’on a faites depuis cent ans, à l’île d’Ambre, à Flic en Flac, aux Seychelles. C’est peut-être l’émotion, ou l’inquiétude, qui m’empêchent de comprendre, parce que je devine que c’est la chose la plus importante du monde, un secret qui peut, à chaque instant, nous sauver ou nous perdre. Il n’est plus question de l’électricité maintenant, ni d’aucun autre projet. La lumière du trésor de Rodrigues m’éblouit, et fait pâlir toutes les autres. Mon père parle longuement, cet après-midi-là, marchant de long en large dans la chambre étroite, soulevant des papiers pour les regarder, puis les reposant sans même me les montrer, tandis que je reste debout près de sa table, sans bouger, regardant furtivement la carte de l’île Rodrigues épinglée sur le mur à côté du plan du ciel. C’est peut-être pour cela que, plus tard, je garderai cette impression que tout ce qui est arrivé par la suite, cette aventure, cette quête, étaient dans les contrées du ciel et non pas sur la terre réelle, et que j’avais commencé mon voyage à bord du navire Argo .
Ce sont les derniers jours de l’été, et ils me semblent très longs, chargés de tant d’événements, à chaque moment du jour ou de la nuit : ils sont plutôt des mois ou des années, modifiant profondément l’univers autour de nous, et nous laissant vieux. Jours de canicule, quand l’air est dense, lourd et liquide sur la vallée de Tamarin, et qu’on se sent prisonnier du cirque des montagnes. Au-delà, le ciel est clair, changeant, les nuages glissent dans le vent, leur ombre court sur les collines brûlées. Les dernières récoltes vont bientôt se terminer, et la colère gronde chez les travailleurs des champs, parce qu’ils n’ont plus à manger. Parfois, le soir, je vois les fumées rouges des incendies dans les champs de canne, le ciel alors est d’une couleur étrange, menaçante, rougeoyante qui fait mal aux yeux et serre la gorge. Malgré le danger, je vais presque chaque jour à travers les plantations, pour voir les incendies. Je vais jusqu’à Yemen, quelquefois jusqu’à Tamarin Estate, ou bien remontant vers Magenta et Belle Rive. Du haut de la Tourelle, je vois d’autres fumées qui montent, au nord, du côté de Clarence, Marcenay, aux limites de Wolmar. Je suis seul maintenant. Depuis le voyage en pirogue, mon père m’a interdit de revoir Denis. Il ne vient plus au Boucan. Laure dit qu’elle a entendu son grand-père, le capt’n Cook, lui crier après parce qu’il était venu le voir malgré l’interdiction. Depuis, il a disparu. Cela m’a fait une impression de vide, de grande solitude, ici, comme si nous étions, mes parents, Laure et moi, les derniers habitants du Boucan.
Alors je m’en vais loin, de plus en plus loin. Je monte au sommet des murailles créoles, et je guette les fumées des révoltes. Je cours à travers les champs dévastés par la coupe. Il y a encore des travailleurs, par endroits, des femmes très pauvres et vieilles vêtues de gunny , qui glanent ou qui coupent l’herbe sifflette avec leurs serpes. Quand elles me voient, le visage hâlé et les vêtements tachés de terre rouge, pieds nus et portant mes souliers attachés autour du cou, elles me chassent en criant, parce qu’elles ont peur. Jamais aucun Blanc ne s’aventure jusqu’ici. Parfois aussi les sirdars m’insultent et me jettent des pierres, et je cours à travers les cannes jusqu’à perdre haleine. Je hais les sirdars. Je les méprise plus que tout au monde, parce qu’ils sont endurcis et méchants, et qu’ils battent les pauvres à coups de bâton quand les fardeaux de canne n’arrivent pas assez vite jusqu’à la charrette. Mais le soir, ils reçoivent double paye et ils se saoulent à l’arak. Ils sont lâches et obséquieux avec les field managers , ils leur parient en ôtant leur casquette et en feignant d’aimer ceux qu’ils ont maltraités auparavant. Dans les champs, il y a des hommes presque nus, le corps seulement couvert d’un haillon, qui arrachent les « chicots », les souches des vieilles cannes, avec ces lourdes pinces de fer qu’on appelle des « macchabées ». Ils portent les blocs de basalte sur l’épaule, jusqu’au char à bœufs, puis ils vont les entasser au bout du champ, construisant de nouvelles pyramides. Ce sont ceux que Mam appelle les « martyrs de la canne ». Ils chantent en travaillant, et j’aime bien entendre leurs voix monotones dans l’étendue solitaire des plantations, installé en haut d’une pyramide noire. J’aime bien chanter, pour moi-même, la vieille chanson en créole que le capt’n Cook chantait pour Laure et pour moi, quand nous étions tout petits, et qui dit :
Читать дальше