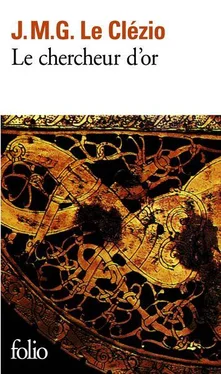Mo passé la rivière Tanier
rencontré en’grand maman,
Mo dire li qui li faire là
Li dire mo mo la pes cabot
Waï, waï, mo zenfant
Faut travaï pou gagn’son pain
Waï waï mo zenfant
Faut travaï pou gagn’son pain…
C’est là, sur le monticule de pierres, que je vois les fumées d’incendies du côté de Yemen et de Walhalla. Elles sont très proches, ce matin-là, tout près des baraquements de la rivière Tamarin, et je comprends qu’il est en train de se passer quelque chose de grave. Le cœur battant, je dévale à travers champs, jusqu’à la route de terre. Le toit bleu clair de notre maison est trop loin pour que je puisse avertir Laure de ce qui se passe. Déjà j’entends le bruit de l’émeute, en arrivant au gué du Boucan. C’est une rumeur comme celle de l’orage, qui semble venir de tous les côtés à la fois, qui résonne dans les gorges des montagnes. Il y a des cris, des grondements, des coups de feu aussi. Malgré la peur, je cours au milieu du champ de canne, sans prendre garde aux coupures. Arrivé tout d’un coup devant la sucrerie, je suis au milieu du bruit, je vois l’émeute. La foule des gunnies est massée devant la porte, toutes les voix crient ensemble. Devant la foule, il y a trois hommes à cheval, et j’entends le bruit des sabots sur les pavés quand ils font cabrer leurs montures. Au fond, je vois la gueule béante du four à bagasse, où tourbillonnent les étincelles.
La masse des hommes avance, recule, dans une sorte de danse étrange, tandis que les cris font une modulation stridente. Les hommes brandissent des sabres d’abattage, des faux, et les femmes des houes et des serpes. Pris par la peur, je reste immobile, tandis que la foule me bouscule, m’entoure. J’étouffe, je suis aveuglé par la poussière. À grand-peine, je me fraie un passage jusqu’au mur de la sucrerie. À cet instant, sans que je comprenne ce qui se passe, je vois les trois cavaliers qui s’élancent contre la foule qui les enserre. Les poitrails des chevaux poussent les hommes et les femmes, et les cavaliers frappent à coups de crosse. Deux chevaux s’échappent vers les plantations, poursuivis par les cris de colère de la foule. Ils sont passés si près de moi que je me suis jeté à terre dans la poussière, de peur d’être piétiné. Puis j’aperçois le troisième cavalier. Il est tombé de son cheval, et les hommes et les femmes le tiennent par les bras, le bousculent. Je reconnais son visage, malgré la peur qui le déforme. C’est un parent de Ferdinand, le mari d’une cousine, qui est field manager sur les plantations de l’oncle Ludovic, un certain Dumont. Mon père dit qu’il est pire qu’un sirdar, qu’il frappe les ouvriers à coups de canne, et qu’il vole la paye de ceux qui se plaignent de lui. Maintenant, ce sont les hommes des plantations qui le malmènent, lui donnent des coups, l’insultent, le font tomber par terre. Un instant, dans la foule qui le bouscule, il est si près de moi que je vois son regard égaré, j’entends le bruit rauque de sa respiration. J’ai peur, parce que je comprends qu’il va mourir. La nausée monte dans ma gorge, m’étouffe. Les yeux pleins de larmes, je me bats à coups de poing contre la foule en colère, qui ne me voit même pas. Les hommes et les femmes en gunny continuent leur danse étrange, leurs cris. Quand je parviens à sortir de la foule, je me retourne, et je vois l’homme blanc. Ses habits sont déchirés, et il est porté à bout de bras par des hommes noirs à demi nus, jusqu’à la gueule du four à bagasse. L’homme ne crie pas, ne bouge pas. Son visage est une tache blanche de peur, tandis que les Noirs le soulèvent par les bras et les jambes et commencent à le balancer devant la porte rouge du four. Je reste pétrifié, seul au milieu du chemin, écoutant les voix qui crient de plus en plus fort, et maintenant c’est comme un chant lent et douloureux qui rythme les balancements du corps au-dessus des flammes. Puis il y a un seul mouvement de la foule, et un grand cri sauvage, quand l’homme disparaît dans la fournaise. Alors tout d’un coup, la clameur se tait, et j’entends à nouveau le ronflement sourd des flammes, les g argo uillements du vesout dans les grandes cuves brillantes. Je ne peux pas détacher mon regard de la gueule flamboyante du four à bagasse, où maintenant les Noirs enfournent des pelletées de cannes séchées, comme si rien ne s’était passé. Puis lentement, la foule se divise. Les femmes en gunny marchent dans la poussière, le visage enveloppé dans leurs voiles. Les hommes s’éloignent vers les chemins des cannes, leur sabre à la main. Il n’y a plus de clameurs ni de bruits, seulement le silence du vent sur les feuilles de cannes tandis que je marche vers la rivière. C’est un silence qui est en moi, qui m’emplit et me donne le vertige, et je sais que je ne pourrai parler à personne de ce que j’ai vu ce jour-là.
Quelquefois, Laure vient avec moi dans les champs. Nous marchons sur les sentiers, au milieu des cannes coupées, et quand la terre est trop meuble, ou qu’il y a des monceaux de cannes abattues, je la porte sur mon dos pour qu’elle n’abîme pas sa robe et ses bottines. Elle a beau avoir un an de plus que moi, Laure est si légère et fragile que j’ai l’impression de porter un petit enfant. Elle aime beaucoup quand nous marchons comme cela, et que les feuilles coupantes des cannes s’écartent devant son visage et se referment derrière elle. Un jour, dans les combles, elle m’a montré un numéro ancien de l’ Illustrated London News avec un dessin qui représente Naomi portée sur les épaules d’Ali, au milieu des champs d’orge. Naomi rit aux éclats en arrachant les épis qui viennent frapper son visage. Elle me dit que c’est à cause de ce dessin qu’elle m’a appelé Ali. Laure me parle aussi de Paul et Virginie, mais c’est une histoire que je n’aime pas, parce que Virginie avait si peur de se déshabiller pour entrer dans la mer. Je trouve cela ridicule, et je dis à Laure que ce n’est sûrement pas une histoire vraie, mais cela la met en colère. Elle dit que je n’y comprends rien.
Nous allons vers les collines, là où commence le domaine de Magenta, et les « chassés » des riches. Mais Laure ne veut pas entrer dans la forêt. Alors nous redescendons ensemble vers la source du Boucan. Dans les collines, l’air est humide, comme si la brume du matin restait accrochée longtemps aux feuillages des arbustes. Laure et moi, nous aimons bien nous asseoir dans une clairière, quand les arbres sortent à peine de l’ombre de la nuit, et nous guettons le passage des oiseaux de mer. Quelquefois nous voyons passer un couple de pailles-en-queue. Les beaux oiseaux blancs sortent des gorges de la Rivière Noire, du côté de Mananava, et ils planent longuement au-dessus de nous, leurs ailes ouvertes, pareils à des croix d’écume, leurs longues queues traînant derrière eux. Laure dit qu’ils sont les esprits des marins morts en mer, et des femmes qui attendent leur retour, en vain. Ils sont silencieux, légers. Ils vivent à Mananava, là où la montagne est sombre et où le ciel se couvre. Nous croyons que c’est là que naît la pluie.
« Un jour, j’irai à Mananava. »
Laure dit :
« Cook dit qu’il y a toujours des marrons à Mananava. Si tu vas là-bas, ils te tueront. »
« Ce n’est pas vrai. Il n’y a personne là-bas. Denis est allé tout près, il m’a dit que quand on y arrive, tout devient noir, on dirait que la nuit tombe, alors il faut revenir en arrière. »
Laure hausse les épaules. Elle n’aime pas entendre ces choses-là. Elle se lève, elle regarde le ciel où les oiseaux ont disparu. Elle dit avec impatience :
« Allons ! »
Читать дальше