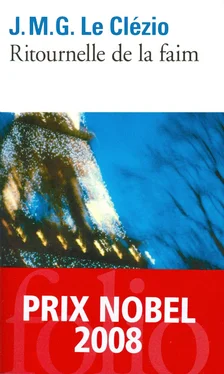La conversation roulait sur les mêmes sujets, mais on sentait bien qu’il n’y avait plus la même liberté. Naguère, avait constaté Éthel, les disputes les plus acrimonieuses, les tirades les plus emportées se terminaient par des rires. La tante Pauline, la tante Milou étaient de vraies Mauriciennes, qui savaient grincer, se moquer, qui étaient rompues à l’exercice de sortie du « sujet qui fâche ». À présent, leurs boutades ne décrochaient plus les mêmes rires. Justine, quant à elle, était franchement sinistre. Avant même que le café fût servi dans les tasses, toujours par Alexandre qui tenait à ce privilège, elle se levait de table et allait s’enfermer dans sa chambre, prétextant la migraine, un vertige, une faiblesse.
Éthel restait. Elle avait laissé sa place à côté de son père pour aller s’asseoir au fond de la salle, près de la fenêtre — et mieux s’éclipser. C’était ce que disait Alexandre, pour plaisanter. En même temps, il la regardait, du coin de l’œil. Après un bon mot, une tirade, il cherchait son approbation, il guettait un sourire. Ou parfois, et c’était cela qui la troublait davantage, il ne disait rien, il semblait perdu dans une rêverie, et son regard vide se tournait vers Éthel, un regard bleu-gris flottant, un peu triste. Elle aurait voulu dire quelque chose pour le rassurer.
Elle avait dix-huit ans. Elle n’avait rien vécu, rien connu, et pourtant c’était elle qui savait tout, qui comprenait tout, et Alexandre et Justine qui étaient semblables à des enfants. Semblables à des adolescents égoïstes et capricieux. Leurs passions, leurs jalousies, leurs petites actions mesquines et ridicules, ces mots glissés sous les portes, ces sous-entendus, paroles aigres, rancunières, petites vengeances, petits complots.
Un jour, à la sortie du lycée — c’était la dernière année, après cela l’inconnu s’ouvrait, la liberté —, les filles parlaient mariage. L’une d’elles, plutôt jolie, Florence de son prénom, avait annoncé son prochain mariage, les préparatifs, la robe, la corbeille, la bague, Dieu sait quoi. Éthel n’avait pu s’empêcher de ricaner : « Ça ressemble plutôt à une vente aux enchères, ton histoire. » Elle avait ajouté comme un défi : « Moi, je ne me marierai jamais. À quoi ça sert ? » Elle savait que ça serait commenté, rapporté, elle s’en fichait. « Les garçons, ce n’est pas ça qui manque, pas besoin d’un mariage pour vivre avec quelqu’un. » — « Et les enfants ? » Là, Éthel était contente de marquer un point : « Ah bon ? C’est pour les enfants que tu te maries ? Pour qu’après on te tienne en te menaçant de te les enlever ? Qui est-ce qui fait les enfants ? Pas les hommes, que je sache ! »
Puisqu’on parlait mariage, c’est justement à ce moment-là qu’est tombée la nouvelle. Un peu avant les vacances, en juin. Il faisait très doux, un ciel léger avec des nuages qui bourgeonnaient. Éthel attendait une lettre d’Angleterre, Laurent Feld avait terminé ses études, il viendrait, ils iraient se promener à Vincennes, et puis ils partiraient pour la Bretagne, il voulait louer des vélos à Quimper pour faire un grand tour, dormir dans les granges, visiter les petites églises.
C’est une lettre de faire part qui est arrivée. Justine ne l’avait pas ouverte, mais rien qu’à la voir, à la calligraphie enfantine, et avant même de lire le contenu, Éthel est allée comparer l’enveloppe à celles que Xénia lui avait envoyées. C’était bien elle qui avait écrit l’adresse et le faire-part, Éthel a reconnu sa façon de barrer les t et de faire le A majuscule en étoile :
À Mademoiselle Éthel Brun
E. V.
Elle s’était simplement appliquée pour faire joli, ce petit rien ridicule fit beaucoup de mal à Éthel, comme si ça ne suffisait pas qu’elle annonce ses fiançailles avec ce monsieur Donner, prénom Daniel, et ces adresses croisées, rue de Vaugirard, pour elle, villa Solferino, pour lui. Elle mignardisait.
Éthel a haussé les épaules. Les jours suivants, elle a voulu oublier. Le chantier de la rue de l’Armorique a retenu son attention. Elle y allait jusqu’à trois fois par jour, pour regarder les fondations enfin terminées, les tronçons de murs qui commençaient à s’élever au-dessus du sol. Depuis des mois, les travaux avaient repris avec une sorte de fièvre, malgré les grèves, malgré les menaces de révolution. Éthel ressentait une satisfaction à regarder le mur de la propriété voisine du sieur Conard aveuglé par les bâches pour lutter contre la poussière. Lui revenaient les lettres de récrimination avec accusé de réception adressées à Monsieur Soliman. « J’ai constaté qu’entre dix heures du matin et trois heures de l’après-midi vos arbres font de l’ombre à mes fruitiers, je vous préviens que sous huit jours… » Maintenant, chaque coup dans le sol, chaque grincement des tringles de métal pour les chaînages, chaque nuage de poussière de ciment devenait un moyen de vengeance qui mordait dans la chair frileuse et molle de l’ennemi de son grand-oncle, celui qui avait empêché la réalisation de la Maison mauve. C’était trop tard, mais c’était tout de même une victoire.
Puis, quelque temps après tout est revenu. Les vertiges, le vide. Éthel restait allongée sur le lit, sans se déshabiller, sans avoir dîné, les yeux ouverts à regarder le rectangle de la fenêtre où la lumière du ciel dessinait le quadrillage des petits-bois. Elle ne ressentait pas vraiment de la tristesse, et pourtant les larmes coulaient sur ses joues et mouillaient l’oreiller, comme un trop-plein qui déborde. Elle s’endormait en pensant que le trou qui la transperçait serait résorbé le lendemain, mais c’était pour constater au réveil que les bords de la plaie restaient aussi éloignés.
On pouvait vivre avec cela, c’était bien le plus étonnant. On pouvait aller, venir, faire des choses, sortir aux courses, prendre sa leçon de piano, rencontrer des amies, prendre le thé chez les tantes, coudre à la machine la robe bleue pour le bal de fin d’année à Polytechnique, parler, parler, manger un peu moins, boire de l’alcool en cachette (une bouteille de scotch Knockando dans un coffret en bois fermé par des lanières de cuir, un cadeau en secret de Laurent), on pouvait lire les journaux et s’intéresser à la politique, écouter le discours du chancelier allemand à la radio, au Bückeberg, pour la Fête de la moisson, sa voix qui vibrait dans les aigus, emportée, pathétique, ridicule, dangereuse, qui disait : « La liberté a fait de l’Allemagne un beau jardin ! »
Mais cela ne comblait pas le vide, ne refermait pas les lèvres de la plaie, ne remplissait pas l’être de la substance qui s’était vidée, année après année, et qui s’était enfuie dans l’air.
Justine avait bien tenté quelque chose. Elle est entrée un soir dans la chambre, elle s’est assise sur le bord du lit. Cela devait faire des années qu’elle n’avait pas fait cela. Depuis l’enfance d’Éthel après les disputes violentes avec Alexandre, quand ils se parlaient durement, méchamment, sans insultes, mais lui avec colère et elle avec sarcasme, et leurs mots étaient non moins cruels ni blessants que s’ils s’étaient frappés à coups de poing, que s’ils avaient envoyé voltiger de la vaisselle et des livres, comme cela se faisait dans d’autres ménages. Éthel restait figée sur son fauteuil, son cœur battait trop fort, ses mains tremblaient. Elle ne pouvait rien dire, seulement une ou deux fois, elle avait crié : « Assez ! » Et Justine était entrée dans sa chambre, elle s’était assise sur le lit, comme ce soir, sans rien dire, peut-être qu’elle avait pleuré dans l’obscurité. Maintenant, tout cela était fini. Ils ne se disputaient plus, mais le vide avait grandi, avait creusé un fossé entre eux que rien ne pourrait combler. Xénia, à son tour, avait trahi Éthel, elle s’était éloignée, fiancée avec un garçon qui ne valait rien, qui ne la valait pas.
Читать дальше