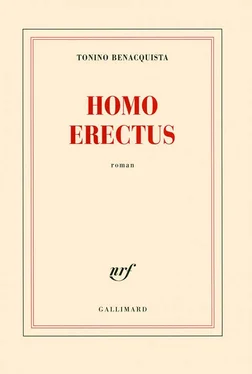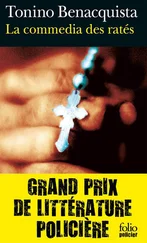Tonino Benacquista - Homo erectus
Здесь есть возможность читать онлайн «Tonino Benacquista - Homo erectus» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2011, ISBN: 2011, Издательство: Éditions Gallimard, Жанр: Современная проза, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Homo erectus
- Автор:
- Издательство:Éditions Gallimard
- Жанр:
- Год:2011
- Город:Paris
- ISBN:978-2070132928
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Homo erectus: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Homo erectus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
C’est à cette société que ce roman de Benacquista inscrit ses lecteurs et surtout ses lectrices. « Pour certains, il s'agissait d'un rendez-vous réservé aux hommes, où il était question de femmes. D'autres, en mal de solidarité, y voyaient le dernier refuge des grands blessés d'une guerre éternelle. Pour tous, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils aient vécu, c'était avant tout le lieu où raconter son histoire. »
Homo erectus — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Homo erectus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Philippe Saint-Jean quittait le moins possible la villa et commandait ses repas par téléphone, le plus souvent sur la terrasse, face à l’azur infini. Depuis son arrivée au paradis, il y cherchait sa place et ne la trouvait guère, persuadé d’être lui-même un meuble, peu utile et dépareillé. La pire épreuve avait été, avant tout, de se déshabiller. S’affranchir du poids des étoffes. Tomber sa panoplie de petit Parisien pour survivre sous les tropiques. Au placard le tweed, le velours et la maille d’Écosse. Philippe avait dû se découvrir, et se découvrir n’allait jamais sans surprises, le philosophe en lui était bien placé pour le savoir. À quand remontait la dernière confrontation avec sa propre nudité, hors la pénombre d’un lit, hors l’étroitesse de la salle de bains ? À ne voir dans son vieillissement qu’une vue de l’esprit, et dans ses vues de l’esprit son seul atout de séduction, il avait oublié son corps quinze années durant. Aujourd’hui, à mille milles de chez lui, en plein soleil, exposé aux regards, la vérité nue lui sautait aux yeux : peau grise, taches sombres, muscles fondus, bourrelets, affaissements, replis.
Comment avait-il pu se détourner de sa propre silhouette ? Pourquoi avoir traité sa carcasse comme un simple véhicule ? Lui qui avait célébré le vivant avec tant d’éloquence se rappelait enfin qu’il était un être carné. Lui qui trouvait si beaux les visages ridés de ceux qui ont tant vécu, si émouvants leurs corps lents et voûtés, ne découvrait dans son propre reflet que négligence. Lui si tolérant avec les disparités physiques et les imperfections d’autrui se pinçait aujourd’hui la peau comme on tâte un fruit blet.
Faute de trouver dans les armoires de Philippe de quoi se dévêtir par 30° à l’ombre, Mia avait dévalisé les boutiques chics : chemisettes en coton du Nil, bermudas de marques, sandales en cuir, maillot de bain coupé short, veste en lin de couleur claire pour le soir. À peine débarquée et déjà happée par le travail, elle lui avait dit : Profites-en bien, chéri . Il avait répondu : On ne peut rien me demander de pire . Profiter ? Un verbe qu’il détestait, comme toute injonction au plaisir. Et pourtant il s’était attelé à la tâche sous couvert d’une toute nouvelle expérience : la recherche de subtiles sensations liées au seul plaisir d’exister. Lui, organisme vivant de retour dans son bain originel, la mer. Redevenir une créature aquatique et nue, la peau juste revêtue d’un hâle, nageant parmi ses frères poissons. Faire abstraction de ses désirs, de ses craintes et de ses investigations pour atteindre le vieux rêve des Grecs anciens, ce point de juste équilibre et d’harmonie. Retrouver son humilité face aux éléments, se satisfaire de l’horizon sans chercher par-delà, vénérer le soleil comme le seul dieu des athées.
Mais pour atteindre ce vieux rêve, il lui aurait fallu avoir le courage de se confronter à l’infiniment petit de son être, de se considérer comme une simple entité organique, si fragile, si peu pensante, si grégaire. Il lui aurait fallu accepter de se sentir désinvesti et enrayer sa machine mentale jusqu’à la trouver dérisoire et vaine. Ne plus craindre que plus rien n’ait de sens. Oublier le tout et le rien, pour faire l’expérience physique du tout et du rien. Admettre que le stade suprême de la conscience consistait à renier sa conscience.
Mais comment cesser d’être Philippe Saint-Jean ne serait-ce qu’une heure ? Où trouver le détachement pour à ce point se relativiser ? Depuis qu’il était coincé à Bali, le bon vieux Je pense donc je suis du cartésien prenait un tout autre sens. Au réveil, une fois Mia partie rejoindre son équipe, il se demandait comment il allait occuper sa journée et, coupable de n’en avoir aucune idée, se raccrochait à un principe : Je pense donc je ne « profite » pas et me contente de résister. En fin de matinée, après avoir survolé la presse internationale, il trempait jusqu’à mi-cuisses dans l’eau bleue dans l’espoir de stimuler son corps entier et de puiser une toute nouvelle énergie. En général, un seul tour de bassin suffisait : Je pense donc je barbote sans joie dans une piscine privée. En fin d’après-midi, il dressait sans gloire le bilan de la journée avant le retour de Mia, qui, elle, allait lui narrer par le menu une infinité de petits événements. Il se sentait alors un peu plus exclu : Je pense donc j’existe en tant que penseur dans un monde qui souvent les décourage. Tard le soir, quand elle s’endormait, il goûtait enfin, sur la terrasse, au temps suspendu, et aux embruns que les vents poussaient jusqu’à lui. Je pense donc la vie des idées est mon seul rempart contre l’insignifiance.
Aujourd’hui, il se retrouvait coincé dans un décor de carte postale, et c’était bien le comble pour celui qui, quand il en recevait une, ne regardait jamais la photo et s’en tenait au texte ; un mécanisme inconscient qui en disait long, à la fois sur son besoin de formulation, et sur son désintérêt pour les lieux et les paysages, fussent-ils du bout du monde.
Ce fut là, aux antipodes, en bermuda, sur un transat, qu’il vit comme un sillon tracé dans le sable ce que serait le reste de sa vie. Il allait vieillir au rythme des saisons parisiennes, de plus en plus dépassé par la vitesse et la férocité de sa chère capitale. Mais il y mourrait, parce que là était son seul élément naturel. Grimper les trois étages de son appartement lui serait de plus en plus pénible, mais il ne déménagerait plus de peur de perdre les ondes, les vibrations, les fluides, les fantômes qui s’y étaient accumulés depuis le premier jour. Il continuerait aussi longtemps que possible à tourner en orbite autour d’un concept jusqu’à ce qu’il ait l’illusion d’en avoir fait le tour. Au hasard de ses promenades, il s’attarderait toujours au comptoir des bistrots, siroterait un express, prendrait une note dans son calepin et reluquerait une jupe au passage. Tôt ou tard, on lui ferait une place au sein d’une académie quelconque, parmi ses pairs. Il se permettrait quelques caprices, quelques colères auprès de sa petite cour d’exégètes prompts à figer sa mémoire avant qu’il ne meure. Et un beau matin, on le mettrait en bière dans un bon vieux tweed, le regard apaisé, prêt à ce tout dernier voyage dont tant de fois il avait questionné la destination.
En ouvrant les tiroirs en laqué rouge d’un vieux meuble chinois, Yves Lehaleur fut pris d’une bizarre intuition : une main étrangère avait fouillé parmi les vieilleries entassées là. Il en eut la confirmation en constatant l’absence d’une fiasque à whisky frappée aux initiales de son grand-père paternel — un vieux filou qui avait illuminé son enfance. Horace le magnifique la lui avait offerte, comme d’autres une montre à gousset, en arguant que dans certaines occasions une fiasque remplie d’un alcool fort pouvait sauver une vie, une montre rarement. En général suivait l’anecdote de sa disparition dans une forêt du Vercors par — 12 durant l’hiver 54. Sans ma fiole de gin, j’y restais, nom de Dieu ! Yves tenait à cet objet comme à aucun autre ; non tant pour sa conception savante — de forme courbe pour épouser le pectoral, avec un bouchon à vis retenu par une fine barrette — ni pour sa noble facture — en argent repoussé et cuir de pécari patiné par la paluche du vieux — mais parce qu’il symbolisait le grain de folie des Lehaleur. Même s’il n’avait aucun enfant à qui le transmettre, la disparition de cet objet excluait Yves de sa lignée, le dépossédait de son rôle de passeur de la mémoire familiale. Dans un autre tiroir, un stylo Dupont tout neuf avait disparu. Pour avoir restauré les volets d’un ami qui ne savait comment le payer, Yves s’était vu offrir cette plume en pointe de diamant qui donnait à celui qui écrivait si peu une calligraphie de monarque. Ne sachant qu’en faire, Yves l’avait gardé pour le jour où il aurait à envoyer une lettre d’amour ou de rupture, lui qui s’était libéré de l’amour, lui qui ne risquait plus la rupture. Il chercha un instant sa caméra de poche et, comme il s’y attendait, ne la retrouva pas. Yves avait beau se défendre de toute nostalgie, c’était le seul cadeau de Pauline qu’il avait gardé. Ayant détruit toutes les photos d’elle, mêmes celles du mariage, il conservait dans l’appareil, sans jamais les consulter, ces quelques prises de vue qui témoignaient de son bonheur perdu — seules les images vivantes avaient cette force-là. Il avait filmé Pauline pendant qu’elle conduisait sur une route de montagne en direction d’un chalet qu’on leur avait prêté pour Noël. Radieuse, les joues rosies par le froid, elle décrivait déjà l’enfant qu’ils allaient concevoir, le soir même, face au feu de cheminée ; Yves s’était dit qu’un jour ce document prendrait toute sa saveur en le projetant à leur premier-né. Pris d’un mauvais pressentiment, il se précipita dans un placard, ouvrit une large boîte en métal qui contenait jusqu’alors un porte-documents en cuir, avec, à l’intérieur, une partition d’Erik Satie annotée de la main même du compositeur. Yves la tenait de sa mère, qui la tenait de sa tante Alice, une pianiste qui avait rencontré son maître en 1920 dans sa maison de Honfleur. Yves, bien incapable de différencier un la d’un ré , éprouvait une curieuse sensation devant cette écriture manuscrite qui donnait des indications de jeu à certaines phrases musicales : « Sans ostentation » ou « Avec une tristesse vigoureuse ». Un sourire amer aux lèvres, Yves se demanda si la voleuse — car c’en était une — avait embarqué la partition pour ce qu’elle représentait ou pour la valeur du seul porte-documents, en cuir de Cordoue incrusté de feuille d’or.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Homo erectus»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Homo erectus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Homo erectus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.