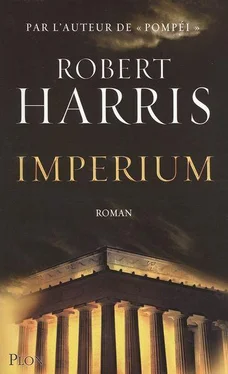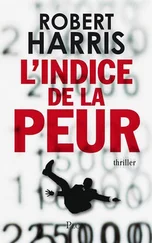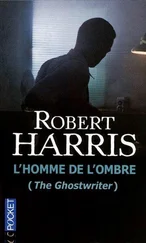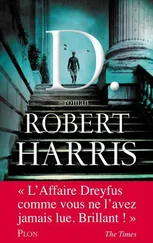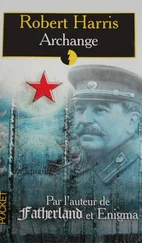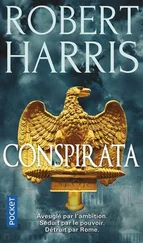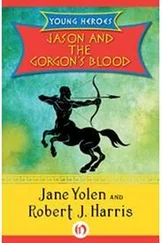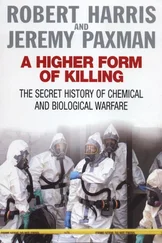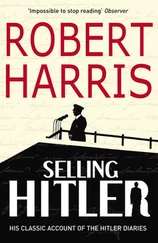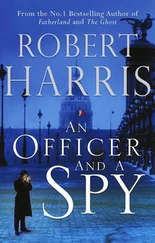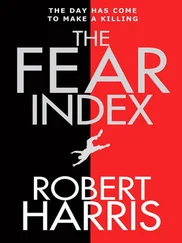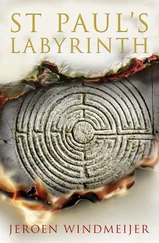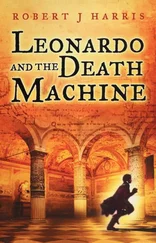Nous finîmes par quitter la route pour franchir une grille imposante sur une longue allée de gravier blanc bordée de cyprès. Les jardins symétriques qui s’étendaient de part et d’autre étaient peuplés de statues de marbre, sans doute acquises par le général lors de ses campagnes. Des jardiniers ratissaient les feuilles mortes et taillaient les bordures de buis. Il se dégageait de l’endroit une impression d’opulence tranquille et assurée. Juste avant de franchir l’entrée de la grande demeure, Cicéron me chuchota de rester à proximité, et je me glissai discrètement derrière lui, porteur d’un coffret à documents. (D’ailleurs, mon conseil pour quiconque voudrait passer inaperçu est de toujours transporter des documents ; ils projettent comme un manteau d’invisibilité sur celui qui les porte tout aussi efficace que ce qu’on trouve dans les légendes grecques.) Pompée recevait ses hôtes dans l’atrium, jouant les grands seigneurs campagnards avec, à ses côtés, sa troisième épouse, Mucia, son fils, Gnaeus — qui devait avoir à peu près onze ans à l’époque —, et sa petite dernière, Pompéia, qui venait d’apprendre à marcher. Mucia était une belle matrone sculpturale de la gens Metellus, qui n’avait pas encore trente ans et attendait visiblement un nouvel enfant. Je découvris par la suite qu’une des particularités de Pompée était d’aimer sa femme, qui qu’elle fût à l’époque. Mucia riait à une remarque qu’on venait de lui faire et, lorsque l’auteur de la plaisanterie se retourna, je vis qu’il s’agissait de Jules César. Cela m’étonna, et ne manqua pas de surprendre également Cicéron dans la mesure où, jusqu’à présent, nous n’avions jamais vu dans l’entourage de Pompée que le trio de Picenum : Palicanus, Afranius et Gabinius. De plus, César venait de passer un an en Espagne, à accomplir sa questure. Mais il était là, souple et bien bâti, doté d’un long visage intelligent, d’yeux bruns amusés et de cheveux noirs dont il rabattait soigneusement les mèches rares sur son crâne buriné. (Mais pourquoi chercher à le décrire ? Le monde entier sait quelle tête il avait !)
En tout, huit sénateurs se réunirent ce matin-là : Pompée, Cicéron et César ; les trois fidèles de Picenum ci-dessus mentionnés ; Varron, l’intellectuel attaché à la personne de Pompée et qui atteignait les cinquante ans ; et Caius Cornélius, qui avait servi comme questeur sous les ordres de Pompée en Espagne, et qui était à présent, avec Gabinius, tribun désigné. Je me faisais un tout petit peu moins remarquer que je ne l’avais craint, étant donné que la plupart des personnes présentes avaient amené avec eux un secrétaire ou un porteur ; nous nous tenions tous respectueusement sur le côté. Lorsque des rafraîchissements eurent été servis, que les nourrices eurent emmené les enfants, et que dame Mucia eut gracieusement salué chacun des invités de son époux — s’attardant, me sembla-t-il, un peu plus auprès de César —, les esclaves allèrent chercher des sièges afin que tous pussent s’asseoir. J’allais sortir avec les autres accompagnateurs quand Cicéron suggéra à Pompée que puisque j’étais célèbre dans tout Rome pour avoir inventé un merveilleux système d’écriture abrégée — ce sont ses mots —, je pourrais rester afin de prendre en notes ce qui serait dit. Le compliment me fit rougir. Pompée me dévisagea d’un air soupçonneux et je crus qu’il n’allait pas me permettre de rester, mais alors il haussa les épaules et déclara :
— Très bien. Ce pourrait être utile. Mais il n’y aura pas de copie et je conserverai l’original. Tout le monde est d’accord ?
Il y eut un assentiment général, après quoi on m’apporta un tabouret et je me retrouvai assis dans un coin avec mes tablettes, agrippant mon style d’une main moite.
Les chaises furent disposées en demi-cercle et, une fois tous ses hôtes assis, Pompée se leva. Il n’était, comme je l’ai déjà signalé, pas doué pour les discours en public. Mais ici, sur son propre terrain, parmi ceux qu’il considérait comme ses lieutenants, il irradiait le pouvoir et l’autorité. Bien que ma transcription littérale m’ait été retirée, je me rappelle encore la majeure partie de ce qu’il a dit parce que j’ai dû réécrire ses propos à partir de mes notes et que cela a toujours fixé les choses dans ma mémoire. Il commença par donner les derniers détails de l’attaque pirate lancée contre Ostie : dix-neuf trirèmes consulaires de guerre détruites, environ deux cents hommes tués, des entrepôts à grain incendiés, deux préteurs — dont l’un inspectait les greniers et l’autre la flotte — enlevés dans leur tenue officielle avec leur escorte et leurs faisceaux de verges ceignant la hache symbolique. Une demande de rançon était arrivée à Rome la veille.
— Pour ma part, dit Pompée, je ne pense pas que nous devrions négocier avec des gens pareils, ou nous ne ferions que les encourager dans leurs actes criminels.
Tout le monde acquiesça d’un signe de tête. Ce raid sur Ostie, poursuivit-il, marquait un tournant dans l’histoire romaine. Il ne s’agissait pas d’un incident isolé, mais simplement de l’acte le plus audacieux d’une longue suite d’outrages du même type, y compris l’enlèvement de la noble dame Antonia dans sa villa de Misène — Antonia, dont le propre père avait mené campagne contre les pirates ! — , le vol des trésors du temple de Crotone et les attaques surprises sur Brindes et Caiéta. Quelle serait la prochaine cible ? Rome se trouvait cette fois confrontée à une menace très différente de celle posée par un ennemi conventionnel. Ces pirates représentaient un nouveau type d’adversaires sans foi ni loi, sans gouvernement pour les représenter ni traités pour les contenir. Ils ne partaient pas forcément d’un seul État. Ils n’avaient pas de système de commandement unifié. C’était une véritable plaie mondiale, un parasite qu’il convenait d’éradiquer, faute de quoi Rome — malgré sa supériorité militaire écrasante — ne connaîtrait plus ni paix ni sécurité. Le système de défense nationale existant, qui conférait aux hommes de rang consulaire un commandement unique de durée limitée dans un théâtre individuel, était de toute évidence peu approprié.
— Depuis bien avant les événements d’Ostie, je me consacre à l’étude de ce problème, déclara Pompée, et je crois que cet ennemi unique réclame une réaction unique. L’occasion est aujourd’hui arrivée.
Il frappa dans ses mains et deux esclaves apportèrent une grande carte de la Méditerranée, qu’ils installèrent sur un support, près de lui. Son auditoire se pencha en avant pour mieux voir — tous distinguaient des lignes mystérieuses tracées verticalement sur la mer comme sur la terre.
— À partir de maintenant, la base de notre stratégie doit être de combiner les sphères politique et militaire, exposa Pompée. Il faut frapper avec tous les moyens dont nous disposons. Je propose, dit-il en prenant une baguette pour en marteler le panneau peint, que nous divisions la Méditerranée en quinze zones allant des colonnes d’Hercule, ici, à l’ouest, jusqu’aux eaux égyptiennes et syriennes à l’est, chaque zone devant disposer de son propre légat, qui sera chargé de nettoyer sa région des pirates et de conclure des traités avec les dirigeants locaux pour s’assurer que les vaisseaux des brigands ne puissent jamais revenir à leur base. Tout pirate capturé devra être remis à une juridiction romaine. Tout dirigeant qui refusera de coopérer sera considéré comme un ennemi de Rome. Ceux qui ne seront pas avec nous seront contre nous. Ces quinze légats s’en remettront à un commandant suprême qui aura autorité absolue sur l’ensemble du continent sur une distance de cinquante milles à l’intérieur des terres. Je serai ce commandant.
Читать дальше