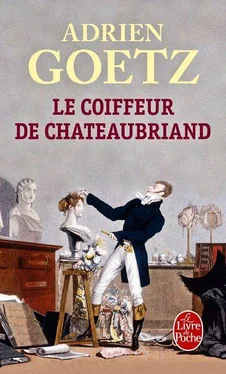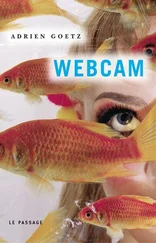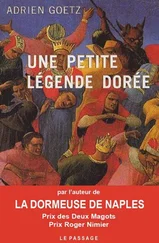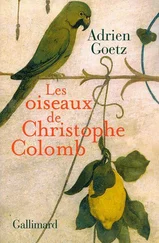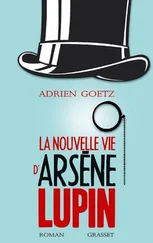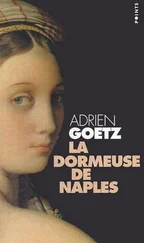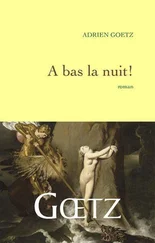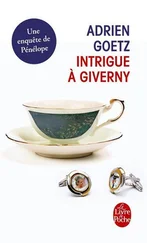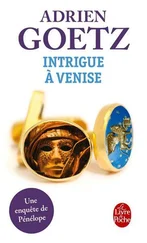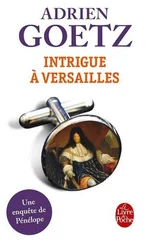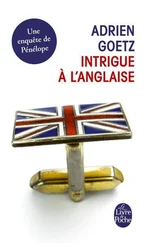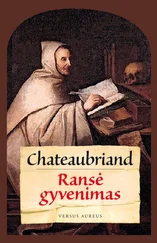Toute l'Europe se mit à attendre les Mémoires. Les diplomates murmuraient que M. de Chateaubriand, qui avait été ambassadeur et ministre, allait tout révéler des arrière-boutiques des congrès et des dessous brodés des conclaves. Les républicains et les bonapartistes attendaient qu'il s'engageât de leur côté, ce qui était mal le connaître. Les légitimistes avaient besoin de ce vaisseau pour regarnir un peu les rangs de la flotte du prétendant. Les femmes tremblaient qu'il ne donnât des noms, des faits, des dates ; certaines, Juliette en tête, faisaient courir le bruit qu'elles exigeraient des coupures. L'impatience était extrême. Chateaubriand comprit qu'il fallait la faire durer le plus possible, afin d'utiliser au mieux tout cet émoi ; d'où son titre, si habile, Mémoires d'outre-tombe, et l'idée d'en distiller déjà un peu de son vivant.
Il fallait organiser l'attente, et malgré tout, vivre le plus longtemps possible. Chateaubriand voulait jouir du spectacle. C'était Charles Quint, dans son monastère, suivant son propre enterrement derrière un pilier.
En 1836, un bon libraire, Henri Delloye, conclut un marché avec une excellente pâte d'homme qui aimait les lettres, Adolphe Sala, ancien officier comme lui. Ils regrouperaient je crois mille six cents actionnaires, qui créeraient une société, pour assurer une rente à Chateaubriand, équivalente à son ancien traitement, celui qu'il avait dû abandonner à l'avènement de Louis-Philippe. Dès les premiers jours, mille deux cents admirateurs avaient souscrit. L'impatience était immense, personne ne savait qu'il faudrait attendre plus de dix ans, en maugréant contre le vieillard qui n'en finissait pas de conclure et de mourir. En échange, la société devenait propriétaire des futurs Mémoires, et se rembourserait sur l'immense succès de librairie qui ne devait pas manquer de couronner ce couronnement, clef de voûte de l'œuvre du plus grand écrivain vivant, dont le moindre texte s'arrachait. Chateaubriand poursuivit donc ses relectures, traîna un peu, par plaisir, écrivit, presque sous mes yeux, sa dernière page, avant de tout reprendre du début. Je venais d'entrer à son service, en 1841. J'assistais à ces coquetteries, qui n'étaient que la peur de la mort chez un écrivain qui ne parlait que d'elle.
C'est au théâtre, au Français, dans une loge pour laquelle j'avais eu un billet de faveur par une de mes clientes actrices, que je rencontrai M. de Girardin. Je lui dis que j'aimais les livres, les journaux, le papier et l'encre, il me dit qu'il venait de perdre Eudamidas son vieux coiffeur, qui avait été ami avec Marat. Le lendemain matin, je dépliai mon attirail dans son salon. Seule l'amicale des coiffeurs parisiens parvient à mettre en œuvre cette circulation secrète, ces communications entre maisons rivales : nous sommes plus efficaces que des avocats, nous dénouons les problèmes comme les chignons, nous démêlons, nous passons les appartements au peigne fin.
Émile de Girardin, fils naturel du grand veneur de Charles X, avait l'instinct de la chasse et l'amour du beau gibier. Il avait surtout l'efficacité des patrons de presse. Sa femme Delphine était d'une rare beauté, et douée d'un esprit qui faisait fureur, un esprit qu'elle tenait de sa mère, Sophie Gay, égérie romantique.
Elle avait été une des fleurs du salon de M meRécamier, elle connaissait bien Chateaubriand, et avait entendu les belles pages des Mémoires. Rien ne leur résistait. Il allait à l'essentiel. Elle visait l'accessoire, ce qui revient au même. Beaucoup de gens à Paris parlaient encore du duel au pistolet de Girardin en 1836 avec l'avocat Armand Carrel, fondateur et rédacteur en chef du National, journal concurrent, qu'il avait tué ; il avait une réputation du tonnerre, et me mettre au service d'un homme aussi formidable me faisait grande envie. Je connaîtrais tout le monde, j'aurais accès à tout. Il me proposa un bon logement. Je venais de rencontrer Zélie, c'est tout ce qui nous permettrait de nous installer. Il était malin. Il me parla de la succession d'un coiffeur rue de la Planche, le sien, qu'il partageait avec Chateaubriand. Girardin payait tout.
Il ne faudrait rien dire, et j'inventai ma version de la transaction avec le vieux coiffeur, celle que je racontai à mes amis et surtout à ma tendre femme, qui ne devait pas s'inquiéter. J'étais grisé. Chateaubriand était l'homme au monde que j'admirais le plus. Je dis oui à tout sans réfléchir ; je n'avais pas bien compris que, dans le pacte, il y avait, d'abord, la trahison.
Girardin ne me le dit pas. Il me tenait par contrat. Ma seule mission était vague : le tenir informé de ce qui se disait dans la maison des Chateaubriand, rien de plus. Lui rapporter les noms des visiteurs que je verrais, lui dire s'il se tenait dans ce rez-de-chaussée des complots légitimistes, des banquets républicains, ou des sabbats de druidesses. Il n'était pas encore question des Mémoires.
Quand Girardin m'en parla, il s'aperçut que j'étais une recrue encore meilleure que ce qu'il avait imaginé : je lui en récitai des pages entières. Il appela son secrétaire. Il était éberlué par ma mémoire digne d'un comédien. Je lui avouai que j'apprenais des pages depuis l'enfance. Il me dit qu'il craignait fort que ce livre magnifique ne paraisse jamais, et qu'il était preneur, pour le conserver à la postérité, du plus grand nombre de pages que je pourrais lui offrir. Il payait en or, à la phrase. Je ne me fis pas prier. C'est ainsi que je devins, pendant l'année 1842, un agent secret des lettres. Je n'en avais pas honte, Chateaubriand vieillissait et je me disais qu'au fond je travaillais pour la bonne cause, pour assurer la postérité de mon grand homme, au cas où son texte disparaîtrait sous les coups de griffes de M meRécamier et de toutes ses récamiéristes, qui demandaient des suppressions toujours plus importantes.
Chateaubriand eut en moi une confiance absolue. C'est cela qui me fait honte. Je me souviens du jour où il me fit retirer de sous son lit la boîte en bois qu'il m'avait montrée, en la comparant à ma petite boîte à cheveux. C'était une caisse de bois blanc, avec un couvercle. Son cercueil, comme il disait, contenait des cahiers, le manuscrit complet, et il me demanda de l'aider à le réviser. Il venait de renvoyer son fidèle secrétaire Pilorge, qui le suivait pourtant depuis ses ambassades. Je ne savais pas pourquoi. Je n'allais pas tarder à l'apprendre. J'étais désormais au Saint des Saints.
« Tu sais, tout le monde tourne autour de ce tas de papier, il y aura moins de gens derrière mon cercueil. Tu verras, ils s'imaginent que cela vaut de l'or. Les éditeurs le veulent tous, sans parler des contrefacteurs, les libraires de Gand, ceux d'Amsterdam. On m'a même dit qu'un libraire allemand des plus réputés, Wetzel, s'était installé à deux pas d'ici, rue du Bac, chez un prince monténégrin de ses amis, pour me guetter et me proposer, au passage, quand je le croiserai dans la rue, de faire affaire ! Un libraire d'outre-Rhin pour voler mes Mémoires d'outre-tombe, tu te rends compte ! Le bon Delloye a fait faillite, je ne peux plus compter sur lui pour me défendre. Mes bastions sont à découvert. Je lui avais pourtant donné un volume à publier, en 1838, Le Congrès de Vérone, mais il n'avait pas si bien marché je crois. Ensuite, en 1844, je lui ai encore donné ma Vie de Rancé. Le public veut de la romance, pas de la politique ou de la dévotion, pauvre Delloye ! Dans la société qui est propriétaire de ma petite tombe, il ne reste plus que le cher Sala, qui est trop bon, et qui doit faire patienter les actionnaires. Je sais qu'ils trouvent tous que j'ai une bien bonne santé, et que leurs actions ne rapportent guère. Je me demande si je ne vais pas me décider à tout publier. Mais ce sont des milliers de pages, il faut les relire, tout vérifier, cela fourmille de dates, de noms, je ne peux pas laisser passer d'erreur. C'est mon au-delà ! »
Читать дальше