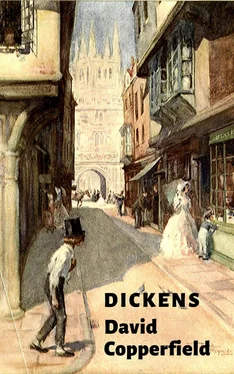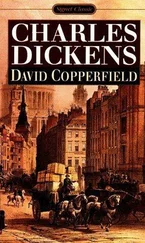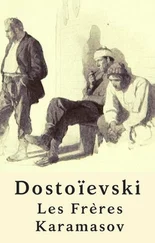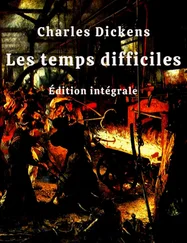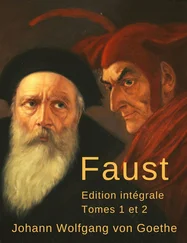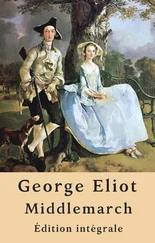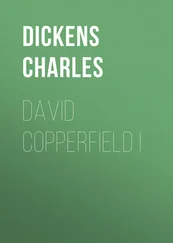– C’est qu’aussi vous vivez bien, dit Marie, et vous ne vous faites pas de mauvais sang.
– Et pourquoi m’en ferais-je ? cela ne me servirait à rien, ma chère, dit M. Omer.
– Non, sans doute, répondit sa fille. Nous sommes tous assez gais, ici, grâce à Dieu, n’est-ce pas, mon père ?
– Je l’espère, ma chère, dit M. Omer. Maintenant que j’ai repris haleine, je vais prendre la mesure de ce jeune écolier. Voulez-vous venir dans la boutique, monsieur Copperfield ? »
Je passai devant M. Omer, qui m’en fit la politesse, et après m’avoir montré un ballot de drap : « Extra-superfin, me dit-il, et trop beau pour faire des habits de deuil en toute autre occasion que pour la perte d’un père ou d’une mère, » il prit ma mesure et écrivit dans un livre mes dimensions en tous sens. Tout en notant ces renseignements, il appela mon attention sur les objets qui remplissaient son magasin, et me montra des modes qui venaient de paraître et d’autres qui venaient de passer.
« C’est comme cela que nous perdons beaucoup d’argent, dit M. Omer ; mais les modes sont comme les humains, elles vous arrivent personne ne sait quand, ni comment, ni pourquoi ; et elles passent sans que personne sache davantage ni quand, ni pourquoi, ni comment ; sous ce rapport, c’est comme la vie, tout à fait la même chose. »
J’étais trop triste pour discuter la question, qui, d’ailleurs, aurait peut-être été au-dessus de moi, et M. Omer me ramena dans la chambre où travaillait sa fille, en respirant avec quelque peine en chemin.
Il ouvrit ensuite une porte qui donnait sur un petit escalier qui m’avait l’air d’un vrai casse-cou, et cria :
« Montez le thé, le pain et le beurre. »
Les rafraîchissements firent leur apparition sur un plateau, au bout d’un moment que j’avais passé à réfléchir, en écoutant le bruit des aiguilles dans la chambre et l’air qui résonnait sous les marteaux de l’autre côté de la cour. Ce déjeuner m’était destiné.
« Je vous connais depuis bien longtemps, mon petit ami, dit M. Omer après m’avoir examiné un moment sans que je fisse, pendant ce temps, grand tort au déjeuner ; ces vêtements de deuil m’ôtaient l’appétit ; je vous connais depuis longtemps.
– Vraiment, monsieur ?
– Depuis que vous êtes né, dit M. Omer. Je puis même dire avant cette époque. J’ai connu votre père avant vous. Il avait cinq pieds six pouces, et son tombeau a vingt-cinq pieds de long.
– Rat-ta-tat, rat-ta-tat, rat-ta-tat, de l’autre côté de la cour.
– Son tombeau a vingt-cinq pieds de long, sans rabattre un pouce, dit M. Omer toujours plaisant. J’oublie si c’est lui ou elle qui l’avait ordonné.
– Savez-vous comment va mon petit frère, monsieur, demandai-je. »
M. Omer secoua la tête.
« Rat-ta-tat, rat-ta-tat, rat-ta-tat.
– Il est dans les bras de sa mère, dit-il.
– Oh ! le pauvre petit est-il mort ?
– Ne vous chagrinez pas plus que de raison, dit M. Omer ; oui, l’enfant est mort. »
Toutes mes blessures se rouvrirent à cette nouvelle. Je quittai mon déjeuner presque sans y avoir touché, et j’allai reposer ma tête sur une autre table dans un coin de la petite chambre. Marie enleva bien vite les habits de deuil qui la couvraient, de peur que mes larmes n’y fissent des taches. C’était une jolie fille, qui avait un air de bonté ; elle écarta doucement les cheveux qui me tombaient sur les yeux, mais elle était très-gaie de voir qu’elle avait presque fini son ouvrage, et d’être prête à temps ; et moi, c’était si différent !
L’air que chantaient les marteaux s’arrêta, et un jeune homme de bonne mine traversa la cour pour entrer dans la chambre où nous étions. Il avait un marteau à la main et sa bouche était pleine de petits clous, qu’il fut obligé d’ôter avant de pouvoir parler.
« Eh bien, Joram ! dit M. Omer, où en êtes-vous ?
– Tout est prêt, dit Joram ; j’ai fini, monsieur. »
Marie rougit un peu, et les deux autres jeunes filles se regardèrent en souriant.
« Comment, vous avez donc travaillé hier au soir, à la chandelle, pendant que j’étais au club ? Il le faut bien, ajouta M. Omer en fermant malicieusement un œil.
– Oui, dit Joram ; comme vous nous aviez dit que nous pourrions faire cette petite course si l’ouvrage était fini, Marie et moi… avec vous…
– Oh ! j’ai cru que vous alliez me laisser tout à fait de côté dit M. Omer, en riant si fort qu’il se mit à tousser.
– Comme vous aviez dit cela, continua le jeune homme, j’y ai mis toute ma bonne volonté. Voulez-vous voir si vous êtes content ?
– Oui, dit M. Omer en se levant. Mon cher enfant, dit-il en se tournant vers moi, aimeriez-vous à voir le…
– Non, mon père, interrompit Marie.
– Je pensais que cela pourrait lui être agréable, ma chère, dit M. Omer ; mais peut-être avez-vous raison. »
Je ne puis dire comment je savais qu’ils allaient regarder le cercueil de ma chère, chère maman. Je n’avais jamais entendu faire un cercueil, je ne crois pas que j’en eusse jamais vu, mais cette idée était entrée dans mon esprit en entendant le bruit qui retentissait dans l’atelier, et quand le jeune homme entra, je savais bien la besogne qu’il venait de faire.
L’ouvrage était fini, les deux jeunes filles, dont je n’avais pas entendu prononcer le nom, brossèrent les bouts de fil et le duvet qui étaient attachés à leurs robes, et entrèrent dans la boutique pour la mettre en ordre et attendre les pratiques. Marie resta en arrière pour plier leur ouvrage et emballer le tout dans deux grands paniers. Elle était plongée dans cette occupation, à genoux et en chantant un petit air guilleret. Joram, son amoureux, cela était clair, entra sur la pointe du pied et lui déroba un baiser pendant qu’elle était ainsi occupée, sans s’inquiéter le moins du monde de ma présence ; il lui dit que son père était allé chercher la voiture, et qu’il allait se préparer en toute hâte. Il sortit ; alors elle mit son dé et ses ciseaux dans sa poche, piqua soigneusement une aiguille enfilée de fil noir sur le corsage de sa robe, ajusta son manteau et son chapeau avec le plus grand soin, en se regardant à une petite glace placée derrière la porte et dans laquelle je voyais se réfléchir son visage satisfait.
J’observai tout cela du coin de la table près de laquelle je m’étais assis, la tête posée sur ma main, en pensant à des choses très-diverses. La voiture arriva bientôt à la porte : on y plaça d’abord les paniers, moi ensuite, mes compagnons suivirent. C’était, autant qu’il m’en souvient, une espèce de carriole, ressemblant un peu aux voitures dans lesquelles on transporte les pianos, peinte de couleur sombre, et traînée par un cheval noir avec une longue queue. Il y avait amplement de la place pour nous tous.
Je ne sais pas si j’ai jamais éprouvé de ma vie (peut-être parce que j’ai plus d’expérience maintenant) un sentiment plus étrange que celui que j’éprouvais alors, en les voyant si heureux d’aller en voiture au sortir d’une pareille besogne. Je n’étais pas fâché, j’avais plutôt un peu peur, il me semblait que j’étais avec des créatures d’une autre nature que la mienne. Ils étaient très-gais. Le vieillard était assis sur la banquette de devant et conduisait ; les deux jeunes gens étaient assis derrière lui, et quand il leur parlait, ils se penchaient tous deux en avant, chacun d’un côté de son joyeux visage, en ayant l’air d’être tout à lui, les hypocrites ! Ils auraient voulu me parler, mais je restais dans mon coin, ennuyé de les voir se faire la cour, et troublé par leur gaieté qui n’était pourtant pas bruyante, m’étonnant presque de ce que Dieu ne les punissait pas de la dureté de leur cœur.
Читать дальше