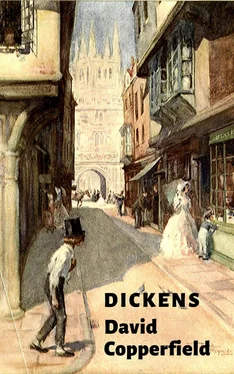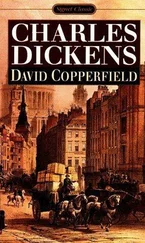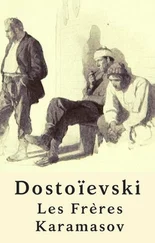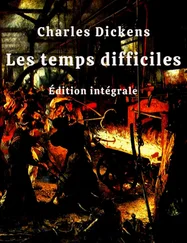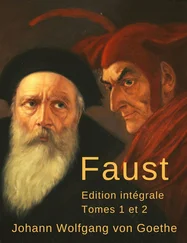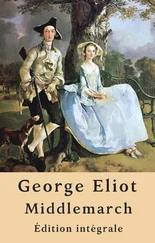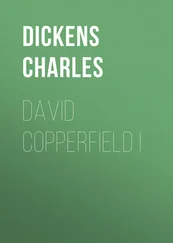C’était après le déjeuner, nous venions de rentrer de la récréation, quand M. Sharp arriva et dit :
« Que David Copperfield descende au parloir ! » Je m’attendais à un panier de provisions de la part de Peggotty, et mon visage s’illumina en recevant cet ordre. Quelques-uns de mes camarades me recommandèrent de ne pas les oublier dans la distribution des bonnes choses dont l’eau nous venait à la bouche, au moment où je me levai vivement de ma place.
« Ne vous pressez pas tant, David, dit M. Sharp, vous avez le temps, mon garçon, ne vous pressez pas. »
J’aurais dû être surpris du ton compatissant dont il me parlait, si j’avais pris le loisir de réfléchir, mais je n’y pensai que plus tard. Je descendis précipitamment au parloir. M. Creakle était assis à table et déjeunait, sa canne et son journal devant lui ; mistress Creakle tenait à la main une lettre ouverte. Mais de panier, point.
« David Copperfield, dit mistress Creakle en me conduisant à un canapé et en s’asseyant près de moi, j’ai besoin de vous parler, j’ai quelque chose à vous dire, mon enfant. »
M. Creakle, que je regardais naturellement, hocha la tête sans me regarder, et étouffa un soupir en avalant un gros morceau de pain et de beurre.
« Vous êtes trop jeune pour savoir comment le monde change tous les jours, dit mistress Creakle, et comment les gens qui l’habitent disparaissent. Mais c’est une chose que nous devons apprendre tous, David, les uns pendant leur jeunesse, les autres quand ils sont vieux, d’autres, toute leur vie. »
Je la regardai avec attention.
« Quand vous êtes revenu ici après les vacances, dit mistress Creakle après un moment de silence, tout le monde se portait-il bien chez vous ? » Après un nouveau silence, elle reprit : « Votre maman était-elle bien ? »
Je tremblais sans savoir pourquoi, et je la regardais fixement sans avoir la force de répondre.
« Parce que, dit-elle, je regrette de vous dire que j’ai appris ce matin que votre maman était très-malade. »
Un brouillard s’éleva entre mistress Creakle et moi, et pendant un moment elle disparut à mes yeux. Puis je sentis des larmes brûlantes couler le long de mon visage, et je la revis devant moi.
« Elle est en grand danger, » ajouta-t-elle.
Je savais déjà tout.
« Elle est morte. »
Il n’était pas nécessaire de me le dire. J’avais déjà poussé le cri de désespoir de l’orphelin, et je me sentais seul au monde.
Mistress Creakle fut pleine de bonté pour moi. Elle me garda près d’elle tout le jour, et me laissa seul quelques instants ; je pleurais, puis je m’endormais de fatigue, pour me réveiller et pleurer encore. Quand je ne pouvais plus pleurer, je commençais à penser, et le poids qui m’étouffait pesait plus lourdement encore sur mon âme, et mon chagrin devenait une douleur sourde que rien ne pouvait soulager.
Cependant mes pensées étaient vagues encore, elles ne portaient pas sur le malheur qui accablait mon cœur, elles erraient à l’entour. Je pensais à notre maison fermée et silencieuse. Je pensais à mon petit frère qui languissait depuis quelque temps, m’avait dit mistress Creakle, et qu’on supposait près de mourir aussi. Je pensais au tombeau de mon père dans le cimetière près de notre maison, et je voyais ma mère couchée sous cet arbre que je connaissais si bien. Je montai sur une chaise quand je fus seul, pour regarder à la glace comme mes yeux étaient rouges et comme j’avais l’air triste. Je me demandai, au bout de quelques heures si mes larmes, qui s’étaient arrêtées, ne recommenceraient pas, quand j’approcherais de la maison, car on me faisait venir pour l’enterrement, et c’était un nouveau chagrin, en pensant à la perte que je venais de faire ; car je sentais, je me le rappelle, que j’avais une dignité à garder parmi mes petits camarades, et que mon affliction même m’imposait un décorum en rapport avec l’importance de ma position.
Si jamais un enfant fut atteint d’une douleur sincère, c’était bien moi. Et pourtant je me souviens que cette importance me donnait une certaine satisfaction, quand je me promenais dans le jardin pendant que mes camarades étaient en classe. Quand je les voyais me regarder furtivement par la fenêtre, je sentais comme de l’orgueil, et je marchais plus lentement, d’un air plus mélancolique. Quand l’heure de la classe fut passée, et qu’ils vinrent tous me parler, je me félicitai en moi-même de ne pas être fier avec eux, et de les accueillir tous absolument avec la même bienveillance qu’autrefois.
Je devais partir le lendemain soir, non par la diligence, mais par une voiture de nuit, appelée la Fermière , et destinée en général aux gens de la campagne, qui n’avaient à faire qu’un petit trajet sur la route. Je ne racontai pas d’histoires ce soir-là, et Traddles voulut absolument me prêter son oreiller. Je ne sais pas quel bien il pensait que cela pouvait me faire, puisque j’avais un oreiller à moi ; mais c’était tout ce que le pauvre garçon avait à me prêter, sauf une feuille de papier couverte de squelettes, qu’il me remit au moment de mon départ pour me consoler de mes chagrins, et contribuer un peu à rétablir la paix de mon âme.
Je quittai la pension le lendemain dans l’après-midi, ne me doutant guère que je n’y reviendrais jamais. Nous voyagions très-lentement et ce ne fut qu’à neuf ou dix heures du matin que j’arrivai à Yarmouth. Je cherchais des yeux M. Barkis, mais il ne parut pas, et je vis à sa place un gros petit homme, un peu poussif, à l’air jovial, déjà avancé en âge, vêtu de noir, avec des petits nœuds de ruban au bas de sa culotte courte, des bas noirs et un chapeau à larges bords ; il s’avança vers la portière de la voiture en appelant :
« Monsieur Copperfield ?
– Me voici, monsieur.
– Voulez-vous venir avec moi, mon jeune monsieur, s’il vous plaît ? dit-il en ouvrant la portière, et j’aurai le plaisir de vous mener chez vous. »
Je pris sa main, me demandant qui ce pouvait être, et nous arrivâmes à la porte d’une boutique dans une rue étroite. L’enseigne portait :
OMER,
Drapier, tailleur, marchand de nouveautés, fournit les articles de deuil, etc.
C’était une petite boutique très-étroite, on y étouffait ; la pièce était remplie de vêtements de toutes sortes, confectionnés ou en pièces. Une des fenêtres était garnie de chapeaux d’hommes et de femmes. Nous entrâmes dans une petite chambre située derrière la boutique ; il y avait là trois jeunes filles qui travaillaient à des vêtements noirs ; il y en avait un paquet sur la table, et le plancher était couvert de petits chiffons noirs. Il y avait un bon feu dans la chambre, et une odeur étouffante de crêpe roussi. C’est une odeur que je ne connaissais pas encore ; je la connais maintenant.
Les trois jeunes filles, qui avaient l’air très-gai et très-actif, levèrent la tête pour me regarder, puis reprirent leur ouvrage. Elles cousaient, cousaient, cousaient. En même temps on entendait sortir d’un atelier situé de l’autre côté de la cour un bruit régulier de marteaux en cadence : Rat-ta-tat. Rat-ta-tat. Rat-ta-tat, sans aucune variation.
« Eh bien ! dit mon guide à l’une des jeunes filles, où en êtes-vous, Marie ?
– Oh ! nous serons prêtes à temps, dit-elle gaiement sans lever les yeux. Ne vous inquiétez pas, mon père. »
M. Omer ôta son chapeau à larges bords, s’assit et soupira. Il était si gros qu’il fut obligé de pousser encore plus d’un soupir avant de pouvoir dire :
« C’est bon.
– Mon père, dit Marie en riant, vous serez bientôt gros comme un muid.
– C’est vrai, ma chère ! je ne sais pas ce que ça veut dire, répliqua-t-il en y réfléchissant. Le fait est que j’en prends le chemin.
Читать дальше