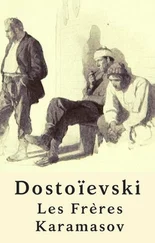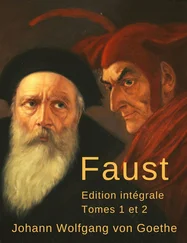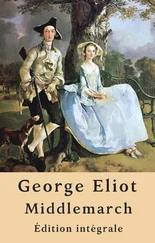William Dobbin, au moment où nous le prenons, avait oublié l’univers pour un autre monde où il avait accompagné Simbad le marin dans la vallée de diamants, ou le prince Whatdyecallem et la fée Péribano, dans cette délicieuse caverne où le prince la rencontra et où nous n’étions pas fâchés d’aller faire nous-mêmes un petit tour. Des cris perçants comme ceux d’un enfant qui pleure le tirèrent de son agréable rêverie, et levant les yeux il aperçut devant lui Cuff qui travaillait les côtes d’un de ses jeunes camarades.
C’était justement le petit drôle qui avait dénoncé le commerce de l’épicier. Mais Dobbin, s’il avait du ressentiment, ne le gardait pas contre les plus petits et les plus jeunes.
« Pourquoi, petit gueux, vous êtes-vous avisé de casser cette bouteille ? » disait Cuff à sa victime en brandissant au-dessus de sa tête une férule redoutable.
Le jeune écolier avait reçu l’ordre d’escalader le mur de la cour à un certain endroit où l’on avait eu soin d’enlever les tessons de bouteilles qui en garnissaient la crête et de pratiquer des trous dans la brique ; puis il devait courir à un quart de mille de là, y acheter une pinte de rhum à crédit, braver tous les espions du docteur, et enfin redescendre dans la cour. C’était en accomplissant cette dernière partie de ses instructions que le pied lui avait manqué, que la bouteille s’était brisée, que la liqueur s’était répandue, que son pantalon avait été taché ; et il comparaissait devant son patron avec l’effroi d’un coupable, quoique au fond il fût bien innocent.
« Comment vous êtes-vous avisé de la briser, disait Cuff, petit fripon, petit voleur ? Vous avez bu la liqueur et vous dites que vous avez brisé la bouteille. Tendez la main, monsieur le drôle. »
La férule s’abaissa avec force sur la main du pauvre enfant ; un gémissement se fit entendre. Dobbin leva les yeux. Simbad le marin, la vallée de diamants, tout cela maintenant était bien loin dans les nuages. Pour l’honnête William, il voyait ce qu’il avait tous les jours sous les yeux, un gros garçon qui en battait un petit sans le moindre motif.
« À l’autre main, maître gourmand, » disait Cuff à son petit camarade, dont la figure portait les contractions de la douleur. Dobbin, sous ses étroits vêtements, sentit un frémissement et une crispation courir par tous ses membres.
« Voilà pour vous, petit mauvais sujet ! » criait M. Cuff. Et l’instrument de supplice retombait, sur la main de l’enfant.
Que cela ne vous révolte pas, mesdames, c’est le sort de tout enfant qui a été en pension. Vos enfants feront de même et subiront un pareil traitement, selon toute probabilité.
Quand la férule s’abaissa de nouveau, Dobbin se trouva debout.
Je ne saurais trop dire pourquoi ; car la torture dans une école publique est aussi bien de mise que le knout en Russie, et jusqu’à un certain point on n’aurait pas bon air de vouloir s’insurger contre elle. Peut-être l’âme bonasse de Dobbin était-elle révoltée contre cet acte de tyrannie ; ou peut-être, en proie à un furieux désir de vengeance, voulait-il se mesurer contre ce despotique et orgueilleux bourreau, qui se donnait des airs de conquérant. Il en avait toute la hauteur, toute l’arrogance, tous les priviléges. Devant lui les drapeaux s’agitaient, les tambours battaient aux champs, et on lui portait les armes. Quel que fût le motif de la détermination de Dobbin, il ne fit qu’un bond, et d’une voix ferme :
« Arrêtez, Cuff, et ne tourmentez plus cet enfant, ou bien je vais…
– Ou bien vous allez quoi faire ? demanda Cuff tout surpris de cette interruption ; allons, tendez votre main, petite bête, reprit-il aussitôt.
– Ou bien, je vais vous donner la roulée la plus soignée que vous ayez reçue de votre vie, » dit Dobbin en réponse à la première partie des paroles de Cuff.
Le petit Osborne, tout pleurant et tout sanglotant, jeta un coup d’œil d’étonnement et d’incrédulité sur le champion qui venait de surgir soudainement pour sa défense ; l’étonnement de Cuff n’était pas moins grand.
Imaginez-vous notre monarque George III apprenant la révolte des colonies de l’Amérique du Nord ; imaginez-vous le géant Goliath ayant devant lui le petit David qui vient le provoquer, et vous aurez une idée des sentiments de M. Reginald Cuff en recevant la proposition de ce cartel.
« Après la classe, » répondit-il, mettant un temps d’arrêt et avec un regard qui voulait dire : « Faites votre testament d’ici là, et recommandez à vos amis vos dernières volontés.
– À votre aise, dit Dobbin ; vous me servirez de second, Osborne.
– Soit, si vous le désirez, » dit le petit Osborne ; et comme son père avait voiture, c’était tout au plus s’il ne rougissait pas d’un pareil champion.
Bien mieux, quand l’heure du combat fut venue, il avait presque honte de lui dire : « Allons, Figs, à l’œuvre. » Pendant les deux ou trois premières passes de ce fameux combat, pas une voix dans la galerie ne fit entendre un cri d’encouragement. Le brillant Cuff s’était avancé, un sourire de dédain sur les lèvres, aussi allègre, aussi gai que s’il fût allé au bal ; il adressa si bien ses coups à son adversaire, qu’il l’envoya par trois fois mesurer le sol. À chacune de ces chutes, c’étaient des acclamations, c’était au plus pressé à fléchir le genou devant le triomphateur.
« Que de coups je vais recevoir quand ce sera fini ! pensa le jeune Osborne en relevant son homme. Vous feriez bien mieux de céder, dit-il à Dobbin ; ce n’est qu’un mauvais quart d’heure à passer, et vous savez que j’en ai l’habitude. »
Mais Figs, dont tous les membres éprouvaient un tremblement nerveux, dont les narines soufflaient la rage, rejeta de côté son jeune second et revint une quatrième fois à la charge.
Ne sachant comment parer les coups dirigés contre lui, et Cuff ayant commencé l’attaque les trois fois précédentes sans laisser à son ennemi le temps de riposter, Figs résolut de prendre les devants à son tour par une charge à fond de train. En conséquence, comme il était gaucher, il porta son bras gauche au fort de l’action, et à deux reprises l’étendit de toute sa force ; la première fois, il atteignit l’œil gauche de M. Cuff, et la seconde, son admirable nez à la romaine.
Cuff roula par terre, au grand étonnement des spectateurs.
« Bien touché, par Jupin, dit le petit Osborne avec un air de connaisseur, en battant des mains derrière son champion. Ferme du bras gauche, Figs, mon garçon. »
Pendant tout le reste du combat, le bras gauche de Figs fit un terrible ravage. Chaque fois Cuff allait rouler par terre. Au sixième tour, les voix se partageaient à peu près pour crier : « Courage, Figs ! courage, Cuff ! » Au douzième tour, ce dernier était hors de combat, et, à ce qu’on m’a dit, avait perdu toute présence d’esprit, toute vigueur pour l’attaque ou la défense. Figs, au contraire, était aussi impassible qu’un quaker. Sa figure pâle, ses yeux animés, une large balafre sous la lèvre qui laissait échapper beaucoup de sang, donnaient à ce jeune héros un air belliqueux et farouche qui peut-être frappait de terreur plus d’un spectateur. Son intrépide adversaire ne s’en disposait pas moins à en venir aux mains pour la treizième fois.
Si j’avais la plume de Napier ou de Bell, je voudrais m’arrêter à décrire au long ce combat. C’était la dernière charge de la vieille garde, ou plutôt elle devait ainsi s’exécuter un jour, car Waterloo n’avait pas encore eu lieu. C’était la colonne de Ney abordant la colonne de la Haie-Sainte, avec l’éclat de dix mille baïonnettes et couronnée de vingt aigles. C’étaient les acclamations de l’Anglais, lorsque descendant de la colline il s’élançait pour étreindre l’ennemi dans une ceinture d’acier. En d’autres termes, Cuff faisait un suprême effort, mais il revenait tout chancelant, tout étourdi. La main gauche du marchand de figues alla s’abattre comme d’habitude sur le nez de son adversaire et l’étendit pour la dernière fois sur le carreau.
Читать дальше