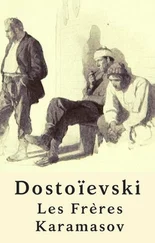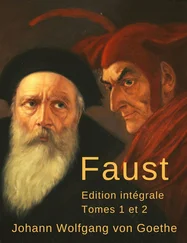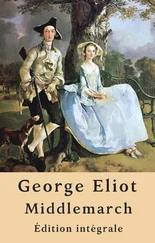*
* *
C’est dans cette position romantique qu’Osborne et Amélia trouvèrent ce couple intéressant, quand ils revinrent annoncer que la salade était prête.
L’écheveau était enroulé autour de la carte, mais Joseph Sedley n’avait encore parlé de rien.
« Ce sera assurément pour ce soir, ma chère, » dit Amélia en serrant la main de Rebecca.
De son côté, Joseph Sedley, comme par une entente secrète, se dit à lui-même : « J’aborderai la question de front, ce soir, au Vauxhall. »
CHAPITRE V.
L’ami Dobbin.
La bataille entre Cuff et Dobbin, et l’issue inattendue de cette lutte resteront longtemps dans la mémoire de tous ceux qui ont été élevés dans la célèbre institution du docteur Swishtail. Dobbin, connu sous les noms de Dobbin le Cancre , Dobbin la Chiffe , et autres termes de mépris à l’usage des écoliers, passait pour être le plus engourdi, le plus épais, le plus lourd de tous les pensionnaires du docteur Swishtail. Il avait pour père un épicier de la Cité, et le bruit courait qu’il était reçu dans la maison du docteur Swishtail d’après un système de libre échange, c’est-à-dire que le montant de sa pension était payé par son père en nature, et non en argent. Avec son pantalon et sa jaquette de velours à côtes, dont ses membres gros et gras faisaient craquer les coutures, il passait à l’intérieur de l’école pour représenter de son chef tant de livres de thé, de sucre, de chandelle, de savon, de raisins secs, dont la plus grande consommation n’était pas pour les poudings de l’établissement. Ce fut un jour néfaste pour le petit Dobbin que celui où l’un des plus jeunes de l’école, ayant parcouru la ville pour aller faire la chasse aux saucissons et aux nougats, reconnut à la porte de l’instituteur le haquet de la maison Dobbin et Rudge, épiciers et marchands d’huile, Thames Street, à Londres, pendant que l’on déchargeait un convoi de marchandises dont cette maison faisait commerce.
À partir de ce moment, il n’y eut plus de repos pour le jeune Dobbin. Les plaisanteries tombèrent sur lui sans pitié.
« Eh bien ! Dobbin, disait un de ces drôles, bonnes nouvelles dans le journal, le sucre est en hausse, mon garçon. »
Un autre lui posait le problème suivant : « Si une livre de chandelle vaut quatorze sous et demi, combien vaudra Dobbin ? »
Puis c’étaient des éclats de rire au milieu de cette troupe de garnements, qui jugeaient dans leur sagesse que la vente en détail est un commerce honteux et déshonorant, bon tout au plus à exciter le mépris et le dédain des grands seigneurs de leur trempe.
« Votre père, Osborne, n’est rien de plus qu’un marchand, dit Dobbin en particulier au jeune drôle qui avait soulevé la tempête contre lui.
– Mon père, répondit l’autre avec hauteur, est gentilhomme et sait garder son rang.
William Dobbin se retira dans un coin de la cour, où il passa le reste de la récréation en proie à la plus vive tristesse, au chagrin le plus cuisant. Qui parmi nous ne se rappelle ces heures pénibles et amères, ces douleurs de notre enfance ? Qui mieux qu’un enfant ressent l’injustice ? Qui tremble plus devant la raillerie ? Qui a un sentiment aussi pénétrant du mal qu’on lui fait, une gratitude aussi expansive pour un acte de bonté ? Et vous ne craignez pas de flétrir, de torturer ces jeunes âmes ! et pourquoi, mon Dieu ? pour une malheureuse erreur d’arithmétique, pour l’amour de ce damné latin.
William, par suite de son incapacité à apprendre les éléments de ladite langue tels qu’ils sont présentés dans le merveilleux ouvrage intitulé Grammaire latine d’Eton , se vit relégué parmi les commençants du docteur Swishtail. Il était toujours surpassé par de petits enfants à la face joufflue et rose, portant des brassières et des tabliers, au milieu desquels il s’élevait comme un géant. Son regard errant et stupéfait, son abécédaire écorné et son pantalon à côtes qui lui serrait la jambe, le désignaient aux sarcasmes des autres écoliers ; petits et grands, tous étaient après lui. Ils s’amusaient à coudre ses culottes pour les faire encore plus étroites qu’elles n’étaient. Ils coupaient les sangles de son lit. Ils renversaient les tables et les bancs de manière à lui faire rompre les jambes, ce qui ne manquait jamais. Ils lui envoyaient des paquets renfermant du savon et des chandelles de chez son père. Le moindre petit drôle avait une farce et une plaisanterie à l’adresse de Dobbin. Il supportait tout avec une résignation muette et digne de pitié.
Cuff, au contraire, était le meneur de la maison Swishtail et y donnait le ton. Il y introduisait du vin en fraude, rossait les externes et faisait venir son cheval à la porte de la pension pour s’en retourner chez lui le samedi. Il avait apporté dans sa chambre ses bottes à hautes tiges, avec lesquelles il allait à la chasse les jours de congé. Il avait une montre d’or à répétition et il prenait du tabac comme le docteur. C’était un des habitués de l’Opéra, et il connaissait le fort et le faible de chaque acteur : il préférait Kean à Kemble. Il pouvait vous mettre sur leurs pieds quarante vers latins à l’heure, et n’était pas étranger à la poésie française. Que ne savait-il pas ? Que ne pouvait-il faire ? Le docteur lui-même, disait-on, tremblait devant sa supériorité.
Cuff était donc le souverain reconnu par ses camarades ; il les gouvernait et les écrasait de son importance, sans que l’on songeât le moins du monde à contester ses droits. L’un cirait ses souliers, l’autre faisait griller son pain, d’autres étaient chargés de ses commissions ou lui apportaient la balle au jeu de paume, dans les grandes chaleurs de l’été. Dobbin était celui qu’il méprisait le plus. Bien que toujours prêt à le bousculer et à rire de lui, il daignait rarement lui adresser la parole.
Un jour il y eut maille à partir entre ces deux jeunes gens. Dobbin se trouvait seul dans la classe à griffonner un message pour la maison paternelle ; Cuff survient et lui enjoint de lui faire une commission dont l’objet était probablement quelque tarte aux cerises.
« Je ne puis, dit Dobbin, il faut que je finisse ma lettre.
– Vous ne pouvez pas , dit maître Cuff, faisant mine de vouloir s’emparer de la pièce d’écriture, dont beaucoup de mots étaient grattés, beaucoup d’autres mal écrits, et qui avait cependant coûté à Dobbin je ne sais combien de réflexions, de travail et de larmes ; car le pauvre garçon écrivait à sa mère, qui était folle de lui, bien qu’elle fût la femme d’un épicier et qu’elle habitât une arrière-boutique de Thames Street. « Vous ne pouvez pas, dit M. Cuff ; je voudrais bien savoir pourquoi, je vous prie ? vous n’avez qu’à écrire demain à la maman Figs.
– Ne pouvez-vous l’appeler par son nom ? dit Dobbin sortant de son banc dans la plus grande agitation.
– Eh bien ! allez-vous partir ? s’écria le tyran de l’école.
– Laissez cette lettre, répliqua Dobbin ; les gensse bien élevés ne lisent pas les lettres.
– Comment ! pas encore parti ? dit l’autre.
– Non, je ne partirai pas ; et prenez garde de me toucher, ou je vous assomme, » vociféra Dobbin en s’élançant sur un encrier de plomb, et avec un regard si méchant que Cuff s’arrêta tout court, tira ses bouts de manches, mit ses mains dans ses poches et sortit en ricanant. Depuis lors il n’eut plus aucun rapport direct avec le fils de l’épicier ; nous devons toutefois lui rendre cette justice, qu’il traitait M. Dobbin avec le plus souverain mépris quand celui-ci avait le dos tourné.
Quelque temps après cet événement, il arriva que M. Cuff se trouva, par une chaude après-dînée, non loin de William Dobbin, qui, étendu sous un arbre de la cour, s’absorbait sur son exemplaire favori des Mille et une Nuits . À l’écart des autres pensionnaires qui se livraient à divers jeux, il se trouvait presque heureux dans son isolement. Si on laissait les enfants abandonnés à eux-mêmes, si les maîtres cessaient de les tracasser, si les parents ne prétendaient pas diriger leurs pensées et dominer leurs goûts, ces goûts ou pensées qui sont un mystère pour tout le monde ; car, vous et moi, que savons-nous l’un de l’autre de nos enfants, de nos pères, de nos voisins ? – et à coup sûr les pensées de ces pauvres enfants sont bien plus pures, bien plus sacrées que celles de ces êtres abrutis et corrompus auxquels est remis le soin de les diriger, – je le répète, si les parents et les maîtres laissaient un peu plus leurs enfants à eux-mêmes, le nombre des mauvais sujets ne s’accroîtrait pas autant, et ils en seraient quittes, pour le présent, à faire de moins grandes provisions de science.
Читать дальше