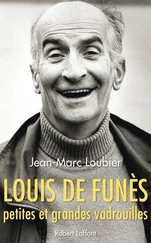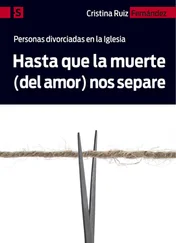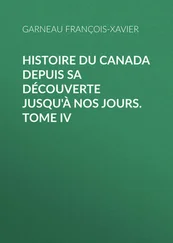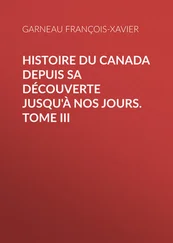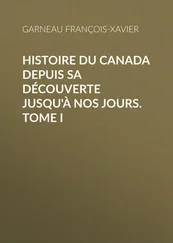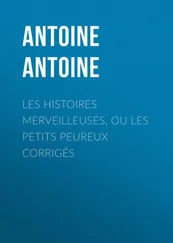Ne dit-on pas depuis longtemps que la sépulture des saints exhale un parfum de douceur, des senteurs agréables, des odeurs de fleurs, des effluves, des arômes et des fragrances.
C’est sans doute tout cela, l’odeur de sainteté. Il ne faut surtout pas confondre avec le goût d’un saint-honoré, le parfum d’un saint-émilion ou l’odeur d’un saint-marcellin.
Curieusement, il existe aussi une version négative de cette expression : « ne pas être en odeur de sainteté » pour désigner quelqu’un que l’on ne peut pas sentir… Décidément, il vaut mieux « être en odeur de sainteté »…
« Être médusé », c’est être stupéfait, sidéré, interloqué par ce que l’on vient de voir ou d’entendre… Il ne semble même pas y avoir de place pour le doute.
En étant médusé, on est pétrifié, littéralement changé en pierre… et ce n’est pas étonnant !
Le verbe « méduser » vient du nom d’un personnage de la mythologie : Méduse, qui est l’une des trois Gorgones ! De ces trois sœurs, la seule mortelle.
 Méduse, qui est l’une des trois Gorgones !
Méduse, qui est l’une des trois Gorgones !
Physiquement, elle est facile à reconnaître avec sa tête entourée de serpents, et son regard insoutenable pour un être humain. Il est si pénétrant, qu’il transforme en pierre quiconque le croise. Si on ose la regarder dans les yeux, on est pétrifié, médusé !
C’est justement en pensant à ce mythe de la Gorgone Méduse que l’on a donné leur nom à ces curieux animaux marins dont les tentacules ressemblent à s’y méprendre à des serpents !
Le Radeau de la Méduse : ce tableau de Géricault raconte l’incroyable épopée d’une poignée de survivants d’un terrible naufrage. En observant ces rescapés allongés sur ce radeau de fortune, il y a vraiment de quoi… « être médusé »…
« Être sur la sellette », c’est se retrouver exposé à la critique ; voire être accusé, interrogé, questionné, jugé et finalement condamné !
« Être sur la sellette », ce n’est vraiment pas une position enviable !
La sellette est un diminutif du mot « selle », ce siège de cavalier installé sur le dos des chevaux. La sellette est donc elle aussi un petit siège, généralement bas et sans dossier.
Mais surtout, ne croyez pas qu’il s’agisse d’un siège confortable, comme peut l’être une méridienne, ce canapé offrant ses bras pour un repos ou une sieste, à l’heure de midi, ainsi que le rappelle son nom. Ce n’est pas non plus une austère cathèdre, une chaise à haut dossier qui donna son nom à la cathédrale où siège l’évêque. Ni même une boudeuse qui désigne un siège sur lequel deux personnes s’installent : en se tournant le dos.
 Mais surtout, ne croyez pas qu’il s’agisse d’un siège confortable.
Mais surtout, ne croyez pas qu’il s’agisse d’un siège confortable.
Pourtant, à l’origine, les femmes et les hommes qui étaient installés « sur la sellette » se présentaient devant un tribunal. Car c’est sur cette sellette, sur ce petit tabouret, que venaient s’asseoir les accusés durant leur procès.
La petite taille de ce modeste siège donnait une position inférieure et humiliante aux accusés. Les juges posaient leurs questions et menaient leurs interrogatoires en les toisant, en les observant de haut, en les écrasant de leurs gestes et de leurs regards !
L’usage de la sellette par la justice fut aboli au moment de la Révolution, en 1789. Désormais, seuls les sculpteurs, les parapentistes et quelques personnes ayant commis des faux pas peuvent « être sur la sellette »…
« Être un apollon » !… Comment ça, ce n’est pas donné à tout le monde ? Je vous en prie !
En tout cas, cette expression nous en dit long sur la grande beauté de ce dieu de la mythologie, que de nombreux sculpteurs ont cherché à représenter !
Fils de Zeus, frère jumeau d’Artémis, Apollon est le dieu de la lumière et des arts, il incarne la beauté et la jeunesse. Sur son char attelé de plusieurs cygnes, il parcourt la terre pour vivre ses amours et ses nombreuses aventures…
 Quand la N.A.S.A. a cherché un nom pour son nouveau programme de missions habitées, c’est celui d’Apollon qui a été choisi.
Quand la N.A.S.A. a cherché un nom pour son nouveau programme de missions habitées, c’est celui d’Apollon qui a été choisi.
Bien des siècles plus tard, il est toujours présent. Le prénom latin Apollinaris , qui signifie « Voué au dieu Apollon », est devenu le pseudonyme choisi par le poète Guillaume Apollinaire !
Quand la N.A.S.A. a cherché un nom pour son nouveau programme de missions habitées, c’est celui d’Apollon qui a été choisi… Apollo , en latin ! Son char s’est transformé en fusée pour permettre aux hommes de poser le pied sur la Lune !
En observant de près L’Apollon du Belvédère , magnifique statue en marbre, je peux affirmer, sans me tromper, qu’il n’est pas toujours facile d’ « être un apollon »…
« Faire grève », « faire la grève », « se mettre en grève », voilà des termes et des expressions qui signifient que certaines branches, certaines catégories ou certains groupes professionnels ont cessé le travail pour exprimer des revendications !
« Faire grève », c’est d’abord un droit ! Le « droit de grève » existe, il est inscrit dans la Constitution depuis la Seconde Guerre mondiale !
Mais « faire grève », c’est, avant tout, une très longue histoire !
 Mais « faire grève » c’est, avant tout, une très longue histoire !
Mais « faire grève » c’est, avant tout, une très longue histoire !
Ce mot « grève » nous vient d’un mot latin qui nous a également donné le mot « gravier » désignant tout à la fois le bord d’un fleuve et ces petits cailloux, ces grains de sable qui forment une véritable plage ! Voilà pourquoi, il y a bien longtemps, en plein cœur de Paris, à quelques pas de l’actuel Hôtel de Ville, se trouvait un terrain descendant en pente douce jusqu’à la rive droite de la Seine… Cette véritable plage de sable et de gravier, longue d’environ 1 000 pas, s’est logiquement appelée la place de Grève ! Très vite on y a créé un port commercial. Le port de Grève est accessible aux habitants et aux bateliers qui transportent les marchandises ! Petit à petit l’endroit est devenu très fréquenté et sur cette place de Grève, on prend l’habitude non seulement de faire ses achats, mais aussi de chercher une place, un emploi ! Artisans et commerçants veulent y trouver un porteur ou un maçon, tandis que compagnons et valets y cherchent un employeur. Pendant des dizaines d’années, Parisiens et provinciaux ont arpenté la place de Grève, car, à l’époque, pour trouver du travail, il fallait « faire grève » ! …
Faire l’école buissonnière
« Faire l’école buissonnière », c’est… interdit… oui, enfin, je veux dire que c’est déconseillé puisque cela signifie : « aller se promener », « aller flâner », « déambuler » au lieu de se rendre en classe, à son travail, ou à son bureau.
Читать дальше
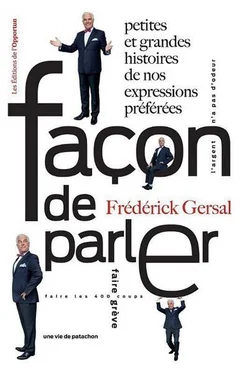
 Méduse, qui est l’une des trois Gorgones !
Méduse, qui est l’une des trois Gorgones !