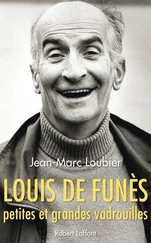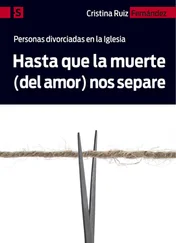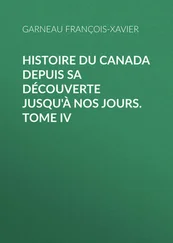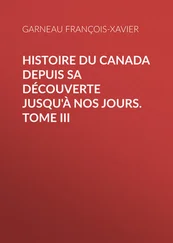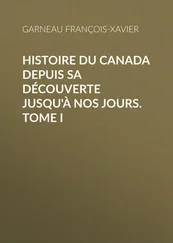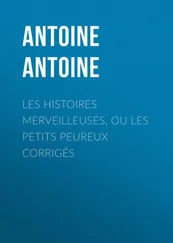À noter encore l’origine proposée par Horace Raison dans son livre intitulé Le Code galant ou l’art de conter Fleurette . Il nous raconte comment le futur Henri IV a rencontré la jeune Fleurette !
C’est depuis cet amour impossible que nous aimons « conter Fleurette »…
L’expression « coup de Jarnac » nous évoque tout de suite un mauvais coup, un coup tordu, une traîtrise !
Et pourtant, à l’origine de cette histoire, le coup d’épée qui a été donné était parfaitement régulier !
Tout a commencé sous le règne de François Ier.
Comme l’on s’ennuie à la cour du roi de France, l’intrigue devient le passe-temps favori ! Les uns font courir des bruits, tandis que les autres lancent des attaques personnelles… À ce petit jeu, Henri, le fils aîné du roi, est l’un des plus doués.
 Le coup d’épée qui a été donné était parfaitement régulier !
Le coup d’épée qui a été donné était parfaitement régulier !
Un jour, l’une de ses attaques est dirigée contre la personne de Guy Chabot, baron de Jarnac… « Monsieur, je vous accuse d’être l’amant de l’une des plus belles dames de la Cour ». Profondément vexé, le baron de Jarnac lance un défi à celui qui osera répéter ce mensonge devant lui. Le dauphin Henri n’ayant pas le droit de relever le gant, c’est François de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie, qui le représente. Mais le roi François Ier intervient pour éviter le combat ! L’affaire est donc enterrée jusqu’au jour où Henri succède à son père sur le trône de France. Devenu le roi Henri II, il autorise ce duel !
Le 11 juillet 1547, au château de Saint-Germain-en-Laye, devant toute la Cour rassemblée sur des estrades entourant une lice, le seigneur de la Châtaigneraie, défendant le roi, et le baron de Jarnac, défendant son honneur, s’affrontent !
Après quelques échanges, Jarnac porte un coup d’épée inattendu, mais parfaitement en règle, blessant son adversaire au mollet gauche (aïe !). La Châtaigneraie vacille et s’écroule. Le « coup de Jarnac » venait de naître…
« De bon aloi ». Cette expression n’a rien à voir avec le « bon à rien » ou la « bonne humeur », car c’est une question de valeur et surtout de qualité en parlant d’une monnaie.
« Aloi » est un nom commun masculin qui vient d’un très ancien verbe « aloier » qui est à rapprocher de notre verbe « allier » dans le sens d’un alliage.
Pour fabriquer de la monnaie, depuis la nuit des temps, les hommes utilisent divers métaux, surtout de l’or, de l’argent et du bronze qu’ils unissent, qu’ils mélangent, qu’ils allient les uns aux autres pour former un alliage.
Comme pour l’art culinaire, les proportions doivent être minutieusement respectées pour que cet alliage de métal soit en permanence « de bon aloi »…
 Les proportions doivent être minutieusement respectées pour que cet alliage de métal soit en permanence « de bon aloi ».
Les proportions doivent être minutieusement respectées pour que cet alliage de métal soit en permanence « de bon aloi ».
Quel que soit l’alliage choisi et réalisé, il ne reste plus qu’à frapper la monnaie grâce à une matrice gravée en creux que l’on appelle un coin. Cette opération est à l’origine d’une célèbre expression : « être frappé, marqué au coin… » du bon sens !
Jadis, certains voleurs n’hésitaient pas à gratter et à limer le pourtour des pièces pour récupérer le précieux métal, ils rognaient les pièces qui n’étaient plus… « de bon aloi »…
« De but en blanc », voilà bien une façon d’être direct.
Cette expression est employée pour signifier que l’on ne va pas tourner autour du pot, que l’on ne va pas perdre de temps… bref… que l’on va aller droit au but !
À l’origine, cette expression était utilisée par les artilleurs qui parlaient de « tirer de but en blanc » en évoquant les canons qu’il fallait régler avant de tirer : depuis la butte où ils étaient disposés… vers le blanc de la cible qu’il fallait atteindre !
Curieusement, dans cette expression : « de but en blanc », le mot but s’écrit B.U.T., et pourtant, il faudrait l’écrire : B.U.T.T.E.… puisqu’il désigne cette butte, ce monticule, cette petite colline où se plaçaient les canonniers.
 Inutile de perdre du temps à se regarder dans le blanc des yeux, il fallait viser, puis tirer en direction du blanc de la cible !
Inutile de perdre du temps à se regarder dans le blanc des yeux, il fallait viser, puis tirer en direction du blanc de la cible !
Une fois installé sur cette hauteur, il était inutile de perdre du temps à se regarder dans le blanc des yeux, il fallait viser, puis tirer en direction du blanc de la cible !
Ce tir de canon, en ligne droite, franc, direct va se transformer au fil du temps pour désigner des échanges verbaux, des petites phrases parfois assassines qui nous piquent au vif et nous atteignent en plein cœur, subitement… « de but en blanc »…
Des économies de bouts de chandelles
« Des économies de bouts de chandelles », ce sont des économies modestes, des économies qui paraissent ridicules, des économies qui ne comptent même pas tant elles sont insignifiantes !
Cette expression remonte à une époque où la chandelle était le seul moyen d’éclairage. Et encore, les lieux publics étaient souvent laissés dans l’ombre à la nuit tombante. Au début du XIV esiècle, il y avait moins de dix lanternes publiques dans Paris !
C’est finalement le lieutenant de police qui fit installer un éclairage, par simple mesure de sécurité. Quelque 1 500 lanternes et leurs chandelles sont accrochées dans les rues de la capitale à partir de 1667.
Parmi les allumeurs de chandelles, il y avait quelques escrocs qui n’hésitaient pas à les percer à mi-hauteur pour y introduire des petites gouttes d’eau. Une fois que les trous étaient refermés par du suif, ni vu ni connu !
Quand la mèche atteignait ces gouttelettes d’eau, elle s’éteignait. Les allumeurs récupéraient pour eux ces morceaux de chandelles.
Pris sur le fait, certains d’entre eux ont été condamnés à une forte amende pour « économies de bouts de chandelles »…
 Cette expression remonte à une époque où la chandelle était le seul moyen d’éclairage.
Cette expression remonte à une époque où la chandelle était le seul moyen d’éclairage.
Des espèces sonnantes et trébuchantes
Payer en « espèces sonnantes et trébuchantes » signifie que l’on va payer en liquide et, plus précisément encore, en pièces de monnaie !
Pas en billets… uniquement en pièces de monnaie !
Il y a bien longtemps le mot « espèce », employé au pluriel, désignait un moyen de paiement bien précis : les pièces d’or et les pièces d’argent. Mais pour être valables, ces pièces doivent être vraies, elles doivent peser un poids réglementaire, elles doivent être de bonne qualité avec un bon alliage ; en un mot… elles doivent être « de bon aloi » ! Car il faut bien l’avouer, il y a des faussaires, des escrocs !
Читать дальше
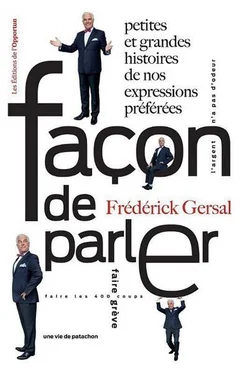
 Le coup d’épée qui a été donné était parfaitement régulier !
Le coup d’épée qui a été donné était parfaitement régulier !