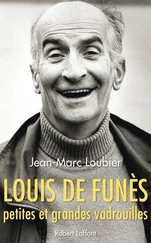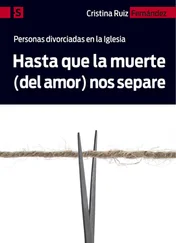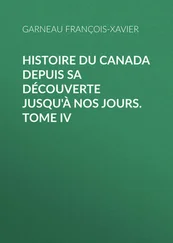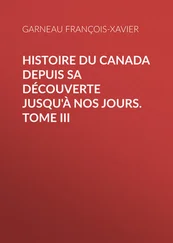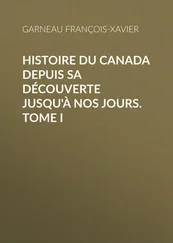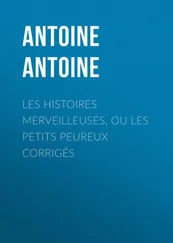Quand le haricot est arrivé en Europe au XVI esiècle, il s’est d’abord appelé « fève ».
Quand le haricot est arrivé en Europe au XVI esiècle, il s’est d’abord appelé « fève ».
Le haricot, qu’il soit vert, blanc, rouge, jaune ou noir est une plante annuelle à fruit. Que ce haricot soit grimpant ou nain, qu’il soit mange-tout ou sauteur, qu’il soit sec ou beurre, qu’il soit avec ou sans fils, il se déguste sous toutes les latitudes.
Quand le haricot est arrivé en Europe avec le retour des premiers conquistadors, au XVI esiècle, il s’est d’abord appelé « fève ». Tout simplement parce que le nom « haricot » était déjà donné à un plat de viande qui existait depuis longtemps.
Autrefois, le haricot désignait toutes sortes de ragoûts cuisinés avec du veau, du mouton, du gibier ou toute sorte de viande accommodée de navets ou de légumes plutôt farineux.
Alors quand cette nouvelle fève a débarqué d’Amérique, elle s’est naturellement mariée avec ce haricot de mouton, et puis, petit à petit, elle lui a volé son nom. Fini la fève, venue d’outre-mer, vive le haricot !
Et quand il ne restait plus rien à manger dans les tranchées, sur les champs de bataille, dans les casernes ou dans les pensionnats… on entendait murmurer ici ou là : « C’est la fin des haricots ! »
C’est là que le bât blesse
« C’est là que le bât blesse »… oui, c’est bien là que ça fait mal. C’est en appuyant physiquement ou moralement, à cet endroit, que la douleur et la souffrance sont ressenties !
On le sait bien, dans la vie il y a des hauts et des bas ; mais ces « bas » n’ont rien à voir avec notre « bât », un nom commun masculin venant d’un verbe latin signifiant « porter ».
Ce « bât » nous offre lui aussi un verbe. Non pas le verbe « battre » et encore moins le verbe « bâtir », mais le verbe « bâter », qui s’écrit lui aussi avec un accent circonflexe sur le « a » et ne comporte qu’un seul « t ».
Une fois conjugué, ce verbe est utilisé dans l’expression « un âne bâté » qui désigne un imbécile, quelqu’un de stupide, stupide comme un âne… paraît-il !
 Ce « bât » nous offre lui aussi un verbe.
Ce « bât » nous offre lui aussi un verbe.
Cet âne que l’on retrouve partout depuis « le bonnet d’âne », porté par quelques écoliers, jusqu’au « coup de pied de l’âne » évoqué par Jean de La Fontaine dans l’une de ses fables.
Depuis des siècles, l’âne est aussi utilisé comme bête de somme. Cette somme en question n’est ni un calcul, ni du sommeil, mais un chargement suspendu au bât, attaché sur son dos et s’il est mal fixé, « c’est là que le bât blesse »…
C’est une autre paire de manches
« C’est une autre paire de manches », voilà une expression qui évoque un véritable changement, un retournement de situation, voire une nouvelle difficulté !
Ce mot « manche » a une origine latine, il vient de manus , la « main » ! Que ce soit au féminin : « LA manche » ou bien au masculin : « LE manche », l’origine est la même. Car pour l’une et l’autre, tout est lié : main et manche forment un ensemble.
Pour enfiler une manche, il faut d’abord passer la main !
Pour tenir un manche, il est nécessaire d’utiliser la main !
Pour traverser la Manche, il faut nager avec les mains !
Pour jeter le manche après la cognée, il faut encore la main !
Alors oui, main et manche sont indissociables !
Cette expression, qui existe déjà à la fin du Moyen Âge, viendrait d’une habitude vestimentaire. En cette époque lointaine, les femmes aisées portaient une sorte de large fourreau à manches… amovibles ! C’est bien là toute l’originalité de ce vêtement dont on pouvait changer les manches en utilisant des matières, des formes ou des couleurs différentes, suivant les lieux où l’on se trouvait ou suivant les heures de la journée.
 Les femmes aisées portaient une sorte de large fourreau à manches… amovibles !
Les femmes aisées portaient une sorte de large fourreau à manches… amovibles !
Parfois même, cette facilité était utilisée comme un langage amoureux : « Si je porte des manches bleues, ne fais pas le peureux et soyons heureux… » Parfois, ces manches étaient offertes en gage d’amour ou en récompense lors d’un tournoi ! Pour les obtenir, le preux chevalier devait retrousser ses manches, se battre jusqu’au bout et vaincre son adversaire dans la grande tradition chevaleresque… Mais là, voyez-vous… « C’est une autre paire de manches »…
« Coincer la bulle »…, c’est ne rien faire, se reposer sur ses lauriers en attendant que le temps passe !
C’est buller ! C’est prendre un repos sans doute bien mérité ! Mais c’est tout de même une curieuse notion de temps !
Voyons d’abord de quelle bulle il s’agit… Est-ce la bulle d’une quelconque boisson pétillante ? Est-ce la petite bulle d’air que laissent échapper les poissons ou les plongeurs ? Est-ce la bulle qui permet aux héros de bandes dessinées de s’exprimer sur le papier ?
 C’est ne rien faire, se reposer sur ses lauriers en attendant que le temps passe !
C’est ne rien faire, se reposer sur ses lauriers en attendant que le temps passe !
NON, rien de tout cela ! Cette bulle qui se coince était, à l’origine, celle du niveau d’eau dont se servaient les artilleurs pour régler la parfaite horizontalité de leurs mortiers. Une fois le réglage terminé, une fois la « bulle coincée » entre ses repères, il ne restait plus qu’à attendre… Attendre les ordres !
D’abord instrument de balistique, ce niveau d’eau, ce « niveau à bulle », est devenu un outil très utile sur les chantiers, pour bâtir bien droit et on le retrouve dans les laboratoires scientifiques pour ajuster certains appareils.
Finalement, je m’aperçois que c’était du travail et que ce n’était pas un exercice de tout repos que de… « coincer la bulle »…
« Conter fleurette », confier son amour, affirmer sa passion, laisser parler son cœur, voilà de beaux et nobles sentiments amoureux !
Le mot « fleurette » est un diminutif du mot « fleur » dont le langage est lié pour l’éternité à l’amour… Le fuchsia et le gardénia sont des fleurs de romantiques ; le dahlia et le camélia sont des fleurs d’amoureux !
 Il nous raconte comment le futur Henri IV a rencontré la jeune Fleurette !
Il nous raconte comment le futur Henri IV a rencontré la jeune Fleurette !
« Fleurette » est à rapprocher du verbe « fleureter » qui signifie « passer de fleur en fleur », comme un insecte qui butine. Fleureter, c’est aussi faire la cour à de jolies fleurs qui se prénomment : Rose ou Marguerite !
Ces mots français ne doivent pas être confondus avec l’anglais to flirt qui viendra se glisser dans nos dictionnaires avec le nom commun « flirt », pour parler d’une amourette, et le verbe « flirter » qui signifie « conter fleurette ».
Читать дальше
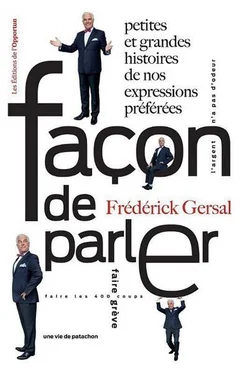
 Quand le haricot est arrivé en Europe au XVI esiècle, il s’est d’abord appelé « fève ».
Quand le haricot est arrivé en Europe au XVI esiècle, il s’est d’abord appelé « fève ».