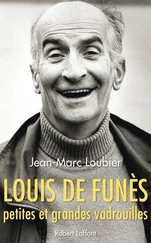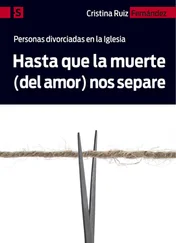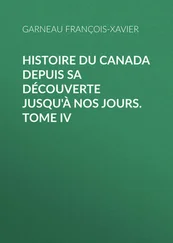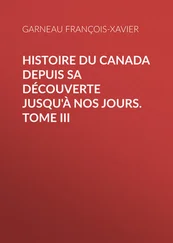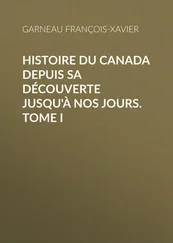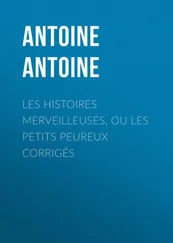Alors entre la pomme et la poire, il a fallu choisir ! C’est le temps qui a coupé la poire en deux, laissant à la pomme d’autres expressions comme « la pomme de discorde » ou « tomber dans les pommes » !
La poire et le fromage vont rester unis pour toujours ! Et grâce à cette expression, aujourd’hui encore il y a fromage ET dessert au menu.
J’espère vous avoir ouvert l’appétit comme cela, discrètement, entre deux portes, « entre la poire et le fromage »…
L’expression « épater la galerie » signifie en mettre plein la vue à son entourage ou à quelqu’un en particulier ! Frimer, rouler des mécaniques et sans doute en faire des tonnes !
Vous l’avez compris, dans cette expression, la « galerie » dont il est question, ce n’est rien d’autre que VOUS et MOI ; c’est NOUS… C’est un terme générique pour désigner un ensemble de personnes, une foule anonyme.
Pourtant, à l’origine, le mot « galerie » désignait bien un lieu précis qui n’était ni une galerie de tableau, ni une galerie marchande, non ! Mais un lieu situé légèrement en hauteur, permettant à des spectateurs d’assister aux parties de jeu de paume.
Ça y est, cette fois les mots magiques sont prononcés : le jeu de paume !
 Ça y est, cette fois les mots magiques sont prononcés : le jeu de paume !
Ça y est, cette fois les mots magiques sont prononcés : le jeu de paume !
Cet ancêtre du tennis a sans doute d’abord été utilisé dans les monastères. Pour se détendre les moines jouaient avec une balle qui devait rebondir sur le sol, les murs et les toits de leur abbaye !
Petit à petit ce jeu a été codifié. À l’origine, on jouait avec la paume de la main, d’où son nom de « jeu de paume », puis les joueurs se sont protégé les mains avec des gants, puis ils ont inventé les raquettes… Ce jeu d’extérieur s’est mis à l’abri dans une grande salle où deux joueurs s’affrontaient, séparés par une sorte de filet. C’est pour éviter que les spectateurs ne s’installent SUR le terrain de jeu que furent créées ces fameuses galeries ! Les paumiers et autres amateurs du jeu de paume n’avaient plus qu’à montrer leur talent pour « épater la galerie »…
« Être au bout du rouleau », c’est être fatigué, épuisé ! C’est être à bout ! À bout de nerfs ou à bout de patience pour certains, à bout de force ou à bout de souffle, pour d’autres.
En « étant au bout du rouleau », surtout ne croyez pas être au « bout du tunnel » et ce n’est pas pour autant que vous serez « au bout de vos peines »… Alors pour mieux comprendre, prenons cette expression par le bon bout !
Le mot « rouleau » est un dérivé du mot « rôle », qui désignait à l’origine une liste ou un texte, écrit sur une feuille qui était roulée ! Prenons l’exemple des comédiens. Pour connaître leur texte, ils déroulaient leurs feuilles et ils apprenaient par cœur ce « rôle » !
 Pour connaître leur texte, ils déroulaient leurs feuilles et ils apprenaient par cœur ce « rôle » !
Pour connaître leur texte, ils déroulaient leurs feuilles et ils apprenaient par cœur ce « rôle » !
Ils devaient bien sûr l’apprendre de la première à la dernière ligne, du premier mot, jusqu’au dernier, du début à la fin, d’un bout à l’autre de ce rouleau de feuille.
L’image est simple : en arrivant au bout de ce « rôle », au bout de ce texte, les acteurs arrivaient au bout de leurs répliques et de leurs arguments. En se retrouvant là… il ne faut pas s’étonner d’« être au bout du rouleau »…
« Être au taquet », c’est être à fond, avoir la pêche, être au top, au maximum. C’est même devenu la règle, dans nos sociétés occidentales.
Plus qu’une règle, c’est une nécessité. Par exemple, pour celles et ceux qui veulent décrocher un emploi. Il faut montrer son envie, sa volonté, son enthousiasme en permanence !
Il faut se montrer conquérant, avoir un appétit dévorant pour passer devant les autres candidats et décrocher cette place tant convoitée ! Il faut « être au taquet » pour les rendez-vous, les tests, les entretiens et les périodes d’essai. Il ne faut rien laisser au hasard.
Ce taquet désigne généralement une petite pièce de bois qui peut être utilisée soit pour caler un objet ou un meuble, soit pour maintenir une porte ouverte, entrouverte ou fermée.
Quelle que soit son utilisation, le taquet est là pour immobiliser, pour bloquer et c’est justement ce blocage qui désigne, au sens figuré, une position extrême, une position maximale !
Aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle, c’est vraiment une question de tempérament, parce qu’il faut avoir du ressort pour « être au taquet »…
 Il faut montrer son envie, sa volonté, son enthousiasme en permanence !
Il faut montrer son envie, sa volonté, son enthousiasme en permanence !
« Être dans le coaltar », c’est se retrouver dans un état second, hébété, ahuri, presque inconscient.
« Être dans le coaltar », c’est être dans le brouillard, dans les vapes… qui évoquent certaines vapeurs de toutes sortes !
Ce mot « coaltar » s’écrit curieusement : C.O.A.L.T.A.R., mais il se prononce bien « coltar »… Ce nom commun, qui figure dans tous nos dictionnaires y compris celui de l’Académie française, est issu de deux mots anglais : coal qui veut dire « charbon » et tar qui signifie « goudron »… Le coaltar est en fait un goudron de houille !
 Le coaltar est en fait un goudron de houille !
Le coaltar est en fait un goudron de houille !
Ce goudron noir est le produit le plus efficace pour protéger le bois des assauts de l’eau de mer. Les coques des bateaux sont donc coaltarées, c’est-à-dire enduites de coaltar.
Cette similitude entre ce goudron bien noir, utilisé dans la marine, et l’état physique dans lequel sombre celle ou celui qui est dans le coaltar, explique parfaitement l’origine de cette expression !
Mais attention, la noirceur n’est pas suffisante !
La personne qui broie du noir, qui a des idées noires, qui voit tout en noir n’a semble-t-il rien à voir avec celle qui « est dans le coaltar »…
Être en odeur de sainteté
« Être en odeur de sainteté », voilà qui exprime une impression favorable… et pour cause, à l’origine, cela décrit une personne digne des plus grands éloges, une personne ayant une grande valeur spirituelle.
Cette sainteté concerne les femmes et les hommes qui ont été canonisés par l’Église, même si, au fil des siècles et après différentes réformes, les procès en béatification et en canonisation ont changé.
Tous ces saints fêtés par les chrétiens, notamment le jour de la Toussaint, sont dignes de foi. Il flotte autour d’eux comme un parfum de connaissance, de culture, de grande piété.
 Il ne faut surtout pas confondre avec le goût d’un saint-honoré, le parfum d’un saint-émilion ou l’odeur d’un saint-marcellin.
Il ne faut surtout pas confondre avec le goût d’un saint-honoré, le parfum d’un saint-émilion ou l’odeur d’un saint-marcellin.
Читать дальше
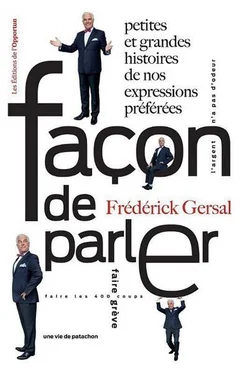
 Ça y est, cette fois les mots magiques sont prononcés : le jeu de paume !
Ça y est, cette fois les mots magiques sont prononcés : le jeu de paume !