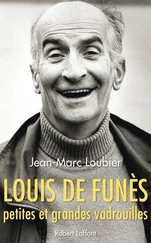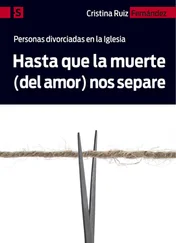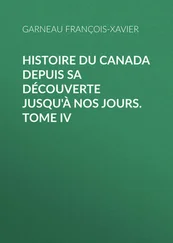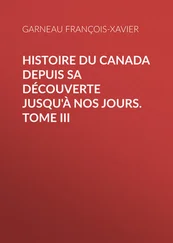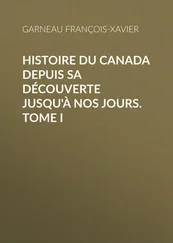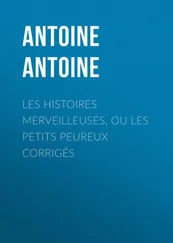Le mot « buissonnière » est un adjectif désignant un endroit buissonneux, c’est-à-dire un lieu touffu où poussent à la fois petits arbres et épineux, en général, tous buissonnants. Oui, enfin, pour nous résumer, c’est un lieu couvert de buissons.
 Pour d’autres historiens, cette école buissonnière serait née avec la Réforme.
Pour d’autres historiens, cette école buissonnière serait née avec la Réforme.
Parmi les buissons les plus célèbres, il faut se souvenir du « buisson ardent » dont l’histoire est racontée dans la Bible. Au cœur de ce buisson qui brûle sans que le feu ne le consume, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob s’est adressé à Moïse. Et quand on parle de « l’école buissonnière », à l’origine, il est encore question de religion. Pour expliquer cette expression, certains auteurs évoquent le concile de Pavie, de 1423, auquel de nombreux prélats ont refusé de se rendre, préférant « faire l’école buissonnière », à cause d’une épidémie de peste. Pour d’autres historiens, cette école buissonnière serait née avec la Réforme. Pour enseigner le catéchisme aux enfants, les protestants se sont cachés dans les campagnes et dans les bois, à l’abri des regards indiscrets. Cette habitude se serait tellement répandue qu’un arrêt du Parlement, paru au milieu du XVI esiècle, interdit ces véritables écoles clandestines. Désormais, fini les cours donnés dans les sous-bois ou derrière des buissons. Seuls les héros de contes, de fables et de romans osent… « faire l’école buissonnière »…
Faire la tournée des grands-ducs
« Faire la tournée des grands-ducs », voilà une expression synonyme de fête et de convivialité, dont l’origine est liée à la grande Histoire !
Parmi ces instants mémorables, il y a la visite officielle du tsar de Russie Nicolas II, accueilli à Paris au mois d’octobre 1896, par le président de la République Félix Faure.
Le but de cette visite ? Resserrer les liens entre les deux pays… Le programme du tsar est chargé. Il se rend à Versailles, au Louvre, à la Comédie-Française… On a mis les petits plats dans les grands !
 Parmi ces instants mémorables, il y a la visite officielle du tsar de Russie Nicolas II, accueilli à Paris.
Parmi ces instants mémorables, il y a la visite officielle du tsar de Russie Nicolas II, accueilli à Paris.
Mais le temps fort a lieu en bord de Seine, avec la pose de la première pierre du pont Alexandre-III, qui porte le nom du père du tsar Nicolas II.
Pendant que se déroulent les festivités officielles, l’entourage du tsar, et notamment les princes de la famille impériale, les grands-ducs, se prennent du bon temps, ils passent leurs soirées dans les bars, les cabarets et les restaurants les plus chic !
Ces grands-ducs russes, véritables oiseaux de nuit volant de lieux de spectacle en lieux de plaisir, ont dépensé de véritables fortunes en nous offrant une expression toujours enviée : « faire la tournée des grands-ducs »…
Oh ! là ! là ! « faire les 400 coups », ce n’est pas rien ! Cette expression est synonyme de diableries, de bêtises, de désordre… voire de mauvais coup !
Dans cette expression, on parle bien de « 400 coups », il y a à la fois le nombre « 400 » et le mot « coups » avec un « s » à la fin puisqu’ils sont 400 !
Les 400 coups, c’est également le titre du premier long-métrage de François Truffaut dans lequel Antoine Doinel, interprété par Jean-Pierre Léaud, est un adolescent qui mène une vie un peu décousue… bref il « fait les 400 coups » !
Alors bien sûr on connaît tous « le coup dur » et « le coup de force », « le coup de griffe » et « le coup de fourchette », « le coup de gueule » et « le coup de théâtre », « le coup de tonnerre » et « le coup de foudre » ! Mais c’est inutile d’en chercher d’autres… Car ces 400 coups n’ont rien à voir avec tout cela. Pour comprendre, il faut nous plonger au cœur du règne de Louis XIII.
 Et pour prouver sa toute-puissance aux assiégés, il fait installer 400 canons.
Et pour prouver sa toute-puissance aux assiégés, il fait installer 400 canons.
Nous sommes en 1621, le roi est jeune, il a 20 ans, et cela fait déjà près de onze ans qu’il a succédé à son père Henri IV sur le trône de France. Avec le duc de Luynes, le roi est venu faire le siège de la ville de Montauban dans l’actuel département du Tarn-et-Garonne. Louis XIII est bien décidé à se saisir de cette citadelle protestante. Et pour prouver sa toute-puissance aux assiégés, il fait installer 400 canons qui vont tirer tous ensemble. Cette débauche d’artillerie ne parvient pourtant pas à faire céder la ville. Du coup, d’un seul coup, ces fameux 400 coups s’expliquent et, d’un seul coup, tout s’éclaire… Mais ce n’est pas une raison suffisante pour « faire les 400 coups »…
« Faire volte-face », c’est ni plus ni moins : faire demi-tour, se retourner complètement.
« Faire volte-face » signifie également changer d’avis ou d’opinion, rapidement… et, pourquoi pas, en profiter pour choisir une autre voie !
« Une volte-face » est un nom commun invariable qui vient d’un mot italien qui peut se traduire par « tourner la face, tourner le visage » pour regarder derrière soi et voir ses attaquants, s’éloigner ou se rapprocher dangereusement !
 « Faire volte-face », c’est finalement « faire face » à ses adversaires !
« Faire volte-face », c’est finalement « faire face » à ses adversaires !
« Faire volte-face », c’est faire ce demi-tour sur soi-même qui permet de faire front, d’affronter les agressions ou les embûches de toutes sortes. « Faire volte-face », c’est finalement « faire face » à ses adversaires !
« Faire face », deux mots qui furent choisis comme devise par le grand pilote Georges Guynemer, une devise conservée par l’École de l’air de Salon-de-Provence.
Dans un débat, les adversaires sont renvoyés dos à dos. Ils défendent pied à pied leurs idées, leurs opinions… Ils font face. Ils ne veulent pas perdre la face, dans ce face-à-face. Alors pour eux, il est devenu impensable de « faire volte-face »…
Être fier, ce n’est pas toujours une qualité… mais quelqu’un qui est « fier comme Artaban », alors là, cela devient inadmissible, insupportable ; cette personne a décidément la tête trop grosse, trop enflée…
« Fier comme Artaban », voilà trois mots qui forment une expression depuis le XVII esiècle. Il y a d’abord l’adjectif « fier », qui désigne quelqu’un de sûr de lui, se sentant supérieur aux autres ; il y a ensuite le mot « comme », un adverbe ou une conjonction indiquant une comparaison.
Venons-en maintenant au mot le plus étrange… Le troisième mot de cette expression « fier comme Artaban » ! A.R.T.A.B.A.N. ! Mais au fait, de quoi ou de qui s’agit-il ?
 Artaban est un glorieux personnage de roman.
Artaban est un glorieux personnage de roman.
Читать дальше
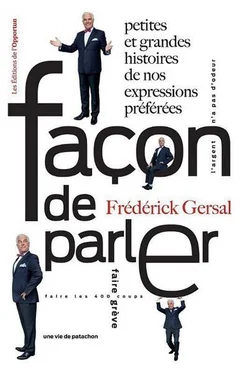
 Pour d’autres historiens, cette école buissonnière serait née avec la Réforme.
Pour d’autres historiens, cette école buissonnière serait née avec la Réforme.