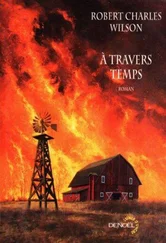Accompagné de trois personnes. Ng portait ses habituels T-shirt déchiré et jean loqueteux. Les autres étaient vêtus de manière similaire, mais avec des casquettes enfoncées sur les yeux à la manière des jeunes formigas tout juste arrivées des villes. Une sorte de déguisement, pensa Meirelles, mais pas très efficace, et sûrement insoutenable par cette chaleur. Ne voyant aucun signe d’une présence de la police militaire, Meirelles s’avança vers la table, enfonça son corps sur une chaise et attendit que Ng prenne la parole.
« Tu l’as ? » demanda à voix basse celui-ci.
Meirelles sentit le cœur lui manquer. À en juger par son attitude – désinvolte, presque amusée –, Ng ne savait manifestement rien de la descente de police sur sa cabane, n’avait sans doute pas deviné que la police le cherchait tout particulièrement.
Meirelles pensa : et si je lui dis ?
Il jeta un coup d’œil aux trois compagnons du Vietnamien : deux hommes et une femme. Celui de gauche était grand, sans doute américain, avec une expression prudente et des yeux qui s’attardèrent un instant de trop sur ceux de Meirelles. Celui de droite, plus petit et de toute évidence plus nerveux, avait de longs cheveux d’un blanc sale. La femme entre eux, belle à sa manière sombre, semblait égarée : ses mains se nouaient et se dénouaient, son front se plissait.
C’est elle qui veut la pierre , pensa Meirelles.
« Elle est là, assura-t-il en anglais d’une voix rauque. Elle est là… je l’ai. »
Il vit une légère lueur passer dans les yeux sombres de Ng.
« Donnez-lui l’argent, intima ce dernier.
— Je ne vois pas la pierre », répliqua l’Américain aux cheveux blancs.
La femme toucha la main de celui-ci : une espèce de communication subtile, un avertissement, peut-être. Et le grand Américain observait.
L’homme aux cheveux blancs soupira, plongea la main dans sa poche et en sortit deux bouts de papier. Un pour Ng, un pour lui. Ils sont si minces ! pensa Meirelles. L’échange lui sembla un instant stupide : l’onirolithe, objet solide, contre ces fragiles bouts de papier.
Il déplia le sien qu’il inspecta assez longtemps pour s’assurer de sa légitimité, du moins apparente : un certificat bancaire de la Bradesco, avec un montant en cruzeiros si élevé qu’il en eut le vertige. « Très bien, s’entendit-il dire. Parfait. »
Ng empocha son propre certificat en souriant.
Meirelles sortit l’onirolithe dans son emballage de toile cirée sale, que l’Américain aux cheveux blancs regarda d’un air soupçonneux. « Comment savons-nous que c’est ce que nous voulons ? »
Mais la femme lui toucha à nouveau la main. « C’est bien ce que nous voulons. »
Elle le sent, pensa Meirelles. Elle y est sensible. Il la regarda tendre la main vers la pierre, perçut son hésitation, son respect envers la pierre. « Prenez-la, l’encouragea-t-il. Touchez-la. Elle ne vous fera rien, à travers la toile cirée. » Elle ne comprit pas son portugais mais sembla réconfortée par ses paroles.
Ng saisit la main de Meirelles qu’il serra au-dessus de la table. Transaction menée à bien.
Maintenant, pensa Meirelles. S’il voulait l’avertir, pour la police militaire, il fallait en parler maintenant. S’ils partaient sans savoir, ils risquaient de retourner chez Ng et de tomber entre les mains de la police.
Et si Ng sait, se dit Meirelles… voudra-t-il récupérer l’argent ?
Il sentit le certificat bancaire comme une chaleureuse présence dans sa poche. Un billet pour rentrer retrouver sa femme et sa fille. Un billet pour sortir de Pau Seco et de Cubatão. Un morceau de papier contenant une vie meilleure.
Il retira la main au moment où Ng se levait. Les Américains se dressaient au-dessus de lui.
« Attendez », dit-il.
Ng plissa les yeux. « Qu’est-ce qu’il y a ? »
Meirelles sentit la sueur lui perler au front. Il regarda le Vietnamien bien en face. Ce n’était pas le genre de visage auquel il était habitué. Il ne savait pas le déchiffrer.
« La police, expliqua-t-il d’une voix éteinte. Tu as été trahi. »
Ng le regarda avec gravité pendant une longue seconde. Il se pencha, les phalanges posées sur la petite table en bois, le regard terrible, captivant. Meirelles ne put détourner le sien. Grâce, songea-t-il stupidement.
Mais Ng se contenta de lui serrer à nouveau la main.
« Merci, Roberto, dit-il. Merci de m’avoir prévenu. »
Les trois Américains sortirent à sa suite.
1. Ng leur dit d’aller attendre en bas de la route à un endroit qu’il leur décrivit. Un camion viendrait, assura-t-il.
« C’est un piège, si ça se trouve, dit Byron. Il nous a peut-être vendus. »
Keller s’attendait à une réaction de colère du Vietnamien, mais Ng se contenta de secouer la tête. « J’ai une certaine morale, affirma-t-il. Je ne trahis pas ceux qui me payent. »
Protégés par leurs vêtements, par la nuit et par la foule de corps humains autour d’eux, ils descendirent donc la route qui partait de la mine pour traverser la vieille ville, évitant les feux d’ordures et avançant les épaules voûtées, d’une démarche résolue mais pas trop rapide, l’œil ouvert pour repérer les patrouilles de police. Une fois hors de la ville, ils restèrent dans l’ombre à la lisière de la forêt. Un chien au thorax bombé les accompagna pendant quatre cents mètres en clopinant sur trois pattes, et Byron dut lui jeter un caillou pour qu’il s’éloigne.
Ils finirent par arriver à l’endroit décrit par Ng, un élargissement de la route là où une piste forestière la rejoignait par l’ouest. Il était plus de minuit et on voyait très peu de circulation. À deux reprises, de gros et antiques semi-remorques diesel se dirigeant vers Pau Seco passèrent en vrombissant. Plus inquiétant, ils virent aussi un transport militaire. La route resta toutefois vide la plupart du temps, et les bruits nocturnes de la forêt y résonnaient dans les ténèbres.
Keller somnolait debout quand une camionnette l’éveilla en s’arrêtant au bord de la route. La clarté diffuse apparue dans le ciel lui permit de lire le mot eletronorte en vagues lettres blanches sur la carrosserie piquetée de rouille. Le chauffeur attendait, moteur au ralenti.
Keller se montra le premier, puis Byron et enfin Teresa. Le chauffeur, un Amérindien aux grands yeux imperturbables, leur fit signe de monter à l’arrière. Keller verrouilla la portière derrière lui et la camionnette repartit dans une secousse.
Ils s’installèrent sur le plancher métallique vide, le dos contre la cloison de la cabine. « Où nous emmène-t-il ? » demanda Teresa d’un ton las.
Byron haussa les épaules. « Aucune importance. On ne peut pas rentrer par Rio. Il va falloir rester à l’écart de toutes les grandes villes. »
Teresa gardait dans la main l’onirolithe emballé, tenant délicatement l’ensemble entre ses doigts. « Au moins, dit-elle, on a ce qu’on est venu chercher.
— Toi, oui, répliqua Byron. Et Ray aussi, j’imagine. Tu as enregistré des images plutôt bien, hein, Ray ? De sacrément bonnes images. »
Keller ne dit rien. Les yeux de Teresa se fermaient et elle s’appuyait maintenant contre lui. Keller tendit le bras pour la stabiliser, et la fourgonnette les éloigna de Pau Seco dans la nuit.
Il flotta un moment au bord du sommeil, conscient de la chaleur et du poids du corps de Teresa contre le sien tandis que la camionnette eletronorte bringuebalait dans l’aube. De temps en temps, le chauffeur leur jetait un coup d’œil, mais sans rien dire, avec une expression un peu perplexe, comme s’il essayait de comprendre cette nouvelle et mystérieuse cargaison. Quand la lumière arrivant par la cabine l’éveilla, Keller finit par arriver à sourire. « Merci pour la balade », croassa-t-il.
Читать дальше