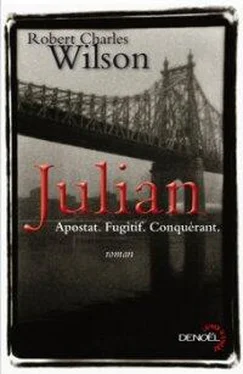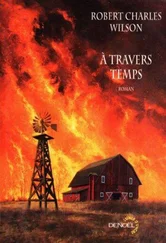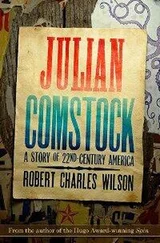« Lumière à l’est sur l’horizon, mon général », a bientôt signalé à Julian un adjudant-major. J’ai en effet constaté un éclaircissement dans cette direction, l’éclat de l’air qui annonce l’aube.
« Ramenez ! » a ordonné Julian.
Ces premières lueurs, même faibles, rendaient plus visible le champ de bataille. Quelques-uns des Cerfs-Volants Noirs avaient été trop abîmés pour continuer à servir, ou bien des balles avaient sectionné leurs lignes, et ceux-là étaient tombés comme d’énormes chauves-souris blessées au milieu des Hollandais. Les troupes mitteleuropéennes ne prêtaient cependant que peu d’attention aux cerfs-volants à terre… En fait, la plupart couraient sans but.
J’ai essayé de m’imaginer à la place d’un de ces soldats et de voir les choses comme lui. Un gémissement lugubre le sort de son sommeil troublé et le voilà qui se retrouve dans le noir avec des Lumières Volantes bizarres en train de descendre en nombre sur son camp. Toutes sortes de peurs et de fantasmes cherchent à attirer son attention. Il se réjouit qu’on donne l’ordre de tirer à volonté, il soulève son fusil hollandais – disons que ce soldat est tireur d’élite – et lâche balle après balle sur les inquiétantes cibles au-dessus de lui. Peu importe qu’il ne les atteigne pas : mille autres font exactement comme lui.
Ces coups de feu lui redonnent courage. Sauf qu’il ne tarde pas à déceler une certaine odeur infecte, désagréable mais impossible à identifier, composée (il n’en sait cependant rien) de tous les poisons expédiés dans les airs par les hommes de Julian : poudres raticides, solvants à peinture, soude à savon, déchets hospitaliers… une goutte de quelque chose tombe sur une portion de peau nue et le picote ou le brûle. Il plisse à nouveau les paupières pour explorer du regard le ciel nocturne ; ses yeux sont inondés de produits caustiques ; ses larmes coulent malgré lui, il ne voit plus rien…
Ces outres ne contenaient pas suffisamment de toxines et de poisons pour tuer une armée de Hollandais, peut-être même pas pour en tuer un seul, sauf heureux coup du sort. Notre hypothétique soldat s’étouffe toutefois, il sue, il s’imagine assassiné ou du moins mortellement contaminé. Ce n’est pas une menace qu’il peut endiguer ou affronter. Elle sort de la nuit comme une calamité surnaturelle. Il ne peut en fin de compte que la fuir à toutes jambes.
Il n’est pas le seul à aboutir à cette conclusion.
Quand j’ai regardé le camp adverse, j’y ai vu le chaos. Le lever du jour ne pouvait en rien dissiper les craintes si habilement suscitées par Julian. Qui n’en avait d’ailleurs pas terminé. « Feu aux obus », a-t-il crié, ordre qui a été promptement transmis à nos batteries d’artillerie. De toute évidence, Julian avait ordonné qu’on remplît certains obus d’un mélange (comme il me l’a ensuite décrit) de poudre antipuces et de teinture rouge. Ceux-là ont explosé en énormes nuages de poudre ambre, que le vent a emportés en gros tourbillons au milieu de l’infanterie ennemie… nuages inoffensifs, mais que les Hollandais ont imaginés pleins d’un puissant poison et qu’ils ont fuis comme ils n’auraient jamais fui un barrage d’artillerie conventionnel.
Les commandants mitteleuropéens passaient à cheval entre les hommes en essayant de rallier leurs troupes, mais il est vite devenu clair que le centre hollandais s’était effondré, ouvrant la place à une progression américaine.
Julian a aussitôt ordonné l’attaque. Quelques instants plus tard, tout un régiment d’infanterie américain, capuchon de soie noire sur la tête, a jailli de nos tranchées comme de nos ravelins avec des hurlements féroces tout en brandissant des fusils Pittsburgh et quelques très précieuses Balayeuses de Tranchées.
Le commandant hollandais a paniqué et jeté toutes ses forces contre nous pour essayer de tenir le centre. Julian, qui avait prévu cette réaction, s’est dépêché de lancer notre cavalerie sur les flancs ennemis. Nos cavaliers étaient aussi affamés que leurs montures, mais leur charge a été efficace. D’autres Balayeuses de Tranchées ont été braquées. Le soleil fade, quand il a enfin crevé l’horizon, a jeté ses rayons sur un sanglant carnage.
Toute notre armée était en passe de s’évader, l’infanterie et la cavalerie devant, les chariots de ravitaillement et les blessés transportables derrière, protégés en queue par d’autres fantassins et cavaliers. « Avec moi, Adam ! » a crié Julian. On nous a amenés deux étalons aux côtes saillantes, sellés et équipés de provisions comme de munitions, et nous sommes partis au galop vers l’est derrière un courageux déploiement de drapeaux de régiment.
Il m’était bien entendu déjà arrivé d’assister à des batailles désespérées, mais celle-ci avait quelque chose de particulièrement cru et horrible.
Nous sommes arrivés dans un paysage ravagé et bouleversé derrière les régiments qui ouvraient la marche. Désormais abandonnées, les positions hollandaises étaient dangereuses pour nous : de nombreux chevaux sont morts de leurs blessures après avoir trébuché dans les tranchées ou les cratères. Cette première progression, avec ce qu’il restait des Cerfs-Volants Noirs de Julian, avait laissé derrière elle un charnier que seuls les morts n’avaient pas abandonné. Les troupes hollandaises fauchées par les Balayeuses de Tranchées gisaient sur place, le corps contorsionné par leur agonie. Le barrage d’artillerie à la poudre colorée avait teint la neige piétinée de panaches écarlates et la puanteur des divers émoluments aériens se combinait en une vapeur chimique âcre et excrémentielle qui, malgré sa forme dissipée, nous tirait des larmes en abondance.
Julian a continué vers l’avant en dépassant des compagnies d’infanterie et en s’arrêtant à un moment pour ramasser le Drapeau de Bataille de la Campagne de Goose Bay. Cela a été une vision exaltante, malgré (ou à cause de) l’état loqueteux dudit drapeau.
NOUS AVONS MARCHÉ SUR LA LUNE, affirmait-il, ce que nous pouvions être en train de faire à nouveau, à en juger par le paysage de désolation, même si, j’imagine, la Lune n’est pas vérolée de grossiers abattis ni de feuillées. Chaque compagnie d’infanterie devant laquelle nous passions se réjouissait de voir cet étendard, et les cris de « Julian le Conquérant ! » étaient monnaie courante.
Nous sommes parvenus sur un terrain complexe légèrement boisé. Le vent, que nous avions appelé de nos plus ferventes prières et accueilli avec le plus grand enthousiasme, devenait d’heure en heure plus gênant. Des nuages bas traversaient le ciel en rafales et bourrasques, chassant l’ancienne neige de l’atmosphère et apportant de nouvelles précipitations. L’armée hollandaise avait fui devant nous, mais nous ne l’avons pas poursuivie : nous cherchions l’évasion, non la confrontation, et durant un temps, les seuls combats ont été sporadiques, quand nous rencontrions et écrasions des fantassins mitteleuropéens débandés.
Le commandant ennemi n’avait toutefois rien d’un idiot et tandis que la neige ralentissait notre progression, il s’activait à rallier ses troupes sur leurs positions de repli. Ce dont nous avons eu le premier indice quand des coups de feu ont éclaté à l’est dans le brouillard neigeux… j’ai cru à une autre escarmouche, mais Julian a froncé les sourcils et éperonné son cheval.
Dans notre empressement à nous enfuir de Striver, nous avions laissé nos troupes se disperser quelque peu et il semblait à présent que notre avant-garde fût tombée dans un piège. Le bruit des coups de fusil a rapidement augmenté et tandis que nous en approchions au galop, nous avons commencé à voir des files de blessés qui revenaient vers nous en boitant. On se battait avec acharnement devant nous, d’après un soldat, « et les Hollandais ne fuient plus, mon général… ils tiennent bon ! »
Читать дальше