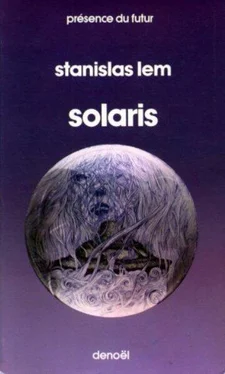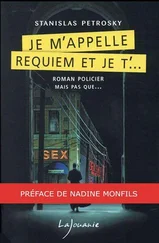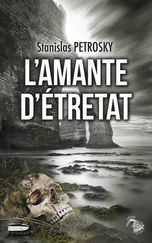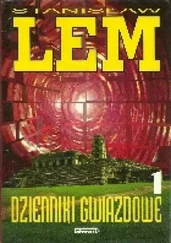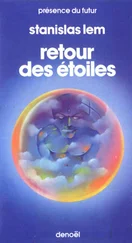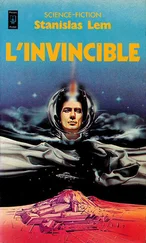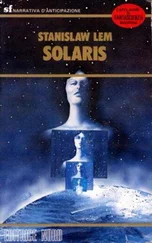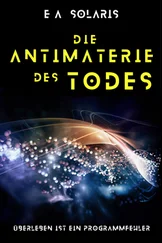J’entendis le cliquetis des interrupteurs ; la lumière des lampes pénétra mes paupières. Je clignai des yeux. Sartorius n’avait pas bougé ; il m’observait. Snaut, le dos tourné, furetait auprès de l’appareil, et il me sembla qu’il se plaisait à faire claquer les sandales qui glissaient de ses pieds.
— Pensez-vous, Dr Kelvin, que la première étape de l’expérience ait réussi ? demanda Sartorius de cette voix nasale que je détestais.
— Oui.
— En êtes-vous certain ? insista-t-il avec un peu d’étonnement, et peut-être même de la méfiance.
— Oui.
Un bref instant, mon assurance et le ton rude de ma réponse triomphèrent de sa raideur.
— Ah … bien, bredouilla-t-il, l’air désemparé.
Snaut s’approcha de moi et commença à dérouler les bandes qui me ceignaient la tête. Sartorius recula, hésita, puis il disparut dans la chambre noire.
Je me dégourdissais les jambes, quand Sartorius reparut, tenant à la main le film déjà développé et séché. Des lignes tremblantes dessinaient une dentelle blanche sur quinze mètres de ruban noir et luisant.
Ma présence n’était plus utile, mais je restai. Snaut introduisit le film dans la tête oxydée du modulateur. Sartorius, l’œil triste et méfiant, regarda encore une fois l’extrémité du ruban, comme s’il tentait de déchiffrer le contenu de ces lignes vibrantes.
La mise en route de l’expérience n’avait rien de spectaculaire. Snaut et Sartorius s’étaient installés chacun à un tableau de commande et manipulaient des boutons. À travers le sol blindé, j’entendis le grondement assourdi du courant dans les bobines ; les traits lumineux tombèrent le long des tubes de verre des compteurs, signifiant que le corps de l’énorme canon à rayons X descendait pour se placer à l’orifice du puits qui l’abritait. Les traits lumineux s’arrêtèrent aux minima.
Snaut éleva la tension ; la flèche blanche du voltmètre décrivit un demi-cercle de gauche à droite. Maintenant, le bourdonnement du courant était à peine audible. Le film se déroulait, invisible sous deux capots sphériques ; des chiffres sautaient avec un léger tintement dans le voyant de l’indicateur de métrage.
Je m’approchai de Harey, qui nous regardait par-dessus son livre. Elle me jeta un coup d’œil interrogateur. L’expérience venait de se terminer ; Sartorius se dirigeait vers la grosse tête conique de l’appareil.
Les lèvres de Harey dessinèrent une interrogation muette :
— On part ?
Je répondis par un signe affirmatif. Harey se leva. Sans prendre congé de personne, nous quittâmes la salle.
Un crépuscule admirable éclairait les fenêtres du couloir à l’étage supérieur. L’horizon n’était pas roussâtre et lugubre, comme d’habitude à cette heure, mais d’un rose chatoyant, pailleté d’argent. Sous la caresse suave de la lumière, les vallonnements sombres de l’océan avaient de doux reflets violets. Le ciel n’était roux qu’à son zénith.
Quand nous fûmes arrivés au bas de l’escalier, je m’arrêtai. Je ne pouvais pas supporter l’idée que nous allions de nouveau rester enfermés dans ma cabine, comme dans une cellule de prison.
— Harey … je voudrais voir quelque chose dans la bibliothèque … ça ne t’ennuie pas ?
Avec une animation un peu forcée, elle s’écria :
— Oh, non ! Je trouverai de la lecture …
Depuis la veille, j’en avais conscience, un fossé s’était creusé entre nous. J’aurais dû me montrer plus cordial, vaincre mon apathie. Mais où puiser la force de secouer cette torpeur ?
Nous descendîmes la rampe qui conduisait à la bibliothèque ; dans le petit vestibule, il y avait trois portes et des fleurs sous globes de cristal étagés contre les murs.
J’ouvris la porte du milieu, recouverte de cuir synthétique sur ses deux faces — en entrant dans la bibliothèque, j’évitais toujours de toucher ce capitonnage. Une agréable bouffée d’air frais m’accueillit ; la grande salle circulaire, malgré le soleil stylisé peint au plafond, ne s’était pas réchauffée.
Caressant distraitement le dos des livres, j’allais choisir, entre tous les classiques de Solaris, le premier volume de Giese, afin de revoir le portrait ornant la page de titre, quand je découvris par hasard l’ouvrage de Gravinsky, un in-octavo à la reliure craquelée, que je n’avais pas remarqué auparavant.
Je m’installai sur une chaise rembourrée. Harey, assise à côté de moi, feuilletait un livre ; je l’entendais tourner les pages. L’abrégé de Gravinsky, que les étudiants consultaient généralement comme un aide-mémoire, était une classification par ordre alphabétique des hypothèses solaristes. Le compilateur, qui n’avait jamais vu Solaris, avait dépouillé toutes les monographies, tous les comptes rendus d’expédition, les aperçus fragmentaires et les communications provisoires ; il avait même pêché des citations dans les ouvrages de planétologues étudiant d’autres globes. Il avait rédigé un inventaire où abondaient des formulations simplistes, qui réduisaient grossièrement les subtilités de la pensée originale ; l’ouvrage, conçu avec des prétentions encyclopédiques, n’était plus guère aujourd’hui qu’une curiosité. L’abrégé de Gravinsky avait paru vingt ans plus tôt, mais depuis lors une telle quantité d’hypothèses nouvelles s’étaient accumulées qu’un seul livre n’aurait pas suffi à les contenir. Je parcourus l’index, presque une liste nécrologique, car un petit nombre des auteurs cités vivaient encore ; parmi les survivants, aucun ne participait plus activement aux études solaristes. En lisant tous ces noms, en mesurant la somme d’efforts intellectuels exercés dans toutes les directions, on ne pouvait s’empêcher de penser que l’une au moins des hypothèses formulées devait être juste, et que les milliers d’hypothèses avancées devaient contenir chacune quelque parcelle de vérité — que la réalité ne pouvait être entièrement autre.
Dans son introduction, Gravinsky divisait en périodes les soixante premières années d’études solaristes. Pendant la période initiale — qui débutait avec l’expédition envoyée en reconnaissance au-dessus de la planète — personne n’avait, à proprement parler, formulé d’hypothèses. Le « bon sens » admettait alors intuitivement que l’océan était un conglomérat chimique sans vie, une masse gélatineuse, qui par son activité « quasi volcanique » produisait des créations merveilleuses et stabilisait son orbite instable grâce à un processus mécanique autogène, de même qu’un balancier se maintient sur un plan fixe après avoir été mis en mouvement. À vrai dire, trois ans après la première expédition, Magenon avait émis l’idée que la « machine colloïdale » était vivante ; mais, chez Gravinsky, la période des hypothèses biologiques ne débutait que neuf ans plus tard, à une époque où l’opinion de Magenon, précédemment écartée, avait acquis de nombreux partisans. Les années suivantes abondèrent en descriptions théoriques de l’océan vivant, descriptions extrêmement complexes, étayées d’analyse biomathématique. Au cours de la troisième période, l’opinion des savants, jusqu’alors plus ou moins unanime, se divisa.
On vit surgir une foule d’écoles rivales, qui se combattaient furieusement. Ce fut l’époque de Panmaller, de Strobel, de Freyhouss, de Le Greuille, d’Osipowicz ; tout l’héritage de Giese fut soumis à une critique impitoyable. Les premiers atlas et les premiers inventaires parurent ; on présenta des stéréophotographies d’asymétriades, considérées récemment encore comme des créations impossibles à explorer — de nouveaux instruments téléguidés avaient été introduits à l’intérieur de ces colosses formidables, qu’une explosion imprévisible pouvait déchiqueter à chaque instant. Dans le tumulte des discussions, on écarta avec mépris les hypothèses « minimales » : même si on ne parvenait pas à établir ce fameux « contact » avec le « monstre raisonnable », estimaient certains, il valait la peine d’étudier les villes cartilagineuses des mimoïdes et les montagnes soufflées qui surgissaient à la surface de l’océan, car nous pourrions acquérir des connaissances chimiques et physicochimiques précieuses, et enrichir nos expériences dans le domaine de la structure des molécules géantes. Mais personne ne daignait engager la polémique avec les partisans de semblables thèses. On s’employait à dresser les inventaires des métamorphoses typiques, catalogues dont l’autorité subsiste aujourd’hui, et Frank développait sa théorie bioplasmatique des mimoïdes — bien que celle-ci se soit révélée inexacte, elle demeure un exemple superbe d’impétuosité intellectuelle et de construction logique.
Читать дальше