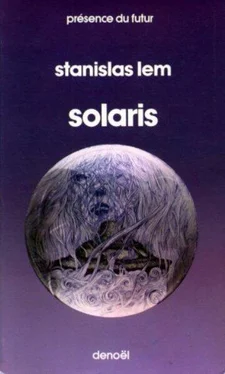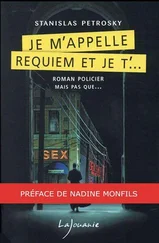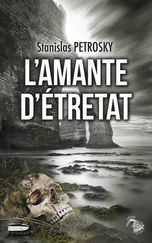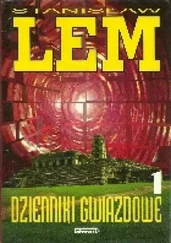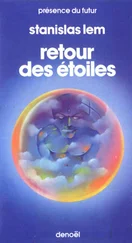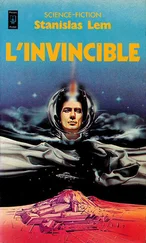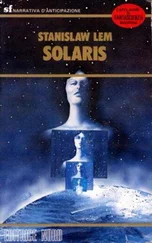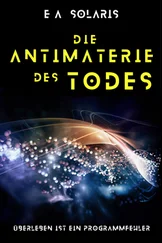Incapables de reconnaître cette vérité, les solaristes évitent prudemment toute interprétation du Contact, présenté dans leurs ouvrages comme un aboutissement final, alors que primitivement les esprits lucides le considéraient comme un début, une ouverture, une incursion sur une voie nouvelle, parmi beaucoup d’autres voies possibles. Avec les années, le Contact a été sanctifié — il est devenu le ciel de l’éternité.
Muntius analyse très simplement, et avec amertume, cette « hérésie » de la planétologie ; il démonte brillamment le mythe solariste, ou plutôt le mythe de la Mission de l’Homme.
Première voix discordante, l’ouvrage de Muntius s’était heurté au silence dédaigneux des savants, à un moment où ceux-ci avaient encore une confiance romantique dans le développement de la solaristique. Comment, en effet, auraient-ils pu approuver une thèse qui dénonçait les bases mêmes de leurs travaux ?
La solaristique continua d’attendre celui qui rétablirait solidement ses assises et fixerait avec rigueur ses frontières. Cinq ans après la mort de Muntius, alors que son livre était devenu le merle blanc des bibliophiles — presque introuvable, aussi bien dans les collections de solariana que dans les bibliothèques spécialisées en philosophie —, un groupe de chercheurs norvégiens fondèrent une école portant le nom du savant ; au contact de la personnalité de ses divers héritiers spirituels, la pensée sereine du maître subit de profondes transformations ; elle aboutit à l’ironie corrosive d’Erle Ennesson et, sur un plan moins élevé, à la « solaristique utilitaire », ou « utilitaristique », de Phæleng ; celui-ci recommandait de s’attacher aux avantages immédiats que les explorations pouvaient rapporter sans se préoccuper d’aucune communion intellectuelle de deux civilisations, d’aucun contact utopique. Comparées à l’analyse implacable et limpide de Muntius, les œuvres de ses disciples ne sont cependant guère plus que des compilations, voire de simples ouvrages de vulgarisation, à l’exception des traités d’Enneson, et peut-être des études de Takata. Muntius lui-même avait déjà exposé le développement complet des conceptions solaristes ; il appelait la première phase de la solaristique l’ère des « prophètes », au nombre desquels il comptait Giese, Holden et Sevada ; il nommait la deuxième phase le « grand schisme » — éclatement de l’unique église solariste en une foule de chapelles antagonistes ; il prévoyait une troisième phase, qui surviendrait quand tout aurait été exploré, et qui se manifesterait par une dogmatique scolastique et sclérosée. Cette prévision, toutefois, devait se révéler inexacte. À mon avis, Gibarian avait raison, quand il qualifiait l’attaque menée par Muntius de simplification monumentale, négligeant tout ce qui dans la solaristique était à l’opposé d’une foi, puisque les travaux poursuivis sans cesse ne faisaient état que de la réalité matérielle d’un globe tournant autour de deux soleils.
Dans le livre de Muntius, je trouvai un tirage à part de la revue trimestrielle Parerga Solariana, des feuillets jaunis, pliés en deux, l’un des premiers articles écrits par Gibarian, avant même sa nomination à la tête de l’Institut. L’article, intitulé Pourquoi je suis solariste, commençait par l’énumération succincte de tous les phénomènes matériels justifiant les chances d’un contact. Gibarian appartenait à cette génération de chercheurs, qui avaient l’audace de renouer avec l’optimisme de l’âge d’or et ne reniaient pas une foi caractérisée, dépassant les frontières imposées par la science, foi concrète, puisqu’elle impliquait le succès d’efforts persévérants.
Gibarian avait subi l’influence des travaux classiques de bioélectronique, auxquels l’école eurasienne — Cho Enmin, Ngyalla, Kawakadze — devait sa célébrité. Ces études établissaient une analogie entre le diagramme de l’activité électrique du cerveau et certaines décharges se produisant au sein du plasma avant l’apparition, par exemple, de polymorphes élémentaires ou de solarydes jumeaux. Gibarian rejetait les interprétations trop anthropomorphiques, toutes les mystifications des écoles psychanalytiques, psychiatriques, neurophysiologiques, qui s’efforçaient de discerner dans l’océan des symptômes de maladies humaines, entre autres l’épilepsie (à laquelle étaient censées correspondre les éruptions spasmodiques des asymétriades) ; car, parmi les défenseurs du Contact, Gibarian était l’un des plus prudents et des plus lucides, et il condamnait les déclarations sensationnelles — de plus en plus rares, à vrai dire. Du reste, ma propre thèse de doctorat avait provoqué un intérêt assez discutable. Je m’appuyais sur les découvertes de Bergmann et Reynolds, qui avaient réussi, dans une série de processus très diversifiés, à isoler et « filtrer » les composantes des émotions les plus fortes — le désespoir, la douleur, la volupté. J’avais systématiquement comparé ces enregistrements avec les décharges de courant émises par l’océan ; j’avais observé des oscillations et relevé des courbes (dans certaines parties des symétriades, à la base de mimoïdes en formation, etc.), révélant une analogie digne d’attention. Les journalistes s’étaient promptement emparés de mon nom, accolé par une certaine presse à des titres grotesques, « La gélatine désespérée » ou « La planète en orgasme ». Cette renommée trouble eut pourtant une conséquence heureuse (telle était encore mon opinion peu de jours auparavant) ; j’avais attiré sur moi l’attention de Gibarian — qui, bien sûr, ne pouvait lire la totalité des ouvrages solaristes publiés — et il m’envoya une lettre. Avec cette lettre, un chapitre de ma vie se terminait ; un nouveau chapitre commençait …
Après six jours, aucune réaction ne s’étant produite, nous décidâmes de répéter l’expérience. Immobilisée jusqu’alors à l’intersection du quarante-troisième parallèle et du cent seizième méridien, la Station se déplaça vers le sud, planant à une altitude constante de quatre cents mètres au-dessus de l’océan ; nos radars, en effet, ainsi que les radiogrammes du satelloïde, signalaient un regain d’activité du plasma dans l’hémisphère austral.
Durant quarante-huit heures, un invisible faisceau de rayons X modulés par mon encéphalogramme alla frapper, à intervalles réguliers, la surface presque lisse de l’océan.
Au terme de ces quarante-huit heures de voyage, nous avions atteint les abords de la région polaire. Le disque du soleil bleu descendait d’un côté de l’horizon, et déjà du côté opposé les renflements empourprés des nuages annonçaient le lever du soleil rouge. Dans le ciel, des flammes aveuglantes, des gerbes d’étincelles vertes luttaient avec des lueurs pourpres assourdies ; l’océan même participait à ce combat de deux astres, de deux boules de feu, embrasé ici de reflets mercuriels et là de reflets écarlates ; le plus petit nuage passant au firmament enrichissait de miroitements irisés l’éclat de l’écume sur le versant des vagues. Le soleil bleu venait de disparaître, lorsque surgit, aux confins du ciel et de l’océan, à peine distincte, noyée dans les brumes sanglantes — mais aussitôt signalée par les détecteurs — une fleur de verre gigantesque, une symétriade. La Station ne modifia pas sa trajectoire ; au bout d’un quart d’heure, le colossal rubis palpitant de lueurs mourantes se dissimula de nouveau derrière l’horizon. Quelques minutes plus tard, une mince colonne, dont la base demeurait cachée à nos yeux par la courbure de la planète, s’éleva à quelques milliers de mètres dans l’atmosphère. Cet arbre fantastique qui continuait de croître, ruisselant de sang et de mercure, signifiait la fin de la symétriade ; le foisonnement des branches, au sommet de la colonne, se fondit en un énorme champignon simultanément éclairé par les deux soleils et qui s’envola avec le vent ; la partie inférieure, tuméfiée, se décomposait en lourdes grappes et s’affaissait lentement. L’agonie de la symétriade dura une heure entière.
Читать дальше