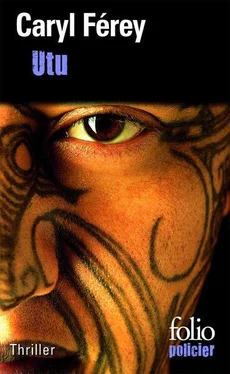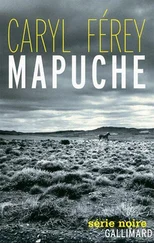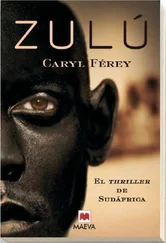Une Chevrolet marron métallisé : c’est ce qu’on lui avait donné à l’agence de location. Le vendeur lui avait proposé un meilleur modèle mais Osborne n’aimait pas les automatiques, ni les bagnoles en général. Il emprunta la route de Mission Bay, déserte à cette heure.
Jack Fitzgerald habitait un peu plus loin sur la colline, une bicoque montée sur pilotis qui dominait la baie d’Auraki. Il l’avait achetée avec sa femme, disparue depuis maintenant un quart de siècle et qui, comme leur fille, n’était jamais réapparue [1] Voir Haka , Gallimard, « Folio policier », n o 286.
. Si tous les flics d’Auckland étaient au courant, personne n’osait ne serait-ce qu’y penser en sa présence. Osborne, comme les autres, évitait le sujet. Et puis un soir, il s’était retrouvé chez Fitzgerald avec son équipe, lors d’une affaire compliquée qui mobilisait alors toutes les énergies. Il était tard, tout le monde était fatigué mais, comme Jack, on avait pris l’habitude de se coucher épuisé : c’est en cherchant les toilettes qu’Osborne avait poussé la porte d’une pièce transformée en un véritable bureau d’investigation : les murs étaient couverts de cartes d’état-major, principalement de l’île du Sud, toutes soigneusement hachurées, comme si Fitzgerald ratissait le pays à la recherche des siens… C’était le cas : il y avait là des dizaines de rapports de police, des notes, des carnets d’enquête remplis de témoignages liés à leur disparition, mais aussi quantité de rapports d’autopsie, que lui envoyait régulièrement et à titre privé le coroner McCleary, son vieux complice…
Ce soir-là, Osborne avait compris que Fitzgerald n’était pas devenu le chef de la police d’Auckland pour faire régner la justice : il les cherchait toujours. Obsédé par un deuil qu’il n’avait pas fait, il cherchait sa femme et sa fille parmi les morts, les cadavres identifiés ou non, en quête d’un signe, d’une révélation qui pourrait le débarrasser de son fardeau. Savoir ce qui leur était arrivé… Il n’avait rien dit à l’époque mais, avec le coroner McCleary, Osborne était probablement la seule personne à connaître le secret de Fitzgerald. La recherche acharnée de sa famille avait toujours constitué son unique raison de vivre : voilà pourquoi il ne pouvait pas se suicider avant de les avoir retrouvées. Malcom Kirk n’avait rien à voir là-dedans : il s’était passé quelque chose, forcément…
La Chevrolet monta le chemin de terre qui menait à la maison et se gara sous le préau désert. Osborne coupa les feux, claqua doucement la portière.
Il faisait nuit, le vent était tiède et ramenait les bruits de la mer sur les galets. Il évalua la façade. Isolée dans les collines, la maison de Fitzgerald était simple mais d’un bois solide. Osborne escalada la terrasse et força sans mal la porte coulissante du salon.
Dans le faisceau de sa torche, il reconnut le canapé gris, les statuettes maories sur les étagères, le bar américain… Enfin il trouva le compteur et activa le disjoncteur. La ligne n’avait pas été coupée. Désormais propriété de l’État, la maison serait vendue sous peu. Osborne fila vers le bureau au fond du couloir et poussa la porte qui abritait les secrets de son ancien protecteur.
Il eut une impression désagréable en voyant le lit de bébé et ses peluches poussiéreuses… L’atmosphère était lourde lorsque Osborne alluma l’ordinateur du bureau. Il chassa les souvenirs d’enfance qui couraient dans les coins et se concentra sur ce qu’il était venu faire.
D’après les informations récoltées, on avait tiré quatre cadavres du charnier de Waikoukou Valley : avant de mourir, le coroner McCleary avait peut-être eu le temps d’envoyer ses premières conclusions d’autopsie à son vieil ami… Osborne commença à ouvrir les icônes mais son cœur se contracta : il eut beau cliquer, les dossiers étaient vides.
L’ordinateur de Fitzgerald avait été nettoyé.
Cinq mois : c’est le temps qu’il avait fallu à la haie du jardin pour les séparer. Cinq mois c’était beaucoup et peu à la fois. Beaucoup parce que Paul apercevait Hana tous les soirs par la lucarne de la salle de bains, et peu car ils ne fréquentaient pas la même école.
Le collège public d’Hana était en effet d’un niveau trop faible pour un pakeha middle class comme Paul Osborne : sa mère l’avait mis dans le collège privé des environs, préférant se saigner pour qu’il obtienne une éducation décente plutôt que de perdre son temps dans des classes surchargées où on ne faisait plus que de la discipline.
C’était parfois le cas.
Ainsi Paul et Hana ne se croisaient guère qu’à l’arrêt de bus. Là, entre les copines qui n’en finissaient pas de glousser, les garçons qui paradaient comme des coqs, ils n’échangeaient que des regards. Hana n’était jamais seule et ne se déplaçait qu’en bande — de jeunes Maories du quartier qui, semble-t-il, lui vouaient une vive admiration.
La cité de Red Hill invitait il est vrai à la méfiance. Des groupes de petites frappes ondulaient du triceps sur les trottoirs les plus sales du pays, les autres filaient doux. Avec ses pantalons moulants, ses épaules nues et cet air farouche des adolescents en colère, Hana était l’une des rares à braver les regards hostiles des petits caïds.
Certains n’appréciaient pas cette insubordination : Hana était revenue un soir de l’école avec l’œil gonflé. Un coup de poing — simple avertissement.
Paul s’était renseigné sur les auteurs de ce mauvais coup. « C’est la bande à Dooley », avait-on fini par lui dire. Des gars du quartier voisin, des costauds, ou qui le croyaient. Dooley, le chef de meute, était une jeune brute sans foi ni père que plus rien ni personne ne tenait depuis longtemps. Paul n’avait pas peur de la bête : ils avaient le même pedigree. Il lui mettrait une danse dont il se souviendrait.
En attendant, Hana restait inabordable. La haie, l’école, la cité, leurs origines, tout les séparait. Les mois passaient, l’année scolaire allait bientôt s’achever et rien n’arrivait.
Un soir, alors qu’il rentrait de l’école, Paul ressentit soudain un choc contre son épaule. Il s’était retourné aussitôt, les poings serrés comme s’il allait se trouver nez à nez avec Dooley et sa bande, mais la rue était vide. Il n’y avait qu’un caillou à terre. Une pierre coupante recouverte d’un papier d’écolier, tenu par un élastique.
Paul déplia le billet-projectile et lut : « 11 p.m. en face de l’insecticide ».
L’insecticide ? Quel insecticide ? Il y réfléchit jusqu’à sa chambre : insecticide, gaz mortel, tueur d’insectes, source de chaleur, lampadaire, celui de la rue, Hana, onze heures du soir, ce soir.
Il y serait.
Il ferait le mur.
Il ferait n’importe quoi.
Il en avait le cœur qui voyait double. Ils formaient déjà un couple. Un couple qu’on maintenait séparé. C’était l’évidence même. Elle comptait sur lui. Il fallait même être rudement con pour ne pas s’en rendre compte !
La nuit vint, poisseuse.
Onze heures moins cinq : il pleuvait des cordes quand Paul s’éclipsa par le jardin. La lueur bleuâtre de la télévision l’accompagna jusqu’à la haie. Rien à craindre des parents : depuis que John était né, Paul était presque devenu un élément liquide à la maison… Il avança dans la pénombre, déchiffrant les ombres de la rue, passa le lampadaire, devina une silhouette.
Hana attendait un peu plus loin, ruisselante. Des gouttes grossissaient au bout de ses cheveux, gonflaient jusqu’à exploser et se reconstituaient aussitôt, comme par magie…
Читать дальше