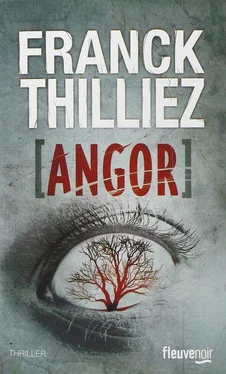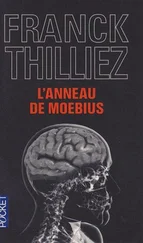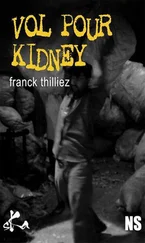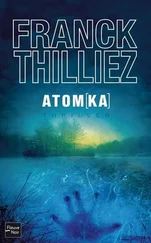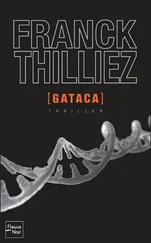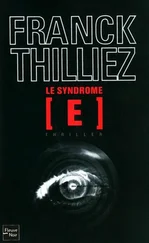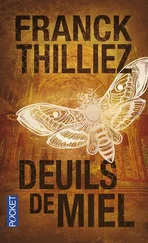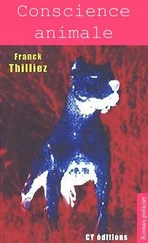Juan lui tendit un paquet de photos. Elles représentaient le portrait en noir et blanc d’un homme aux cheveux courts plaqués vers l’arrière, aux yeux sombres, et à la bouche fine et droite. Une gueule de pitbull. L’adjudant de gendarmerie observa attentivement chaque cliché.
— C’est le docteur Antonio Velasquez, le chef de l’hôpital San Ramon, celui que j’ai identifié comme l’une des têtes du réseau. Il employait des religieuses comme sages-femmes. Le scénario était identique à celui des Casas cuna : des mères célibataires fragiles venaient pour accoucher, passaient deux ou trois jours dans une chambre, tandis que leur enfant était censé rester en nurserie. Puis la sœur venait leur annoncer que leur bébé était mort.
Camille passait d’une photo à l’autre. Velasquez avait été photographié à divers endroits. Dans la rue, dans son bureau, devant sa clinique. Sur un cliché flou, Camille remarqua la présence, juste à ses côtés, d’un homme habillé tout en noir, portant un chapeau de feutre. Sa tête avait été entourée au marqueur.
— Étrange photo, non ? fit Juan. Elle est complètement trouble, alors que toutes les autres de la série sont nettes. C’est la seule où l’on aperçoit cette silhouette noire… J’ai cherché : personne ne sait de qui il s’agit.
Juan poursuivit la descente aux Enfers. Cette fois, il montra un nouveau-né à moitié recouvert d’un drap blanc, posé sur le compartiment d’un réfrigérateur dont la porte était ouverte.
— J’ai obtenu ces photos dans les années 80, d’un grand reporter qui enquêtait déjà sur la clinique San Ramon. Je vous enverrai des doubles si vous voulez.
Camille lui tendit une carte.
— Merci, fit-elle.
— Là, il n’y a qu’un seul nouveau-né dans le frigo. Mais l’hôpital San Ramon disposait de plusieurs bébés congelés.
— Congelés ? répéta Camille, stupéfaite.
— Oui. La bonne sœur montrait un bébé mort aux mères qui insistaient pour voir leur enfant, déjà parti pour l’adoption. Il y avait différentes tailles de bébés congelés, la sœur prenait alors le plus ressemblant. Cette technique était radicale pour étouffer les soupçons des mères et les rendre dociles. Celles qui, malgré tout, ne se laissaient pas duper et osaient porter plainte étaient prises pour des folles, rejetées, malmenées. Après 75, la démocratie était faible, l’ombre du franquisme continuait à planer, et le docteur Velasquez jouissait d’une excellente réputation.
— Où allaient les enfants ?
— Au départ du trafic, que ce soit dans les Casas cuna ou les cliniques, les bébés étaient vendus à des familles espagnoles qui ne pouvaient pas avoir d’enfants et qui voulaient adopter. Ces familles s’endettaient sur des années, mettaient leurs maisons sous hypothèque pour « acheter » un bébé. Elles étaient mises au courant de la possibilité « d’adopter » par des sages-femmes, du personnel hospitalier ou par des connaissances. La manière dont cela se passait peut paraître complètement hallucinante, mais ce que je vous raconte est la pure vérité : vous arrivez devant l’hôpital, une sage-femme vous attend dans la rue, vous lui remettez un acompte — l’équivalent de trois mille euros à l’époque —, et vous montez dans la nurserie prendre l’enfant, récupérant par la même occasion de faux papiers : vous devenez alors officiellement le parent d’Untel, né dans tel hôpital, sceau du ministère de la Justice à l’appui. Puis vous payez des traites pendant des années, comme pour un crédit quelconque, jusqu’à débourser, au total, dans les vingt mille euros, l’équivalent d’un bel appartement. Et croyez-moi, vous avez intérêt à payer.
Camille se rappela ce qu’elle avait lu dans les notes du flic d’Étretat : Jean-Michel Florès avait demandé une grosse somme d’argent à sa sœur, peu de temps après la naissance de Mickaël.
Aucun doute, Jean-Michel Florès était venu acheter un bébé en Espagne.
Juan poursuivait, emporté par son propre récit :
— Un bouche-à-oreille mondial s’est parallèlement mis en place, et ce dès le milieu des années 60. La haute société a immédiatement su, loin d’ici, que l’Espagne fournissait des bébés. Alors, des gens riches, bien placés, commerçants, hommes d’affaires, ont commencé à venir de l’étranger avec de l’argent. Là, à l’endroit exact où nous nous trouvons, des groupes de visiteurs étrangers entraient et se promenaient comme on visite un salon de l’automobile, touchaient les nouveau-nés, les photographiaient. Le lendemain, des enfants avaient disparu. La plupart des acheteurs venaient d’Amérique latine. Mexique, Argentine…
L’Argentine… Le mot résonna dans la tête de Camille. Elle le répéta en forme de question.
— L’Argentine ?
— Oui. L’Espagne avait des relations privilégiées avec l’Amérique latine ou les États-Unis. Et n’oublions pas que l’Argentine a connu sa propre dictature entre 1976 et 1983. Une succession de généraux tous plus sanglants les uns que les autres, avant que la guerre des Malouines mette un terme à toutes ces horreurs. Il s’est passé là-bas la même chose qu’ici : le vol de bébés comme butin de guerre ou pour les placer, souvent, dans les familles des militaires du régime. Mais, avant la dictature, des Argentins fortunés et des réseaux venaient se servir ici comme dans une boutique.
Camille était tout ouïe. L’historien grinça des dents et éteignit son cigare en étouffant l’extrémité dans l’aluminium.
— On a pris ces enfants pour des jouets. On les a manipulés, vendus, on a trompé leurs mères. Aujourd’hui, ils sont pleins de rancœur, de haine envers leur pays d’origine. Ils exigent réparation.
Camille avait l’impression d’avoir les poches débordantes de pièces de puzzle, et que celles-ci se renversaient partout autour d’elle. Elle essaya de se concentrer, de faire un bilan, de poser les bonnes questions. Les réponses devaient être là, toutes proches.
— On sait où est le directeur de cette clinique morbide, cet Antonio Velasquez ? demanda-t-elle.
— C’est seulement maintenant que la justice commence à s’intéresser à lui. Tout est tellement long, compliqué, labyrinthique. Mais Velasquez, qui doit avoir aujourd’hui soixante-dix ans, a disparu depuis bien longtemps. Et bien malin celui qui saura où il se cache désormais.
Dans un soupir, la gendarme considéra la photo de Maria Lopez. Il la retourna vers son interlocuteur.
— On peut en tirer quelque chose ? Retrouver l’enfant de Maria Lopez dans des papiers, des hôpitaux ? Fouiller dans les archives des Casas cuna ?
— Vous ne trouverez malheureusement plus rien. Le bébé de Maria Lopez ne s’est jamais appelé Lopez. Même en supposant que les papiers n’aient pas disparu, il n’y a aucun moyen de remonter la piste en passant par les voies administratives. Presque plus rien ne relie Maria à son enfant volé.
— Presque ? Il y a un espoir, alors ?
— Dieu merci, il y a toujours un espoir. Dans les papiers, tout était faux : les noms, la filiation, les villes et dates de naissance. Mais il y a quelque chose qu’aucune administration, qu’aucun régime ne pourra falsifier. (Il plaqua une main sur son torse.) C’est ce que nous avons de profondément enfoui en nous.
— L’ADN, percuta Camille.
— Exactement.
Camille écouta avec attention.
— Il y a quelques années, devant l’ampleur de l’affaire, le gouvernement espagnol a décidé de prendre les devants. Un poste spécial « bébés volés » s’est créé au ministère de la Justice. Des campagnes d’information et de sensibilisation ont encore lieu aujourd’hui dans les grandes villes d’Espagne. Toutes les mères qui pensent avoir été victimes d’un vol de bébé sous le franquisme peuvent se faire prélever leur ADN. De l’autre côté, des enfants du monde entier qui pensent avoir été adoptés ou en ont la certitude peuvent également donner leur ADN. Tous les profils sont stockés au siège de Genomica, à Madrid, l’une des plus grandes banques ADN d’Europe.
Читать дальше