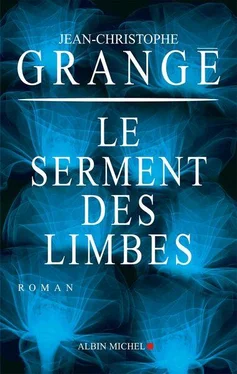Je me retournai à nouveau. Dans la main gantée du tueur chauve, un automatique était apparu, mi-acier, mi-inox, muni d’un silencieux. Avant même que je tente quoi que ce soit, l’homme appuya sur la détente. Rien ne se passa. Pas de flamme, pas de détonation, pas de culasse actionnée, rien.
Les cendres. Elles avaient enrayé le flingue ! Je pivotai et abattis à l’aveugle mes deux poings. L’obèse avait aussi dégainé. Le coup lui fit sauter son arme. Je le bousculai d’un coup d’épaule et courus vers les contours indécis de l’avenue.
J’étais paniqué mais pas assez pour perdre le sens de l’orientation. En quelques secondes, j’étais devant ma bagnole. Télécommande : aucun résultat. La poussière avait occulté aussi le récepteur du signal. J’étouffai un juron, la bouche terreuse. Je jouai de la clé : pas moyen de l’enfoncer. La suie, toujours. Les secondes brûlaient. Trouvant en moi une ultime parcelle de sang-froid, je m’agenouillai et soufflai, doucement, très doucement, sur la serrure.
La clé glissa à l’intérieur. Je plongeai dans ma Fiat Punto. Contact. Je patinai une seconde puis me propulsai dans la circulation. Deux coups de volant et j’étais loin.
Nulle part en fait, mais vivant.
Encore une fois.
L’aéroport de Catane était fermé depuis la veille. Pour décoller vers Rome, je devais partir d’une autre grande ville. Coup d’œil à ma carte. Je pouvais rejoindre Palerme en deux heures. Avec un peu de chance, un vol décollerait de là-bas.
En m’orientant vers la sortie de la ville, j’appelai l’aéroport de Palerme : un vol partait à 18 h 40 pour Rome. Il était 15 h 30. Je réservai une place puis raccrochai, m’essuyant les yeux, expectorant par le nez et la bouche. J’avais l’impression d’être tapissé de particules, à l’intérieur même de mon corps.
Je roulai, et roulai encore. Je dépassai Enna à 16 h 30, puis Catanisseta, Resuttano, Caltavuturo. À 17 heures, je longeais la mer Tyrrhénienne et croisais Bagheria. À 18 heures, j’approchais de l’aéroport, Palermo Punta Raisi. Respecter les règles. Je rendis ma voiture à l’agence de location puis courus aux comptoirs d’enregistrement. À 18 h 30, je donnais ma carte d’embarquement à l’hôtesse. Je ressemblais à un épouvantail, chaque pli de mon manteau recelait des rivières de poussière, mais j’étais toujours dans la course, sac à la main, dossier sur le cœur.
Alors seulement, installé en première, tandis que le steward me proposait une coupe de Champagne, je me détendis. Et considérai, bien droit dans les yeux, cette évidence : pour une raison inconnue, j’étais un homme à abattre. J’enquêtais sur un dossier qui méritait qu’on m’élimine pour m’empêcher de progresser. De quel dossier s’agissait-il ? Celui de Sylvie Simonis ou celui d’Agostina Gedda ? Était-ce le même ? N’y avait-il pas, derrière ces meurtres, un enjeu supérieur ?
Je songeai à ma visite à Malaspina. Mon opinion était faite sur l’état mental d’Agostina. Une pure schizophrène, bonne pour le cabanon. Je n’étais ni psychiatre, ni démonologue, mais la jeune femme souffrait d’un dédoublement de personnalité et aurait eu besoin de soins intensifs. Pourquoi n’était-elle pas internée ? Les avocats de la curie préféraient-ils la garder en observation, à Malaspina ?
Les experts ecclésiastiques ne se préoccupaient pas de la guérir. Ils ne cherchaient pas non plus à la défendre contre la justice italienne. Personne, au Vatican, ne se souciait de la loi séculaire des hommes. Ils voulaient seulement comprendre comment une miraculée de Dieu pouvait être sous l’emprise du Malin. Ou plutôt, pour parler clair, déterminer s’il pouvait exister une miraculée du diable. Ce qui revenait à prouver, physiquement, l’existence de Satan.
Certes, lors de ma visite, des faits inexplicables étaient survenus. L’odeur fétide, le froid soudain. J’avais senti la présence de l’Autre… Mais j’avais peut-être été le jouet de mon imagination.
L’odeur, après tout, pouvait provenir d’Agostina elle-même. Son fonctionnement physiologique, gouverné par un esprit aussi tordu, pouvait être sérieusement perturbé. Quant au froid, je m’étais senti si vulnérable dans ce parloir qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce que je perde ma capacité à me réchauffer.
Je secouai la tête : non, il n’y avait pas eu de présence extérieure dans la cellule de sable. Le Prince des Ténèbres ne s’était pas invité à l’interrogatoire. Je n’avais qu’un seul ennemi, toujours le même : la superstition. Lutter contre ces croyances enfouies qui remontaient, malgré moi, à la surface. Satan n’appartenait pas au dogme, et je n’y croyais pas. Point barre.
Je laissai errer mon regard sur les nuages. Une phrase résonnait dans ma tête, LEX EST QUOD FACIMUS. La loi est ce que nous faisons. Qu’avait voulu dire Agostina ? Qui était ce « nous » qu’elle s’autorisait ? La légion des possédés ? Et quelle était cette « loi » ? Cela pouvait être une évocation de la règle du diable, qui s’ouvre justement sur une liberté totale, LA LOI EST CE QUE NOUS FAISONS.
Je me répétai ces syllabes en boucle, façon sourate, jusqu’à ce que la litanie me livre son secret. Au lieu de ça, je perdis conscience sans même entendre le train d’atterrissage qui rentrait dans le fuselage.
Rome.
Enfin une terre familière.
20 heures. Je donnai au chauffeur de taxi l’adresse de mon hôtel et lui indiquai un itinéraire précis. Je voulais qu’il passe par le Colisée, puis qu’il remonte la via dei Fori Imperiali jusqu’à la piazza Venezia. Ensuite, c’était le labyrinthe des petites rues et des églises jusqu’au Panthéon, où se trouvait mon hôtel, non loin du séminaire français de Rome. Ce trajet n’était pas fait pour gagner du temps, mais seulement pour retrouver mes marques.
Rome, mes meilleures années.
Les seules qui se soient écoulées sous le signe d’une relative quiétude.
Rome était ma ville — peut-être plus encore que Paris. Une cité où l’espace et le temps se télescopaient, au point qu’en changeant de rue, on changeait de siècle, en tournant le regard, on inversait le cours du temps. Ruines antiques, sculptures Renaissance, fresques baroques, monuments mussoliniens…
— C’est là.
Je jaillis du taxi, presque surpris de ne pas voir mes pas entravés par ma soutane. Cette robe que je n’avais portée que quelques mois dans ma vie. Maintenant, j’étais expert en vices humains et je pouvais atteindre une cible à cent mètres, en position de tir-riposte. Une autre école.
Mon hôtel était une pension toute simple. J’y étais descendu plusieurs fois, lors de mes premières recherches à la bibliothèque vaticane, avant le séminaire. J’avais choisi ce lieu pour rester discret. Les tueurs ne m’avaient pas suivi jusqu’à Catane : ils m’y avaient précédé. Pour une raison inconnue, ils parvenaient à anticiper mes déplacements. Peut-être étaient-ils déjà à Rome…
Comptoir de bois verni, porte-parapluies laqué, lumières anémiques : le vestibule de la pension était déjà tout un programme. Langage universel du confort bourgeois et de la simplicité bienveillante… Je montai dans ma chambre.
J’avais plusieurs contacts à la curie romaine. L’un d’eux était un ami de séminaire. Nous conservions encore aujourd’hui un lien en pointillé, à coups de mails et de SMS. Gian-Maria Sandrini, un petit génie sorti major de l’Académie Pontificale. Il occupait maintenant un poste important au Secrétariat d’État, section des Affaires générales. Je composai son numéro :
— C’est Mathieu, fis-je en français. Mathieu Durey.
Читать дальше