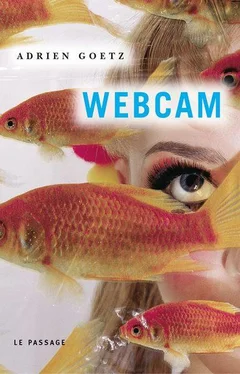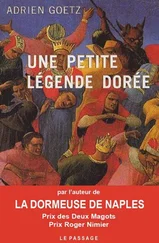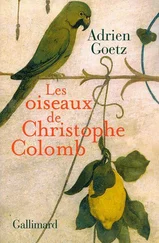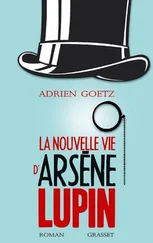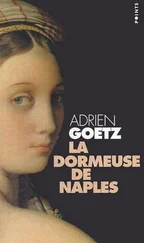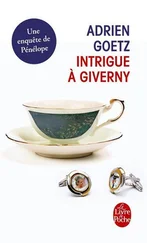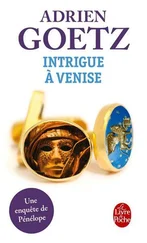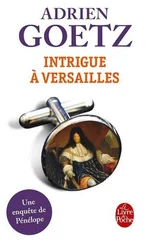La fille qui parle ensuite, Parme, me semble insignifiante. Trop timide, terrifiée d’être interrogée au Quai des Orfèvres.
C’est la dernière, Tagar, qui craque, elle lâche ce qui peut être un début de piste :
« Virgile nous a dit ce soir-là que nous pourrions aller à New York avec lui. Il avait dix dessins à vendre, de vos dessins, comme il en avait déjà vendu trente le mois dernier. Et trois tableaux, je crois. Un grand marchand, très discret, qui paye en cash et qui a promis de ne les mettre sur le marché, pardon monsieur, qu’après, comment dire…
— Ma mort ?
— Je ne sais pas pourquoi. Si c’était pour les vendre plus cher, dans l’idée du marchand, ou pour vous épargner, à cause du sujet d’un des trois grands tableaux. Un peu scabreux, non ? »
Elle ne va pas faire un cours de morale celle-là, quelle effrontée, à un centenaire en plus. Je suis intrigué de voir que les jeunes retrouvent le goût des partouzes, comme nous aux temps heureux des années Giscard. J’étais déjà vieux, mais j’osais faire tout ce qui me paraissait monstrueux dans les années folles, quand j’étais si sage et que l’on s’amusait déjà de cette manière. Je me réjouis d’avance de leur raconter, sans greffier ni commissaire, les histoires qui impliquaient alors des membres du gouvernement, des femmes en vue, les gardes du corps des uns et des autres. C’est un sujet de conversation qui fait toujours bon effet, je m’étais même fait sortir à un dîner chez un ancien ministre du général de Gaulle. La petite Tagar se met à pleurer, en sanglots nerveux, qui secouent ses cheveux. Elle se prend la tête dans les mains, elle respire à grands traits. Le commissaire suspend l’entretien alors que c’est à ce moment qu’il fallait le poursuivre. Pour que la fille crache tout ce qu’elle sait. Elle avait l’air d’avoir quatorze ans, avec ses grosses joues. Elle pleurait, il aurait dû l’insulter.
« Vous les avez vus, vous, mademoiselle, ces trois tableaux ?
— Oui, Virgile les a déroulés devant nous.
— Où ?
— À Paris, dans le couloir, par terre.
— Qui les a peints ?
— Vous.
— Il vous a dit ça ? Il le croyait ?
— Oui.
— D’où venaient les toiles ?
— Il les a rapportées après un week-end chez sa mère. Elles étaient restées dans le grenier de votre ancienne maison dans le Limousin. Vous croyez que ce n’est pas vrai ? »
Elle se remet à pleurer.
« Je l’ai aimé, moi, votre fils. J’étais amoureuse de lui.
— Je l’avais deviné. Il vous aurait aidée, dans votre carrière. Ne pleurez plus. Il n’aurait pas aimé que nous le pleurions. Il riait toujours. Depuis qu’il était enfant, il riait. »
J’ai hâte de finir l’entretien qui devient pénible. Hâte de retrouver Nahoum, qu’elle me dise si Etienne est un jeune malade ou si, comme je le pense, il imagine pour nous la seule solution, la mieux adaptée à nos trois témoins. À la fin de cette conversation, je suis certain pour ma part que l’idée proposée par Étienne, l’œuvre sur Internet, l’enquête planétaire en temps réel, le huis clos sous les projecteurs et les caméras à infrarouge est la seule viable — et que mes nouveaux amis, innocents ou coupables, comédiens ratés, mannequins sans contrats, avides de n’importe quelle gloire, s’y prêteront comme de petits animaux.
CHAPITRE 10.
Chaste étude des nouvelles pratiques sexuelles des jeunes
Quand j’ai fait mes premières œuvres-phrases, c’était pour choquer. En ce temps-là, on ne parlait pas de moi et le plus sûr moyen de sortir du silence était de s’inventer un bon petit scandale. C’était l’esprit artiste. Aujourd’hui, plus rien ne choque et tous les artistes veulent faire du scandale. Le sexe, ma mort [sic. Gossec a probablement voulu écrire « la mort »], le sang, les tatouages, les tortures, le sadomasochisme, cela ne choque plus personne et surtout, ce n’est pas avec cela que l’on fait de l’art. Les jeunes artistes ont une tâche plus difficile que ceux de mon temps. Nous avons eu beaucoup de chance qu’il y ait, dans ce vingtième siècle maudit, autant de choses à inventer et assez de gogos pour gober toutes nos pauvres idées. Les artistes ont fait fortune. J’étais malin mais sans mérite — au bon moment.
Virgile vendait à un marchand de New York, la galerie Mayfair de Ralph Crowley, les trois tableaux que m’avait montrés la chèvre. Bien. C’est le premier fait établi. J’en parle à Jacques qui me choisit un costume de chef d’entreprise, un beau croisé à rayures tennis avec une chemise blanche et une cravate noire. Il m’explique qu’il faut ça pour affronter à nouveau la police. Le négligé de la douleur ne me convient plus. Il me visse le petit canapé de la Légion d’honneur, il pense à tout. « Avec ça, monsieur le comte, c’est vous qui mènerez l’entretien, vous verrez. La police sera à vos ordres. » Je ne sais pas s’il a raison, j’ai l’air d’un ancien ministre. Je ne veux pas finir dans le box.
Je sors du Quai des Orfèvres seul, accroché à ma canne à bout de caoutchouc, après la confrontation avec les trois petits assassins, sans doute discrètement suivi par un gorille protecteur. Aucune charge n’est retenue contre eux, mais ils doivent, comme témoins, ne pas quitter Paris et rester à la disposition de la police. Je n’ai pas regardé derrière moi pour vérifier si l’on me suivait.
Le jeune Pablo et ses deux sbiresses, la Tagar aux yeux rougis et cette Parme qui ne dit pas grand-chose, attendent au coin du trottoir et m’abordent, avec une nuance de respect mais pas d’hésitation. Je leur propose d’aller boire un café dans un endroit bruyant et ils montent dans ma voiture.
« Vous avez un nom qui sonne comme à Valence, un beau nom catalan, Pablo Santacreu. C’est de là que vous venez ? Vous n’avez pas une tête très ibérique.
— Non, c’est le nom que je me suis choisi, pour jouer les hidalgos. Mon nom sonne plus français. Je vous le dirai la prochaine fois que nous nous rencontrerons, ça vous amusera.
— Pourquoi ?
— Parce que ça sent le terroir, mais peu importe. La prochaine fois… »
Je m’assieds à côté de Jacques. Sur la banquette arrière, j’ai donc le trio des derniers compagnons de débauche de la dernière nuit de Virgile. J’ai du mal à leur parler, je pense que ce sont peut-être eux les assassins. Eux se taisent, ils ne savent pas de quoi l’on peut causer avec une gloire mondiale. Ils ne savent pas non plus trouver le ton juste pour parler à un vieillard qui vient de perdre son fils de trente ans. Je me sens comme Mohammed Al Fayed après la mort de Dodi et de Diana, j’adopte une attitude de magazine pour concierges, je les mets à l’aise, je leur montre que je les tiens, que j’ai de l’argent et du pouvoir. Je téléphone devant eux au préfet de police, que je tutoie depuis un dîner chez le garde des Sceaux du précédent gouvernement. Je le leur dis. Je leur parle de Virgile, mon fils qu’ils ont connu bibliquement tous les trois, je leur raconte ses mots d’enfant, ses premiers pas, la fois où nous avons coupé ses cheveux avec Isabelle. Nous allons dans un endroit à la mode qu’ils me conseillent, le café Charbon dans le XI earrondissement.
Les quartiers de l’est commencent à vivre. Dans cinq ans, le sinistre canal Saint-Martin sera notre petite Venise, la mairie du XI eun palais des Doges. Aussi superbe et aussi triste. Je serai mort ; dans vingt ans, les Japonais viendront dans ce café Charbon comme ils vont aujourd’hui au Flore et aux Deux Magots. Notre jeunesse les intéresse et je ne suis pas mécontent d’avoir, dans ma vieillesse, goûté au Charbon, à ses tables sombres et à ce plafond de six mètres qui éteint les conversations avec la fumée des cigarettes.
Читать дальше